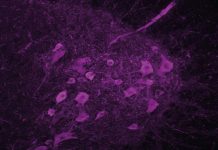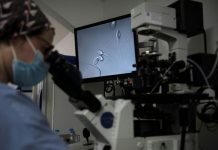Africa-Press – Cameroun. Nommé astronaute membre de la réserve à l’Agence spatiale européenne (ESA), le Français Arnaud Prost est un passionné d’astrophysique. En parallèle de sa formation pour devenir astronaute, il travaille en tant que pilote opérationnel sur l’E3-F, l’AWACS français de l’Armée de l’Air et de l’Espace. Interview.
Sciences et Avenir: Comment se passe votre formation d’astronaute membre de la réserve?
Arnaud Prost: Quand on est membre de la réserve de l’Agence spatiale européenne, on ne s’entraîne pas ici à plein temps comparé aux astronautes de carrière, à l’instar de Sophie Adenot par exemple. Mais notre entraînement de base est très similaire à celui des astronautes de carrière. Sauf qu’au lieu de le faire en un seul bloc, on s’entraîne deux mois par an. Une façon de rentrer progressivement dans le métier d’astronaute.
La sélection est-elle la même?
Il s’agit exactement de la même sélection en six étapes. En 2022, Sophie Adenot et moi-même avons été retenus. Au départ, nous étions 22.523 candidats. A la toute fin, nous étions 17 personnes aptes à être entraînées pour être astronautes. En ce moment en Europe, il n’y a pas assez d’opportunités pour faire voler 17 personnes. Alors plutôt que de se passer des personnes recrutées, l’ESA a saisi l’opportunité de réaliser deux groupes: le premier avec des astronautes de carrière qui démarrent leur formation tout de suite et qui ont des perspectives de vol proches ; et un autre groupe d’astronautes de réserve, sans opportunité de vol identifiée à court terme, mais qui se forment progressivement.
« Le cœur de la préparation consiste à se préparer aux expériences à réaliser sur la Station spatiale internationale »
A quel type de missions sont affectés les astronautes de la réserve?
Ils peuvent être affectés à des missions de courte durée si un Etat membre, de la nationalité de l’astronaute, veut en saisir l’opportunité. C’est ce qui s’est passé pour le Suédois Marcus Wandt et le Polonais Sławosz Uznański-Wiśniewski, qui ont déjà volé tous les deux pour des vols de trois semaines. C’est la logique de la réserve: avoir des personnes capables de rejoindre le corps des astronautes sur le long terme, mais qui peuvent aussi saisir des opportunités de vol de courte durée, à une échéance beaucoup plus proche, si elles se présentent.
Combien de temps à l’avance peut-on être appelé?
Il n’y a pas vraiment de règle. Mais pour faire tout l’entraînement nécessaire à ces missions dans des conditions raisonnables, ce serait compliqué de descendre en dessous de six mois.
A quoi se prépare-t-on concrètement?
Le cœur de la préparation consiste à se préparer aux expériences à réaliser sur la Station spatiale internationale (ISS). Même si certaines sont déjà sur la station, elles ont besoin de se former, de connaître les protocoles en amont. Il faut bien sûr se préparer à être à l’aise dans l’espace mais la finalité, c’est surtout de se consacrer à la recherche et à la science.
Faut-il les mêmes qualités pour réussir sa mission?
Il y a de grandes similitudes avec les astronautes de carrière, à commencer par la patience. Les astronautes de carrière ont des perspectives de vol plus proches mais pour eux comme pour nous, avec le vol habité, c’est comme en aéronautique: tant qu’on n’est pas dans la fusée, tout peut se passer, et il faut donc se préparer à tout, en particulier à attendre. De la même façon, il faut savoir jouer en équipe. La mission d’exploration spatiale ne vous doit rien à vous en tant qu’individu: il faut apprendre à s’inscrire dans des arbitrages entre les nations et les projets qui vous dépassent. La spécificité de la réserve, c’est qu’il faut être capable de changer rapidement et fréquemment de contexte entre votre métier et votre entraînement.
Arnaud Prost lors de ses cours au Centre d’entraînement des astronautes à Cologne en Allemagne. Crédits: ESA
« Certains cours ont une dimension opérationnelle, comme un stage de survie en temps froid »
Quels cours suivez-vous en ce moment?
C’est très varié. Ce matin on avait un cours sur les contraintes liées au développement des systèmes spatiaux. Comment gérer la trajectoire de la Station spatiale internationale, comment orienter correctement les antennes et les panneaux solaires, quels matériaux utiliser? Certains cours ont une dimension opérationnelle, comme un stage de survie en temps froid, effectué l’année dernière, dans la perspective de redescendre avec un véhicule qui ne se pose pas à l’endroit prévu. Il faut alors attendre durant un certain temps et savoir se débrouiller dans cet environnement froid avant d’être récupéré par les secours. On a aussi fait un stage de survie en mer la semaine dernière.
D’autres cours sont plus théoriques, comme la physique des radiations dans l’espace ou encore la physiologie du corps humain en microgravité. Il y a aussi une dimension sportive, on se prépare aux exercices physiques à réaliser sur l’ISS pour compenser la perte musculaire et osseuse qui a lieu en microgravité. Et puis il y a le facteur humain, on nous forme à travailler dans des environnements confinés, dans des situations où il faut prendre des décisions rapidement sous l’effet du stress.
On pense peu à cet aspect humain, qui est pourtant crucial !
La camaraderie, ça ne se travaille pas dans une salle de classe. Mais passer une semaine dans le froid à devoir se débrouiller, ça permet de tisser des liens. Avoir connecté de façon personnelle avec l’équipe, c’est l’élément qui peut faire la différence dans les moments critiques.
Les astronautes membres de la réserve lors de leur stage de survie par temps froid. Crédits: ESA
Vous entraînez-vous aussi à l’absence de gravité?
Oui, nous avons aussi réalisé une semaine d’entraînement en microgravité dans un Airbus A310 « Zéro-G » opéré par Novespace à Bordeaux. L’avion réalise 31 paraboles qui nous laissent pendant 22 secondes en impesanteur. Pendant toute cette phase, nous avons réalisé divers exercices: s’entraîner à manipuler avec des gants les mousquetons qui sont ceux avec lesquels on se déplace sur l’ISS, ou encore s’exercer à récupérer des outils en impesanteur. C’est l’occasion de constater que si on veut utiliser une visseuse, il faut être en mesure de se tenir quelque part, sinon on se met à tourner en sens inverse de la visseuse (rires) !
Arnaud Prost et les membres de la réserve. Crédits: ESA
« Un astronaute affecté à une mission n’est jamais l’inventeur d’une expérience »
Vous avez étudié l’astrophysique à l’Université de Toulouse en parallèle de votre formation à l’ISAE-SUPAERO. Sur quoi portaient vos travaux?
J’ai d’abord commencé à étudier l’astrophysique à l’Ecole polytechnique: physique des particules, relativité générale, relativité restreinte, formation des étoiles, les grandes équations de la cosmologie, tout cela m’a énormément plu. C’est pour cela qu’à l’ISAE-SUPAERO, j’ai fait un double cursus avec l’université Paul Sabatier de Toulouse. Cela m’a permis d’aller vers des domaines que je ne maîtrisais pas jusque-là, comme la planétologie, qui est l’étude de la formation des planètes du système solaire. Pourquoi certaines sont rocheuses, pourquoi certaines sont gazeuses? Pourquoi certaines ont des anneaux ou des lunes et pas d’autres? Comment s’est formée la Lune? Des questions fondamentales et passionnantes.
Quelles expériences scientifiques menez-vous à l’Agence spatiale européenne?
Un astronaute affecté à une mission n’est jamais l’inventeur d’une expérience. C’est un opérateur, plutôt un laborantin qu’un scientifique. Dans l’espace, les astronautes sont les mains et les yeux des personnes qui ont imaginé cette expérience, il y a souvent bien des années. Honnêtement, tout est hyper intéressant. Mais si j’ai la chance de faire un lien avec l’astrophysique, ça me plairait beaucoup.
En parallèle de votre vie d’astronaute, vous avez fait beaucoup de plongée et d’apnée. Y a-t-il des similitudes entre ces deux mondes?
Oui, en particulier des similitudes techniques, comme les systèmes de support-vie. Comment faire pour continuer de vivre et de travailler correctement sous l’eau ou dans l’espace? On a besoin d’une quantité minimale d’oxygène, on a besoin d’une pression ambiante à une certaine valeur, on a besoin d’une certaine température. Vous devez avoir dans les deux cas des machines qui vous fournissent ces éléments-là. On retrouve aussi certains impacts similaires sur le corps humain, comme le risque d’accident de décompression en plongée, qu’on peut aussi retrouver dans des vols à haute altitude ou sur les sorties extravéhiculaires dans l’espace. Ça, ça me passionne.
Avec quel équipement plongez-vous?
Je plonge avec un recycleur, une sorte de sac dans lequel on respire, rattaché à une machine, qui enlève le CO2 et rajoute de l’oxygène. C’est un système de support-vie qui ressemble beaucoup à ce qu’on peut avoir sur une combinaison extravéhiculaire ! C’est une des raisons pour lesquelles j’adore cette machine. Avec elle, je peux descendre à 120 mètres de profondeur, pour des plongées qui durent alors jusqu’à environ cinq heures. Pour l’apnée, j’ai commencé dans le cadre de la chasse sous-marine, puis j’ai continué une pratique plus sportive, jusqu’à devenir instructeur et pouvoir évoluer aux alentours des 30 mètres. Cela demande beaucoup moins d’équipement !
Les environnements hostiles ne sont pas une barrière pour vous?
Disons que je suis passionné par l’enjeu technique et humain d’aller dans un environnement dans lequel on ne peut pas survivre sans un système complexe, des procédures particulières, une équipe entraînée. Ça ouvre des dimensions nouvelles sur le plan humain: la façon dont on interagit avec l’équipage est cruciale. En plongée par exemple, il faut réussir à communiquer avec les yeux, comprendre ce qu’il se passe derrière le masque de ses coéquipiers.
Vous devez être particulièrement à l’aise lorsque vous vous entraînez en simulation dans la piscine de l’Agence spatiale internationale !
Etant natif de Marseille, je préfère forcément plonger dans l’eau salée ! Mais plonger dans la piscine d’entraînement des astronautes, pour moi c’était un moment très particulier. Je vous avoue que c’est un peu un rêve dans le rêve.
Arnaud Prost lors de son entraînement dans la piscine de l’ESA. Crédits: ESA
« J’ai hâte de voir les combinaisons développées pour le projet Artémis sur la Lune »
Votre fiche Wikipédia indique que vous aimez aussi le bricolage. C’est vrai?
Oui ! Même si je m’y suis mis tard. On a rénové une maison avec ma compagne et je me suis formé à plusieurs corps de métier, avec plus ou moins de succès et plus ou moins de plaisir (rires). Couler une dalle de béton, je trouve cela moins agréable que travailler le bois. Pour mon anniversaire, mes amis m’ont offert une raboteuse-dégauchisseuse. C’est assez incroyable, c’est une machine qui permet d’obtenir une pièce de bois parfaitement plane et d’équerre. Ça change la vie quand on veut faire des meubles ou une terrasse.
Et côté spatial, y a-t-il certains développements techniques destinés aux astronautes que vous attendez avec impatience?
Oui ! J’ai hâte de voir les combinaisons développées pour le projet Artémis sur la Lune. Les combinaisons utilisées pour les sorties extravéhiculaires sur l’ISS ne seront pas exactement les mêmes que celles utilisées sur un corps céleste, puisqu’on n’y est pas soumis aux mêmes contraintes. A la surface de la Lune, il y a du régolithe, une roche qui, sans eau ni érosion, reste très pointue et abrasive, à l’inverse du sable chez nous qui est progressivement « poli ». Il faut donc par exemple adapter les bottes. Or on ne s’est pas servi de ces combinaisons depuis Apollo 17, en 1972. J’ai hâte de voir les nouveaux matériaux !
Comment voyez-vous le futur de l’exploration spatiale?
Plusieurs enjeux attendent l’exploration spatiale. D’abord, l’orbite basse avec la Station spatiale internationale. Cette station est prévue de s’arrêter en 2030, ce qui entraîne beaucoup de questions. Qu’est-ce qu’on fait après? Comment continuer la recherche et à quel prix? Ensuite, il y a le retour sur la Lune, avec le projet Artémis, dans lequel l’ESA est impliquée en partenariat avec la Nasa, à un horizon de temps qui varie en fonction de l’actualité. Et puis enfin vient l’exploration de la planète Mars, à une échelle de temps plus lointaine. Même si on est déjà en train de répondre à certaines questions fondamentales ! Le robot Perseverance vient par exemple de trouver des roches à la surface de Mars avec ce qui pourrait être des biosignatures, cela donne le vertige. Il faut continuer cette recherche cruciale et aller plus loin pour répondre à la question de la possibilité de la vie sur d’autres planètes.
Y a-t-il d’autres découvertes en astrophysique qui vous ont marquées?
J’ai été très enthousiasmé par le James Webb, ce télescope envoyé directement dans l’espace par l’ESA et la Nasa afin de contourner les difficultés liées à l’observation depuis la surface de la terre: il ouvre vraiment un nouveau champ de performance. Ce télescope révolutionne la qualité de l’image que l’on peut obtenir des galaxies très lointaines, et donc très anciennes. A chaque nouveau cliché, je suis émerveillé.
Pensez-vous que le statut des membres de la réserve pourrait être amené à évoluer à l’avenir?
Je suis optimiste tout en restant raisonnable (rires). Le spatial a tendance à s’accélérer. Si le nombre d’opportunités de vol augmente, il y aura besoin d’un nombre plus important d’astronautes professionnels. En offrant de la flexibilité et une capacité d’anticipation, je pense que c’est un modèle qui a vocation à se pérenniser dans le temps.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Cameroun, suivez Africa-Press