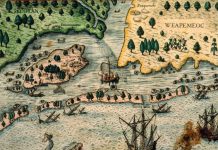Africa-Press – Congo Brazzaville. Il existe des inégalités du genre dans le marché du travail congolais. Le taux de participation à la population active est de 63% pour les femmes de 15 à 64 ans contre 69% pour les hommes de la même tranche d’âge selon l’OIT en 2021. L’estimation nationale du taux d’emploi des femmes de 15 ans et plus est de 58,9% en 2020 contre 64,9%. Les séries ne sont pas assez longues pour se faire une idée assez claire de l’évolution du tableau. En outre, selon les données de l’Enquête EGI-ODD de 2020, le taux de salarisation des femmes est de moins de 10% contre 20.5% pour les hommes. De plus, 76% des femmes employées touchent un salaire inférieur au SMIG contre seulement 58,6 pour les hommes.
Les travaux de Claudia Goldin, récompensés cette année par le Nobel d’économie, sur la situation des femmes sur le marché du travail peuvent servir de boussole. Ce Nobel a entre autres montré que la participation des femmes à l’emploi rémunéré n’est pas directement liée au cycle économique comme d’aucuns le pensaient à l’époque, mais dépend de facteurs plus structurels : la législation ; le niveau d’éducation ; la modification des attentes et des normes sociétales ; et le développement des moyens de contraceptions. Les différences de rémunération et de participation au marché du travail ne sont donc pas dues à des différences biologiques.
En matière de la législation, jusqu’il y a peu, la discrimination était présente. Cependant, depuis 2016, la révision du Code de la famille a supprimé plusieurs dispositions discriminatoires, notamment l’autorisation maritale pour la femme mariée, avec l’affirmation du principe de la participation et de la gestion concertées du ménage par les époux. Des évolutions en matière de régime matrimonial, d’accès à la succession, à la propriété sont également à noter. Le nouveau Code a aussi mis fin au régime de l’émancipation des enfants par le mariage et a ramené l’âge légal pour contracter le mariage à 18 ans. Cette révision a été précédée par l’adoption de la Loi n°15/013 du 1e août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité. Cette Loi promeut, quant à elle, notamment la participation et la représentation équitable de la femme et de l’homme dans la gestion des affaires de l’Etat et au sein des institutions nationales, provinciales et locales… Elle affirme la jouissance égale des droits et de l’accès aux possibilités et aux résultats, y compris aux ressources.
Curieusement, dans le marché du travail rural, supposé contraint par la tradition, la discrimination ne semble guère visible : selon les données de l’EGI-ODD de 2020, 50,1% des femmes sont en emploi dans le milieu rural contre 43,5% dans le milieu urbain. Cet avantage du milieu rural est perceptible également dans le secteur public et parapublic (36,3% dans le milieu rural contre 27,3% dans le milieu urbain) et dans le secteur privé formel (27,7% dans le milieu rural contre 26% dans le milieu urbain). Cette constatation se lit également dans le secteur informel : 51,1% dans le milieu rural contre 49,4% dans le milieu urbain. Cette différence ne peut s’expliquer en tout cas pas par les modifications de l’arsenal juridique. Si l’effet de cette discrimination, il y a, il serait donc en amont (sur les inputs qui exposent au marché du travail).
Le niveau d’éducation est le facteur de prédilection pour accéder fréquemment à l’emploi et bénéficier d’un salaire intéressant. A ce niveau, les inégalités sont criantes. 38% des femmes de plus de 15 ans n’ont aucun niveau d’études contre 25% chez les hommes de la même tranche. Si l’indice de parité du taux brut de scolarisation au primaire est de 0,93 en 2020, il n’est que de 0,73 au secondaire. A la fin des études secondaires, les femmes ne représentent que 39,5% des diplômés de l’examen d’Etat en 2019. Ces écarts s’accentuent dans l’enseignement supérieur avec 37,9% des jeunes femmes parmi les étudiants du Graduat, 34,7% au niveau Licence et seulement 15,8% pour les études au-delà de la licence. L’indice de parité décroit à mesure que le niveau de scolarité supérieure.
La culture et les normes sociales interviennent également pour expliquer l’inclusion ou l’exclusion d’individus sur le marché du travail. Au-delà d’une qualification faible comme indiquée précédemment, il existe une sorte de plafond de verre auxquelles les Congolaises font face. A titre indicatif, seules 13% des députés sont des femmes (contre 26% en Afrique), 25% des ministres sont au gouvernement central et 3 des 26 Gouverneurs des provinces sont des femmes. Les femmes ne représentent que moins de 14% des secrétaires généraux dans l’administration publique et 0% des DG des entreprises du portefeuille public sont des femmes.
Aussi, Claudia Goldin explique également la pénalisation de la femme par ce qu’elle appelle des « emplois cupides », des emplois vraiment demandant dont le salaire horaire croît avec le nombre ou le type d’heures prestées (soirée, week-end, vacances), précisément, car elles prennent la responsabilité de la famille. L’organisation de la société est telle que, pour l’instant, de manière générale les femmes, plus souvent que les hommes, s’occupent des enfants et du foyer. En RDC, selon les données de MICS-Palu 2018, 83% des tâches domestiques et 64% des soins prodigués aux enfants sont exécutés par les personnes du sexe féminin. 86% des personnes qui font la corvée d’eau sont des femmes, dont 11% ont moins de 15 ans. Elles sont 30% d’entre elles à marcher plus ou moins 30 minutes pour cette corvée. Cette réalité n’entrave pas seulement l’accès à l’éducation, elle dissuade également les enfants à finir les études, générant sans nul doute des externalités négatives.
Enfin, le développement des moyens de contraceptions. Celles-ci offrent à une femme un choix ; ce qui permet à celle-ci de poursuivre sa carrière (ou de fonder une famille). Car, les ruptures de carrière liées à la maternité tendent à creuser l’écart de rémunération, suggèrent généralement la littérature académique : les hommes et les femmes suivent des tendances parallèles avant de devenir parents, mais divergent fortement et de manière persistante après la parentalité. En RDC, la pénalité des enfants dans l’emploi ne semble pas exister, comme on peut le remarquer sur ce graphique, qui provient des travaux scientifiques de Henrik Kleven et al.
Graphique 1. Evolution de l’emploi des hommes et des femmes congolais par rapport à deux ans avant la naissance de leur premier enfant.
Source: Child penalty Atlas
Note : woman : femme et men : homme.
Si on ne dispose pas d’explication claire sur l’absence de pénalité en RDC, on ne doit pas négliger le fait que plus de 28% des femmes sexuellement actives et non mariées et près de 20% des femmes mariées ou en union libre utilisent des méthodes contraceptives modernes selon les données de MICS-Palu 2018. Comparé à la situation de 2010, le boom est stratosphérique, générant au passage des gains sur les carrières féminines, la qualité de vie, etc. En revanche, le bénéfice à en tirer pour le marché du travail congolais semble encore important vu que le taux d’accès aux moyens de contraceptions demeure encore relativement faible.
En définitif, le Nobel d’économie de cette année permet de célébrer le progrès de la femme dans le marché du travail et la femme qui a joué un rôle majeur dans la compréhension de la dynamique derrière. Il permet en particulier de mettre en exergue sommairement quelques avancées congolaises, mais également quelques challenges tant pratiques que scientifiques à relever pour continuer à réduire les inégalités du genre dans ce marché.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Congo Brazzaville, suivez Africa-Press