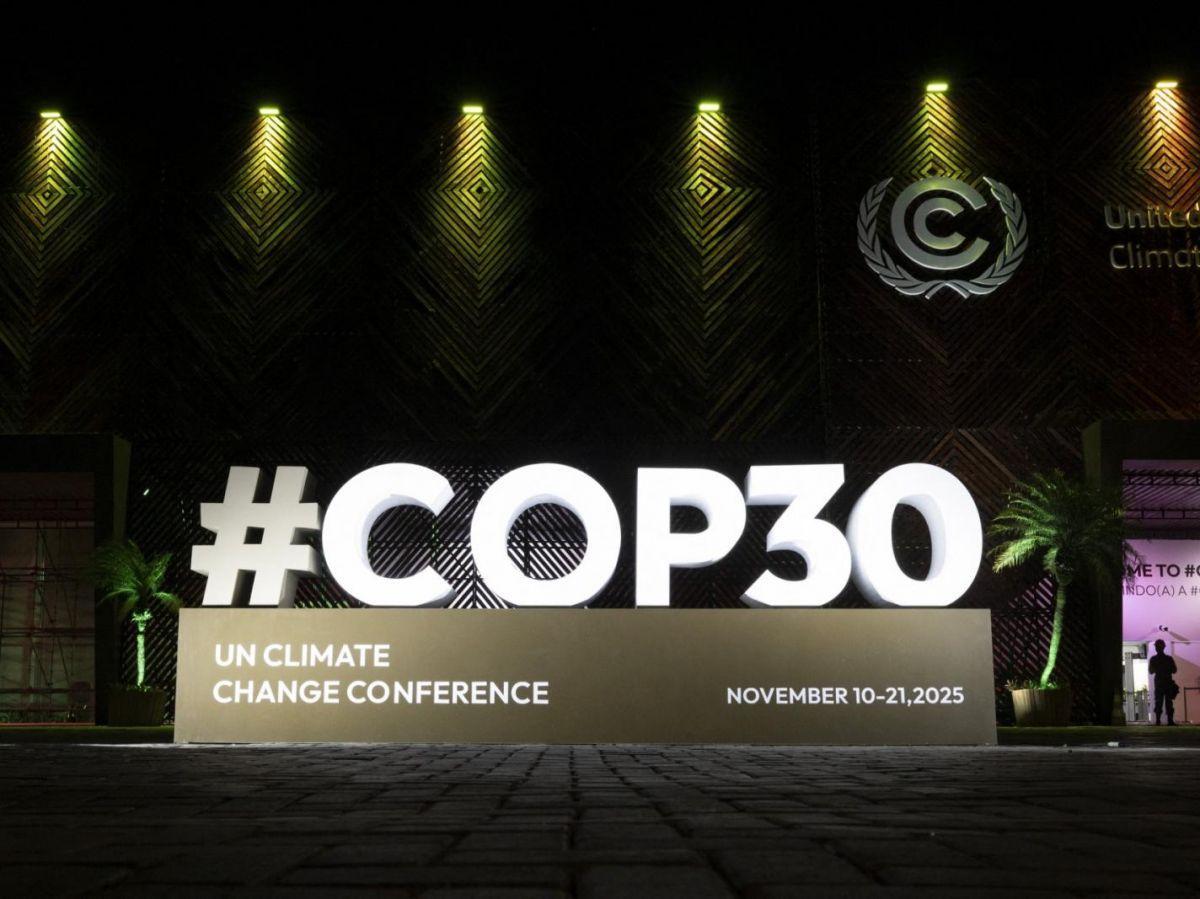Africa-Press – Congo Brazzaville. Le fort caractère symbolique de la « conférence des parties » qui se déroule à Belém du 10 au 21 novembre 2025 n’a pas échappé à André Aranha Correa do Lago. Celui qui va présider cette COP30 représente le Brésil aux négociations sur le changement climatique depuis quasiment l’adoption des conventions onusiennes sur le climat, la biodiversité et la désertification en 1992, à Rio de Janeiro, au Brésil déjà. Depuis la première COP climat à Bonn en 1995, c’est la trentième fois que le monde se donne rendez-vous pour trouver des solutions aux émissions de gaz à effet de serre. C’est aussi le dixième anniversaire de l’Accord de Paris qui charpente les discussions internationales depuis 2015. Enfin, cette COP se déroule aux portes de l’Amazonie, principal absorbeur de CO2 émis en excès par les activités humaines, mais épuisée par la déforestation, les sécheresses récurrentes et les incendies.
Cette COP30 marque une vraie inflexion. « En dix ans, tous les articles de l’Accord de Paris ont trouvé une traduction juridique si bien que désormais la communauté internationale a pour agir un cadre réglementaire adopté par tous », rappelle Paul Watkinson, ancien chef de la délégation française lors des précédentes COP. Le travail des négociateurs est à ce titre remarquable. En moins de dix ans, ils ont trouvé un terrain d’entente pour construire une « boîte à outils » sur les méthodes de mesures des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre de chaque État, les règles de transparence dans la collecte des résultats de leur « contribution déterminée au niveau national » (CDN) intégrant tous les secteurs économiques et leur transmission au secrétariat de la convention onusienne sur le climat. Un calendrier de mise en œuvre des actions d’atténuation des émissions avec un bilan mondial tous les cinq ans a été décidé. L’encadrement d’un marché mondial du carbone tenant compte des efforts de lutte contre la déforestation et de reforestation est en place. L’accord de Paris est en ordre de marche.
Une action collective constructive
Pour avoir passé des nuits à négocier, André do Lago sait qu’il faut désormais mettre l’accent sur l’action. Dans sa première lettre aux États signataires de la convention climat le 10 mars 2025 (il en a depuis écrit sept autres pour clarifier les intentions brésiliennes), le président de la COP30 se veut clairement volontariste: « 2025 doit être l’année où nous devons orienter notre tristesse et notre indignation vers une action collective constructive. Le changement est inévitable. Si le changement climatique n’est pas affronté, il nous sera imposé et détruira nos sociétés, nos économies, nos familles. Si au contraire, nous choisissons de nous organiser dans une action collective, alors nous avons la possibilité d’écrire un futur différent. ». Un constat partagé par Paul Wilkinson. « Les premières COP étaient essentiellement techniques, mais petit à petit tous les acteurs de la transition énergétique, industriels, économistes, pétroliers, ONG, collectivités ont pris l’habitude de venir aux COP pour faire part de leurs demandes ou de leurs colères, mais aussi pour partager leurs expériences et faire part de leurs échecs et succès », constate l’ex-négociateur.
En trente ans, ces rendez-vous annuels se sont ainsi transformés de réunions techniques entre diplomates en un événement mondial de grande ampleur. Des programmes se sont structurés comme le C40 Cities, qui vise à la neutralité carbone des grandes villes du monde, le programme « 4 pour 1000 » d’amélioration du stockage de carbone dans le sol par la transformation de l’agriculture, les programmes de réduction des fuites de méthane ou les alliances pour des transports décarbonés. « Ce sont ces différents acteurs qui doivent désormais être centraux », estime Paul Wilkinson. André do Lago a ainsi annoncé la mise en place d’un « multirao », une méthode issue des peuples autochtones brésiliens qui consiste à créer une communauté qui travaille à la réalisation d’une tâche commune.
Le respect de l’engagement des états devient un enjeu majeur
Pour ce faire, la mise en œuvre des « contributions déterminées au niveau national » devraient y aider. « C’est notre boussole », affirme André do Lago. Les CDN en sont à leur troisième mouture. Juste avant la COP, fin octobre, seuls 64 pays avaient remis la leur. Ce document technique détaille les actions que les gouvernements vont mener sur leur territoire dans tous les secteurs d’activité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc sortir des énergies fossiles. « L’un des principaux enjeux lors de ces dix jours, ce sera d’augmenter le niveau d’ambition des États pour que les annonces de réduction des émissions deviennent compatibles avec l’objectif de l’Accord de Paris, soit la limitation de l’augmentation de la température de la planète bien en dessous des 2°C », rappelle Mark Tuddenham, ingénieur au Citepa, l’organisme de collecte des données des polluants atmosphériques en France. Le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) publie ainsi tous les ans son « rapport sur le fossé » (gap report) reliant les baisses des émissions promises par les NDC avec la hausse de la température mondiale. Le rapport 2025 estime qu’en leur état actuel, les NDC amenaient à une augmentation de 2,3 à 2,5°C d’ici à la fin du siècle.
L’empreinte carbone des pays reflète les niveaux de développement. En vert, les pays en phase avec un accroissement des températures de 0,5°C, en rouge, ceux qui sont sur une hausse de 6,5°C. © Iceberg data lab
Le rapport 2025 du PNUE a du faire face à de nombreuses incertitudes. Les NDC européenne, chinoise et indienne n’ont pas encore été remises au secrétariat de la convention climat. L’engagement des États-Unis a été fourni par l’administration démocrate de Joe Biden. Dès son entrée en fonction le 21 janvier 2025, son successeur Donald Trump a retiré son pays de l’Accord de Paris. Aucun responsable américain de haut niveau ne fera d’ailleurs le voyage à Bélem. La COP30 devra donc être l’occasion de faire un point précis sur l’état d’engagement de l’ensemble des pays. Pour rappel, à Dubai en 2023, lors de la COP28, les 195 États ont admis consensuellement qu’il leur fallait sortir des énergies fossiles.
Le secteur des énergies fossiles continue de forer
Pour nombre d’observateurs en effet, il y a urgence à entamer une nouvelle réflexion sur les enjeux de la transition énergétique, notamment des obstacles à la sortie des énergies fossiles. Et cela impose de conduire une trajectoire pour chaque pays, selon une note de l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri/Sciences po Paris). « Comprendre comment chaque type d’énergie fossile est utilisée dans les contextes nationaux et à l’intérieur de chaque secteur économique ainsi que le chemin de transition qui doit être emprunté est essentiel pour la réussite de la sortie des énergies fossiles », écrivent les auteurs. Cette démarche implique la coopération de tous les secteurs économiques, notamment du secteur pétrolier et gazier qui, en toute logique, devrait préparer la réduction de son activité dans les quinze ans qui viennent. Or, l’exploration de nouveaux gisements continue et de nouveaux champs pétrolifères et gaziers entrent en exploitation. Le réseau d’ONG Climate Action Network (CAN) a ainsi mené une expertise accablante des NDC des pays producteurs. « Sans exception, tous les pays producteurs d’énergie fossiles que nous avons analysés ont échoué à inclure une trajectoire de sortie de leur production dans leur NDC. Cela inclut l’Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Royaume-Unis, le Brésil et la Russie. » Hôte de la COP, le Brésil est ainsi épinglé pour son autorisation d’exploration de gisements off-shore au large de l’Amazonie. Pourtant, en toute logique, les investissements effectués en 2025 dans les secteurs pétroliers et gaziers devront arrêter leur activité dans moins de 20 ans, soit bien avant que les sommes investies soient rentabilisées.
Une opinion publique mondiale en recul sur la question climatique
Ces questions feront l’objet de débats houleux jusqu’en 2028, année où la communauté internationale devra faire un bilan global de son action climatique depuis 2023. Et saura alors plus précisément si la trajectoire empruntée est suffisamment ambitieuse. Ces questions, qui auparavant étaient traitées dans les couloirs des COP, deviennent désormais centrales avec la mise en application des NDC. La COP30 est donc la première où la communauté internationale se retrouve vraiment au pied du mur.
Ce rendez-vous crucial se déroule cependant dans une ambiance très peu favorable. Les tensions géopolitiques (guerre en Ukraine, Palestine notamment) ont relégué au deuxième plan la question climatique. Selon un sondage Ipsos mené dans 50 pays auprès de 40 000 personnes, les guerres et les conflits dominent les craintes (à 52%), le changement climatique (à 31%) n’arrivant qu’en troisième position derrière les difficultés économiques. Les préoccupations environnementales ont perdu 20 points au sein des opinions publiques entre 2022 et 2025. La lutte contre le changement climatique traverse une passe vraiment difficile. La conclusion de cette COP30 sera donc attentivement scrutée.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Congo Brazzaville, suivez Africa-Press