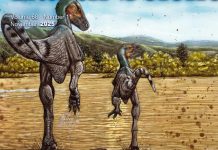Africa-Press – Guinee Equatoriale. Les anomalies gravitationnelles détectées dans le système solaire sont à l’origine de découvertes parfois spectaculaires. Ainsi, dès 1788, astronomes et mathématiciens constatent que l’orbite de la planète Uranus, récemment découverte, ne colle pas avec les prédictions. Plus le temps passe et plus celle-ci s’éloigne de la trajectoire prédite.
A tel point qu’en 1821, l’astronome français Alexis Bouvard publie de nouvelles tables censées prédire plus exactement la course d’Uranus autour du Soleil en prenant en compte l’influence gravitationnelle de Jupiter et de Saturne. Mais là aussi rien ne se passe comme prévu : il persiste un écart entre prédictions et observations. Face à cette incohérence, Bouvard conclut qu’une planète “transuranienne” doit exister et qu’elle bouleverse le comportement d’Uranus.
Des mathématiciens célèbres tels que François Arago ou Urbain Le Verrier ont souscrit à cette thèse et affiné les calculs pour préciser la position de cet hypothétique astre. Finalement, le 23 septembre 1846, s’appuyant sur les derniers résultats de Le Verrier, Johann Gottfried Galle, astronome allemand, observe ladite planète : Neptune.
Des bizarreries au-delà de Neptune
Aujourd’hui, il faut voyager encore plus loin dans le système solaire externe, entre 100 et 1000 ua (une unité astronomique équivaut à la distance Terre-Soleil, soit quelque 150 millions de km), dans la ceinture de Kuiper et jusqu’au nuage d’Oort pour étudier d’autres anomalies orbitales.
Cette région est le lieu de résidence de centaines de petits objets gelés appelés KBOs (Kuiper Belt Object) qui évoluent sur des orbites elliptiques très éloignées du Soleil. Tous ces objets obéissent à deux règles : leur demi grand-axe est d’environ 150 ua et lorsqu’ils s’approchent au plus près du Soleil, leur orbite a une inclinaison proche de 0 ou 180 degrés par rapport au plan du système solaire.
Mais 13 d’entre eux dérogent à la règle. Leur demi-grand axe va en effet de 150 à 525 UA, avec des inclinaisons moyennes d’environ 20 degrés. Ces anomalies sont interprétées par certains scientifiques comme les conséquences de la présence de corps massifs, une ou plusieurs planètes, des dizaines de fois plus éloignés que ne l’est Neptune du Soleil.
Mais pour Harsh Mathur, professeur de physique à l’Université Case Western Reserve, et Katherine Brown, professeure agrégée de physique au Hamilton College, à Clinton, Etats-Unis, cette hypothèse n’est pas la seule qui pourrait expliquer l’orbite de ces KBOs.
L’apport du physicien israélien Mordehai Milgrom
Mathur et Brown convoquent, eux, une mystérieuse masse fantôme du système solaire, un concept émanant de la théorie MOND (théorie de la dynamique newtonienne modifiée). Introduite dans les années 1980 par le physicien israélien Mordehai Milgrom, elle stipule que la loi de gravitation devient plus forte que ce que Newton nous a appris dans la limite de la faible accélération, tendant vers une dépendance de 1/r au lieu de la fameuse loi en carré inverse (1).
Cette théorie est actuellement en vogue car elle permet de se passer de la matière noire pour expliquer le mouvement des étoiles dans les galaxies et celui des galaxies dans l’Univers.
La masse fantôme du système solaire
La masse fantôme n’est pas vraiment une masse réelle mais un terme mathématique dans une équation : “L’idée clé de la masse fantôme est que si la force gravitationnelle diminue plus faiblement avec la théorie MOND, cela est mathématiquement analogue au fait que la force est plus forte. La seule façon pour que la force soit plus forte dans la gravité newtonienne (en supposant que les distances restent constantes) est qu’il y ait une masse supplémentaire. La masse supplémentaire qui serait requise par la gravité newtonienne pour imiter les effets de MOND est nommée masse fantôme”, explique Katherine Brown.
Une autre façon d’exprimer ce concept est de considérer que lorsque l’accélération gravitationnelle prédite par la loi de Newton devient suffisamment faible, la théorie MOND permet à un comportement gravitationnel différent de prendre le relais. Pour le système solaire, ce comportement implique de tenir compte, en plus du champs gravitationnel du Soleil, de celui de la Voie lactée.
Les deux scientifiques se sont donc demandés si les anomalies des KBOs pouvaient être interprétés comme une preuve de ce comportement différent. Dans leur étude, publiée dans la revue The Astronomical Journal, ils démontrent que la théorie MOND décrit précisément le regroupement observé des KBOs utilisés pour inférer l’existence d’une neuvième planète.
“Il est important de noter que les anomalies orbitaires sont abordées de différentes manières dans la littérature. Par exemple, certains chercheurs pensent que les anomalies sont fallacieuses, résultant d’un biais d’observation. Il est également important de souligner que nous n’avons étudié qu’un très petit sous-ensemble de KBO connus”, prévient Katherine Brown.
La théorie MOND étudiée dans le système solaire
Ce résultat ne signifie pas non plus que la théorie MOND soit exacte et donc qu’il faut enterrer les théories de la gravitation de Newton et d’Einstein. “Ce que nous avons démontré c’est que la théorie MOND explique le regroupement physique de ces quelques objets par l’effet de champ externe de la Voie lactée. Mais l’hypothèse de la neuvième planète aboutit aux même conclusions”, souligne la physicienne. “Ces travaux mettent surtout en évidence le potentiel du système solaire externe à servir de laboratoire pour tester la gravité et étudier les problèmes fondamentaux de la physique”, se réjouit-elle.
Prochaine étape : réaliser des simulations numériques encore plus précises des objets étudiés dans cette publication. Et aussi étudier des astres encore plus lointains : “MOND devrait également avoir des effets notables sur le nuage d’Oort qui est considéré comme un nuage à peu près sphérique d’objets glacés beaucoup plus éloigné du Soleil que la ceinture de Kuiper et qui pourrait être la source de comètes à longue période” estime Katherine Brown.
Enfin, l’analyse très fine des trajectoires des sondes qui se sont aventurées le plus loin dans le système solaire comme les sondes Voyager 1 et 2, Cassini ou New Horizons pourrait aussi révéler des anomalies liées à la théorie MOND.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinee Equatoriale, suivez Africa-Press