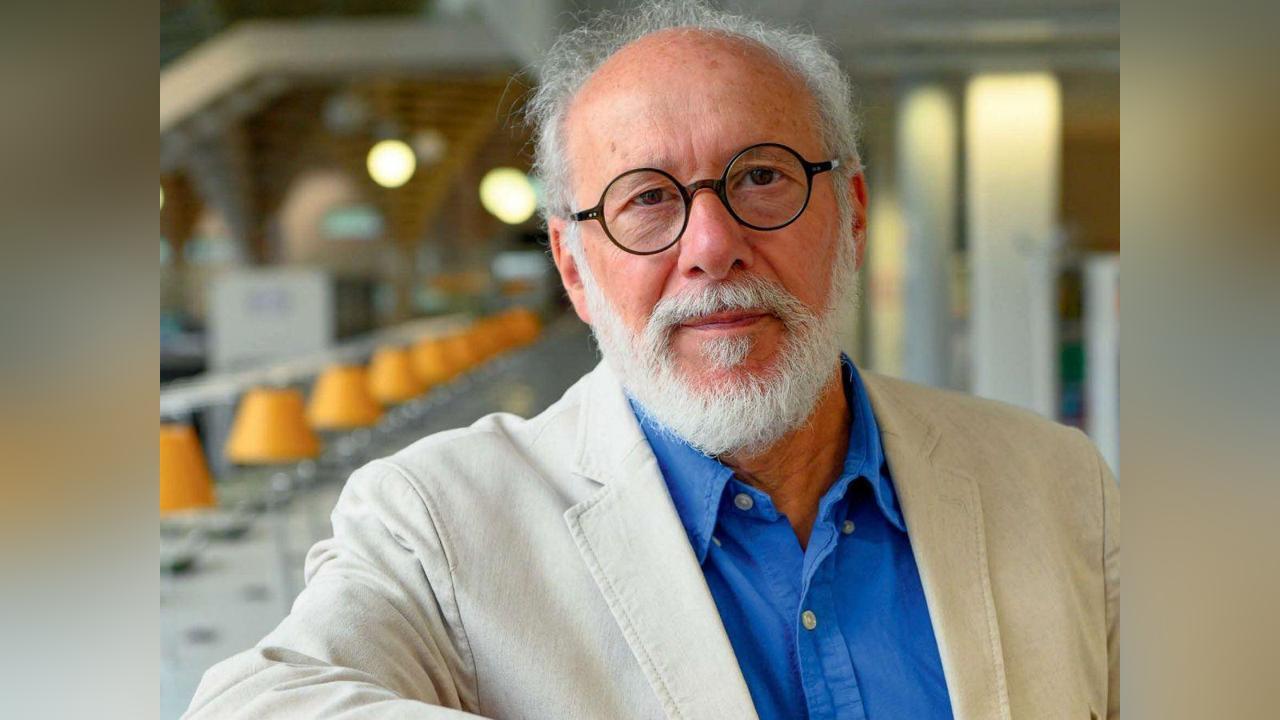Africa-Press – Mali. Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE) depuis 2001, Francis Eustache a enseigné à l’université de Caen-Normandie où il a dirigé l’unité de recherche Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine. Il a également été directeur du Centre d’imagerie et de recherches en neurosciences Cyceron, de 2012 à 2016.
Depuis 2013, il est président du conseil scientifique de l’Observatoire B2V des mémoires. Il codirige, avec l’historien Denis Peschanski, le programme de recherche transdisciplinaire 13-Novembre, dont l’objectif est d’étudier la construction et l’évolution des mémoires après les attentats de novembre 2015.
Les Dossiers de Sciences et Avenir: Vous travaillez depuis plus de trente ans sur la mémoire. Quelle définition en donneriez-vous aujourd’hui?
Francis Eustache: Pour parler de façon très générale, c’est un ensemble complexe de processus mentaux qui interagissent les uns avec les autres et rendent possibles l’encodage (l’enregistrement), la conservation, et la restitution – ou rappel – d’informations. Parmi celles-ci, il y a le souvenir, une construction singulière qui renvoie à un événement en théorie unique, vécu par un individu qui, lorsqu’il évoque cette représentation, a l’impression de revivre l’événement tout en sachant qu’il appartient au passé. Évidemment, un souvenir est plus qu’une information. C’est un trésor !
Les Dossiers de Sciences et Avenir: Quels sont les autres types d’informations?
Par exemple des connaissances générales, fabriquées au fil du temps, sur le monde – la mémoire sémantique – mais aussi sur soi, ce qu’on appelle la sémantique personnelle. Cela renvoie à la question de l’identité: je me définis beaucoup plus par des connaissances générales que par des souvenirs. Mes souvenirs viennent en quelque sorte ponctuer mon identité. Le lien entre mémoire sémantique personnelle et souvenirs, c’est un peu comme ce gâteau qu’on appelle forêt-noire: les cerises seraient les souvenirs, posées sur le gâteau blanc et noir qui représenterait les connaissances ! À la nuance près que les souvenirs vont évoluer, sans disparaître totalement.
« Je me définis bien plus par des connaissances générales que par des souvenirs. Ceux-ci viennent, en quelque sorte, ponctuer mon identité »
Les Dossiers de Sciences et Avenir: La mémoire n’est donc pas un simple espace de stockage à l’identique?
Surtout pas. Quand j’évoque un souvenir, je le fais en résonance avec mon état d’esprit, mes projets, les personnes avec qui j’interagis… La mémoire est une série d’équilibres, conscients ou non, entre la véracité – je dois être proche de la réalité, sinon mon entourage ne me fera plus confiance – et la nécessité de puiser les éléments utiles en fonction de la situation et de mes objectifs, qui me projettent vers le futur. C’est un jeu complexe entre le présent et le futur, alimenté par le passé.
Les Dossiers de Sciences et Avenir: Il y a encore d’autres types de mémoire?
Par exemple celle des savoir-faire – dite procédurale -, qui sont moins des représentations que des mémoires d’action, parfois très sophistiquées: faire du vélo ou conduire une voiture, mais aussi réaliser les gestes de l’artisan ou du sportif de haut niveau, très précis et qui se perfectionnent encore au fur et à mesure.
Et dans tout cela, il faut injecter la notion de temps, la différence entre les mémoires à long terme et la mémoire de travail. Celle-ci n’est pas simplement passive: les informations sont manipulées, selon divers processus complexes en lien avec notre raisonnement et les représentations à long terme.
Les Dossiers de Sciences et Avenir: Et là, on a fait le tour de ce qu’est la mémoire?
Non ! Il manque notamment les interactions avec les mémoires collectives et sociales. Jusqu’à il y a une quinzaine d’années, les psychologues et les neuro-scientifiques ne se préoccupaient que de la mémoire individuelle. Il a fallu attendre la fin des années 2000 pour voir émerger des travaux soulignant l’importance des relations sociales dans la mémoire, ce qu’on a qualifié de mémoire collective.
Le psychologue américain Alin Coman a montré que dans un groupe, les prises de parole des uns et des autres influencent la mémoire de chacun des individus qui forment ce groupe. Cela me rappelle la réflexion de mon ami, aujourd’hui disparu, le philosophe Bernard Stiegler à qui je montrais des résultats d’imagerie cérébrale: « C’est intéressant, me disait-il avec un regard espiègle, mais la mémoire n’est pas dans le cerveau, elle est entre les cerveaux. »
Quant à la mémoire sociale, elle transcende les individus et agit sur eux de haut en bas: au sein d’une culture, nous sommes baignés dans des connaissances qui nous viennent de notre famille, de l’école, des médias, des commémorations…
Les Dossiers de Sciences et Avenir: Cela paraît assez évident…
De fait… Le sociologue Maurice Halbwachs l’avait écrit il y a un siècle dans un livre merveilleux, Les Cadres sociaux de la mémoire. Il a compris que dans notre lien avec la mémoire, même totalement seuls, nous ne sommes jamais seuls. Quand vous encodez une information, vous l’encodez dans un certain contexte, spatial, temporel, certes, mais aussi social. Et quand vous rappelez cette information, vous avez toujours un destinataire, même si ce n’est que vous-même: vous rappelez avec un certain objectif, et cela change tout dans la représentation de l’objet mémoire.
Une autre dimension des études actuelles sur la mémoire concerne l’identité narrative: la mémoire évolue quelque part dans notre esprit/ cerveau, mais elle s’exprime d’une certaine façon, ce qui est une autre affaire. Et il faut donc trouver des outils pour comprendre comment, à partir d’un récit, on peut accéder à des processus de fabrication de sens, de raisonnement autobiographique, et comment on peut aider une personne malade, ou qui vieillit, à se raconter.
Dans les recherches de mon équipe, ce qui nous anime aujourd’hui, c’est de tenir compte de ces différentes strates – individuelle, collective, sociale – et de la manière dont elles se nourrissent les unes les autres.
Les Dossiers de Sciences et Avenir: Comment étudiez-vous ces enchevêtrements de mémoire?
Par exemple, en 2019, avec le chercheur en neurosciences Pierre Gagnepain et l’historien Denis Peschanski, nous avons réalisé une étude – publiée dans Nature Human Behavior – sur la mémoire individuelle et collective (on dirait aujourd’hui sociale) de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons montré à de jeunes participants des photos légendées, plus ou moins emblématiques de la mémoire sociale de la guerre. Deux jours plus tard, sous IRM, nous leur avons demandé de reconnaître des morceaux de phrases correspondant, ou non, à ce qu’ils avaient vu dans la première phase de l’étude.
Eh bien, ils se souvenaient beaucoup mieux des items très marquants pour la mémoire française. De plus, nous avons vu s’activer plus spécifiquement leur cortex préfrontal dorso-médian, spécialisé dans la cognition sociale: leur mémoire était en quelque sorte façonnée par la mémoire sociale. Si l’on m’avait parlé dix ans auparavant de représentations cérébrales de la Seconde Guerre mondiale, si l’on m’avait dit qu’on pourrait montrer, dans le fonctionnement du cerveau, des indicateurs de ces liens entre mémoire sociale et souvenirs personnels, je n’y aurais tout simplement pas cru !
« Il faut trouver des outils pour savoir comment aider une personne malade, ou qui vieillit, à se raconter »
Les Dossiers de Sciences et Avenir: Une piste que vous avez poursuivie avec le programme 13-Novembre que vous codirigez actuellement?
Les mémoires des attentats du 13 novembre 2015 s’écrivent depuis maintenant près de dix ans. L’une de nos études, qui s’appelle l’étude 1000, interroge à intervalles réguliers (2016, 2018, 2021, 2026), avec des entretiens filmés, mille personnes témoins, victimes directes, ou au contraire non impliquées dans les attentats. Les récits des participants sont soigneusement analysés, ce qui permet de comprendre comment ils évoluent au fil du temps.
Parmi ces personnes, l’étude Remember étudie plus spécifiquement 200 participants, qui bénéficient de divers examens de neuropsychologie, de psychopathologie et de neuroimagerie. Quand nous avons mis en place ces études, en 2016, nous étions persuadés qu’elles allaient apporter des connaissances nouvelles sur le trouble de stress post-traumatique (PTSD). Comprendre comment ce bouleversement émotionnel perturbe la mémoire nous semblait indispensable pour aider les patients qui en souffrent.
Ce programme avait aussi pour objectif d’analyser le fonctionnement de la mémoire sociale: pour le 13-Novembre, on parle souvent des attentats du Bataclan. Et l’on oublie les victimes des terrasses de café, celles des abords du Stade de France… Cela a des retombées cliniques, car pour ces personnes, c’est un peu la double peine: il y a les victimes reconnues et les autres. Or l’ingrédient majeur de la résilience, c’est le soutien des proches, de la famille, et pour un événement à grande échelle, celui de la société tout entière.
Les Dossiers de Sciences et Avenir: Vous avez été un des pionniers de l’utilisation de l’imagerie cérébrale pour étudier la mémoire. Qu’est-ce que cette technique a apporté?
Dans les années 1990, il y avait une sorte de dissonance entre des travaux psychologiques très riches, mais sans lien avec le cerveau, et l’imagerie cérébrale alors à ses débuts. Il fallait tenter de fusionner les deux, et de comprendre à la fois le fonctionnement du sujet sain et des pathologies cérébrales par ce double prisme.
J’ai vraiment vécu cela, parce que Cyceron, le centre d’imagerie de Caen que j’ai dirigé par la suite, a été l’un des dix premiers au monde. Ce furent les prémices de l’imagerie cognitive d’activation: une tâche est proposée à un sujet et l’imagerie permet de visualiser les différentes régions du cerveau impliquées. Mais dans nos premières expériences consacrées à la mémorisation, on ne « voyait » pas une petite zone du cerveau, l’hippocampe, alors qu’on savait depuis longtemps qu’elle joue un rôle majeur dans la mémoire. La raison, c’est que même sans rien faire de spécial, le sujet ne peut s’empêcher de mémoriser… Quand les méthodes se sont raffinées, nous avons retrouvé l’hippocampe !
En se perfectionnant, l’imagerie a permis par exemple une approche scientifique de la maladie d’Alzheimer et des maladies neurodégénératives et de ne plus parler de démence, de gâtisme… C’est en cela que je n’ai jamais été d’accord avec mes collègues psychologues expérimentalistes qui considéraient que l’imagerie cérébrale était simpliste et que c’était la méthode expérimentale de la psychologie qui survivrait. Même si j’acceptais les critiques et les simplifications outrancières de l’imagerie cérébrale, comme si l’on allait pouvoir « voir la mémoire »…
Les Dossiers de Sciences et Avenir: Y a-t-il des personnes qui ont plus de mémoire?
Il y a certainement des différences interindividuelles, comme il y a des grands et des petits, liées à nos origines, notre alimentation quand on était enfant… Il y a vingt ou trente ans, par exemple, les femmes étaient davantage affectées par la maladie d’Alzheimer que les hommes, et l’on ne savait pas pourquoi. Mais cette différence s’est estompée par la suite parce qu’à un moment donné, parmi les personnes en âge d’être atteintes par la maladie, sont arrivées les petites filles nées après la guerre de 1914-1918 et qui étaient allées à l’école, contrairement à leurs mères. Or l’éducation joue un rôle protecteur majeur sur la mémoire.
Mais à côté de cela, il y a une autre réponse: c’est quoi, une bonne mémoire? Est-ce celle du mnémoniste qui vous épate sur scène? Celle de la personne qui a une grande culture générale? Celle du commentateur incollable sur son sport préféré? J’ai un collègue -excellent neurologue par ailleurs ! – qui connaît tous les horaires de train. Il dépasse l’Hexagone, vous pouvez lui demander les horaires du Milan-Paris…
Les Dossiers de Sciences et Avenir: Le développement de l’intelligence artificielle, des écrans, risque-t-il de nous faire perdre la mémoire?
C’est un changement d’environnement majeur pour la mémoire, et pour la cognition tout entière. Le problème se pose surtout pour les enfants et les adolescents, qui n’ont pas connu autre chose. Pour les plus âgés, c’est plutôt stimulant d’avoir recours à l’ordinateur, qui permet de maintenir le contact avec la société.
« Ce qui amplifie la mémoire, c’est la projection dans le futur. L’envie de changer le monde, de s’engager… »
Les Dossiers de Sciences et Avenir: Mais physiologiquement, le cerveau est-il modifié?
La réponse est plus complexe qu’il n’y paraît. L’enfant ou l’ado qui, pendant les vacances, va passer huit heures par jour sur un écran, est-ce que cela aura un effet sur sa mémoire, sur sa cognition, ou plus généralement sur sa physiologie parce que qu’il grignote des cacahuètes et que, pendant ce temps, il ne va pas jouer au foot avec ses copains? Il ne faut pas diaboliser, mais prendre conscience des problèmes. On sait déjà qu’il y en a pour la vue, car les écrans ont des effets négatifs sur les cellules de la rétine. Et le sommeil est perturbé ; or la consolidation des souvenirs se fait en grande partie pendant le sommeil.
Et puis, il y a un problème presque plus philosophique. La mémoire, si l’on revient aux définitions que l’on a données, c’est l’intrication de mécanismes qui permettent de former des contenus qui vont évoluer au fil du temps, en fonction de différentes contingences. C’est une fonction compliquée, et cette fonction, elle est dans notre tête. Même si elle se modifie en interaction avec les autres, au bout du compte, notre mémoire individuelle doit passer par nous. Votre libre arbitre, c’est vous. Mais si je délègue tout à des mémoires externes, en poussant à l’extrême, que reste-il de mes capacités de synthèse? C’est un problème pour notre mémoire et même pour notre identité personnelle. Les réseaux sociaux changent la façon dont se construisent les mémoires collectives, les interactions. Et si l’on n’y prend pas garde, l’intelligence artificielle va continuer le travail de sape de notre mémoire.
Ce qui guide la mémoire, ce qui l’amplifie, c’est la projection dans le futur, un futur plausible. Nombre d’études montrent qu’elle est aujourd’hui moins présente, notamment du fait de l’éco-anxiété, qui peut faire baisser les bras. Mais celle-ci peut aussi donner envie de changer le monde, de le protéger, de s’engager. Le philosophe Henri Bergson l’écrivait déjà à propos de la mémoire: « Il faut pouvoir s’abstraire de l’action présente, il faut savoir attacher du prix à l’inutile, il faut savoir rêver. » Soyons positifs, rêvons du futur !
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press