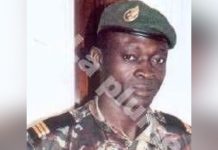Africa-Press – CentrAfricaine. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir… »: qu’elles soient chantées par Pascal Danel, contées par Ernest Hemingway dans sa célèbre nouvelle de 1936, ou qu’elles tapissent les arrière-plans du Roi lion, d’Out of Africa ou de documentaires animaliers, les « neiges du Kilimandjaro » imprègnent notre imaginaire sur les paysages est-africains. Leur fonte est même régulièrement médiatisée et utilisée pour interpeller sur le dérèglement climatique en Afrique subsaharienne.
Mais alors qu’aujourd’hui, la disparition des neiges du Kilimandjaro effraie, tant elles paraissaient éternelles au 20e siècle, peu savent que leur existence fut un jour âprement contestée. Et quand cette histoire est racontée, elle se résume souvent à ces quelques lignes: en 1848, un missionnaire allemand rapporte pour la première fois en Europe une description du Kilimandjaro et de ses neiges ; mais un géographe londonien refuse catégoriquement de croire à leur existence, sans s’être rendu lui-même sur place. Un fait divers plaisant, en somme, où l’incrédulité d’un homme est tournée en dérision tant il est désormais évident que les neiges du Kilimandjaro existent bel et bien. Et pourtant, il s’agit là d’une véritable controverse géographique qui dura plus de dix ans et anima une large part de la communauté savante européenne au milieu du 19e siècle.
Pourquoi l’existence des neiges du Kilimandjaro put-elle être contestée pendant si longtemps ? Et comment fut-elle finalement prouvée ? Ce sont des questions qui intéressent tout particulièrement les historiens des sciences, qui voient dans les controverses savantes l’occasion de comprendre comment se construisent les connaissances et comment s’administre la preuve. Car ces controverses, que ce soit dans leurs causes, leur développement ou leur résolution, se nourrissent rarement d’arguments purement scientifiques mais sont le plus souvent sous-tendues par d’autres enjeux: sociaux, économiques, politiques, etc. Le cas des neiges du Kilimandjaro est à ce titre exemplaire.
Tout commence en 1849 quand un géographe britannique, Charles Beke, annonce la découverte d’une montagne enneigée en Afrique de l’Est – il relaie le récit de voyage d’un missionnaire, Johannes Rebmann, qui s’est récemment rendu dans la région. Cette découverte, affirme Charles Beke, va permettre de lever le grand mystère des sources du Nil. Au 2e siècle, Ptolémée, dans sa Géographie, ne dit-il pas que le Nil prend sa source au pied de montagnes enneigées – les fameux « monts de la Lune » ? Et Johannes Rebmann ne s’est-il pas rendu aux abords du « Monomoezi », un nom que Charles Beke identifie comme swahili et pense pouvoir traduire par « royaume de la Lune » ? Le récit de Johannes Rebmann aurait pu passer inaperçu, mais l’intérêt que Charles Beke lui porte et le rapprochement qu’il fait entre le Kilimandjaro et le Nil le précipitent de manière inattendue au premier plan de la scène géographique, et, dès lors, sous le feu des critiques.
L’absence de mesures nuit à la crédibilité du récit du missionnaire
Dans les années 1840, Johannes Rebmann et son collègue Johann Ludwig Krapf sont les premiers Européens à s’être installés durablement sur la côte est-africaine, à Mombasa, et à se rendre dans l’intérieur, qui n’a pas encore été exploré par les Occidentaux. Mais leur objectif est d’évangéliser le continent. Et c’est avant tout de cela que parle le récit de Johannes Rebmann, ainsi que de ses rencontres avec les sociétés est-africaines.
Il décrit aussi son itinéraire et les paysages marquants, mais sans jamais s’y attarder. Le 11 mai 1848, il a ainsi observé une très haute montagne, surmontée de quelque chose de « remarquablement blanc « . S’agit-il d’un nuage ? Le missionnaire est très myope, mais après quelques pas, il en est sûr: le sommet de la montagne est recouvert de neiges éternelles. Si Johannes Rebmann rend grâce à Dieu en lisant le psaume du jour face à l’immense massif, dont son guide lui dit qu’il s’agit du Kilimandjaro, il ne commente pas davantage la montagne. Parti seulement armé de sa Bible et de son parapluie, il n’a pas avec lui d’instruments de mesure lui permettant par exemple d’en estimer la hauteur.
C’est précisément l’absence de telles précisions qui va nuire à la crédibilité du récit de Johannes Rebmann. Après tout, il n’est qu’un missionnaire anonyme, inconnu de la scène géographique européenne. Or, face à lui s’élève un autre géographe, plus influent encore que Charles Beke: William Cooley, l’un des membres les plus anciens et les plus actifs de la prestigieuse Royal Geographical Society fondée en 1830 à Londres. Il reproche à Johannes Rebmann ses descriptions extrêmement allusives du Kilimandjaro. Surtout, le fait que Johannes Rebmann soit myope (et pourtant si prompt à affirmer que ce qu’il avait pris au loin pour un nuage était en réalité un manteau neigeux – éternel de surcroît) rend William Cooley encore plus sceptique. Non seulement le phénomène serait parfaitement inédit par rapport aux connaissances occidentales sur l’Afrique subsaharienne, mais en plus, une telle précipitation tranche avec la minutie à laquelle William Cooley est habitué, rendant les dires du missionnaire particulièrement invraisemblables à ses yeux.
William Cooley est en effet un géographe de cabinet, c’est-à-dire un savant qui réunit, recoupe et synthétise depuis son bureau toutes les informations qui lui parviennent sur un espace donné. Ces pratiques sédentaires le tiennent certes éloigné du terrain, mais sont alors très prisées de ses contemporains qui estiment qu’elles constituent la meilleure manière de construire un savoir par le recul qu’elles permettent. À cela s’ajoute le fait que Charles Beke a relayé le récit de Johannes Rebmann dans un contexte pour le moins douteux: il est en train de monter une expédition pour l’Afrique de l’Est et tente de lever des fonds. Aussi, l’annonce triomphale de la découverte d’une montagne enneigée dans cette région précise a tout du coup publicitaire pour une expédition qui se promet justement de trouver les sources du Nil…
William Cooley y est d’autant plus sensible qu’il redoute de voir sa notoriété mise à mal. Charles Beke pourrait bien lui voler la vedette s’il venait à résoudre une question aussi importante que celle des sources du Nil. Bref, aux arguments savants se mêlent d’autres enjeux. Car s’il a de bonnes raisons de douter d’un récit a priori peu vraisemblable et visiblement instrumentalisé par un autre géographe, William Cooley devient particulièrement virulent par crainte de se voir supplanté par les dires d’un obscur missionnaire.
Faute de preuve suffisante, une théorie alternative est avancée
Dans les années 1850, il multiplie ainsi les articles et ouvrages à charge contre Johannes Rebmann. Le missionnaire et ses soutiens essaient bien de contre-argumenter, en reprenant à leur compte les codes discursifs de la géographie savante, mais l’autorité qu’exerce William Cooley instille durablement le doute. Même Charles Beke, dont l’expédition a échoué, se met en retrait – tout comme la Société de géographie de Paris qui avait pourtant, en 1852, récompensé les explorations de Johannes Rebmann et Ludwig Krapf en leur attribuant sa Grande Médaille d’argent.
Dans le même temps, les missionnaires sont contraints d’abandonner leur station est-africaine et ne peuvent retourner au Kilimandjaro. Aussi, faute de preuve supplémentaire, une théorie alternative est avancée en 1857 par Roderick Murchison et Heinrich Barth, deux savants proches de William Cooley, qui s’inspirent de David Livingstone et de ses voyages récents réalisés plus au sud dans la région: la blancheur du sommet du Kilimandjaro serait due à des roches de quartz blanc ou calcaires !
C’est finalement une expédition qui règle la question en 1861. Non, le Kilimandjaro n’est pas la source du Nil, mais il est bel et bien enneigé – les cercles savants européens en sont désormais définitivement convaincus. Pourquoi ? Tout simplement parce que les deux explorateurs qui mènent l’expédition sont Carl Claus von der Decken, un aristocrate, et Richard Thornton, un géologue, tous deux bien insérés dans les sociétés de géographie et reconnus par elles.
Concrètement, ils ne prouvent d’aucune manière l’enneigement du Kilimandjaro. Mais ils ont pris d’autres mesures – thermométriques, barométriques, hypsométriques… -, et ces pratiques seules suffisent à convaincre la communauté savante. Il faut dire qu’au début des années 1860, la géographie de cabinet est de plus en plus décriée au profit de la géographie dite de plein vent, c’est-à-dire celle que les explorateurs pratiquent sur le terrain. Les connaissances qu’ils rapportent de leurs expéditions sont de plus en plus valorisées par rapport à celles que les géographes tels que William Cooley compilent en restant assis à leur bureau.
Et pendant que William Cooley sombre peu à peu dans l’oubli (il meurt en 1883 dans la plus grande indifférence), le Kilimandjaro accède à la célébrité et devient le but de nombreuses nouvelles expéditions d’exploration. En grande partie grâce à cette controverse, qui a fait couler tant d’encre pendant plus d’une décennie, ses neiges deviennent emblématiques. De fait, d’autres hautes montagnes enneigées ont été observées par la suite en Afrique de l’Est, mais les neiges du mont Kenya ou des monts Rwenzori n’ont jamais suscité la même fascination que celles du Kilimandjaro.
Le Kilimandjaro, un sommet à 6000 mètres ?
Une autre dispute savante éclate autour du Kilimandjaro dans les années 1890. Elle met aux prises Hans Meyer, qui a fait la première ascension du sommet, et Bruno Hassenstein, le cartographe à qui il a commandé les cartes pour illustrer ses nombreux articles et ouvrages sur la montagne. Hans Meyer est convaincu que le sommet du massif, déjà réputé le plus haut d’Afrique, culmine à 6130 mètres. Bruno Hassenstein, alors particulièrement estimé et reconnu par ses pairs, est formel. Il a recoupé toutes les informations à sa disposition, issues des expéditions de Hans Meyer, mais aussi de nombreux explorateurs passés avant lui. Et d’après tous ses calculs, le Kilimandjaro ne peut pas faire plus de 5998 mètres.
Hans Meyer fulmine et insiste. Il y va de son prestige personnel d’alpiniste et de celui de l’empire colonial allemand qui a pris possession du Kilimandjaro en 1886: avoir conquis un 6.000 m est bien plus honorable qu’un 5.000 m. La question n’est pas tranchée du vivant des deux hommes. En attendant, parce que Hans Meyer est le client et appartient à une élite influente, Bruno Hassenstein concède à contrecœur l’indication d’une altitude de 6130 m sur ses cartes… tout en laissant les 5998 m entre parenthèses ! Il était pourtant plus proche de la réalité: aujourd’hui, l’altitude du Kilimandjaro est estimée à 5895 m.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la CentrAfricaine, suivez Africa-Press