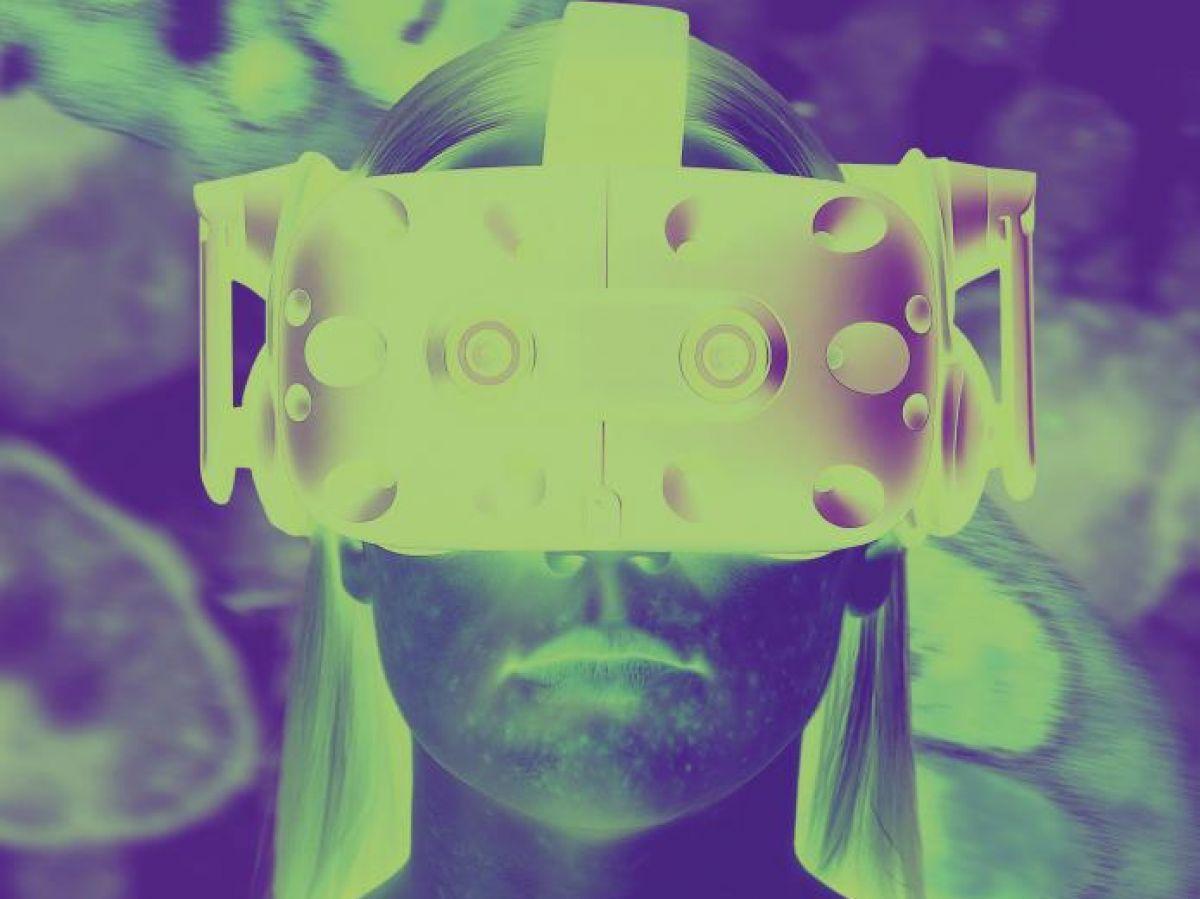Africa-Press – Congo Kinshasa. La simple vue d’une personne présentant des signes d’infection stimule autant votre système immunitaire qu’un vaccin dans les premières heures suivant l’injection, conclut une étude réalisée grâce à la réalité virtuelle et publiée dans la revue Nature Neuroscience. L’approche d’avatars présentant des signes d’infections suffisait à déclencher une réponse défensive de l’organisme, démontrant la capacité d’anticipation de notre organisme face à une menace potentielle.
Casque virtuel sur la tête, 248 personnes observent des avatars aux visages neutres, apeurés ou visiblement infectés (éruptions cutanées) avancer vers eux. Avant et après, des prises de sang révèlent l’état des lieux de l’activation du système immunitaire. « L’idée est que les menaces infectieuses seraient détectées par notre cerveau et déclencheraient une réponse immunitaire pour éviter une réaction trop tardive », explique à Sciences et Avenir l’immunologiste Sara Trabanelli, première autrice de ces travaux de l’Université de Genève (Suisse).
Une menace infectieuse virtuelle
Lorsque l’avatar était visiblement infecté, les prises de sang révèlent effectivement une activation des lymphocytes (globules blancs) de l’immunité innée, et en particulier les cellules lymphoïdes innées (ILC) de trois différents sous types selon leurs fonctions. « Les ILC1, plus spécialisées contre les infections, étaient moins nombreuses, probablement parce qu’elles migraient vers les potentiels sites d’infection », détaille Sara Trabanelli. De plus, les protéines fixées à leur surface et permettant leur activation étaient particulièrement nombreuses lors d’une exposition avec des avatars infectieux… Ou d’une vaccination contre la grippe. « Nous avons comparé les effets immunitaires du stimulus virtuel avec ceux d’une vaccination réelle et c’était très similaire ! » s’enthousiasme l’immunologiste.
Bien sûr, cette similarité ne concerne que les effets survenant dans les deux premières heures après l’exposition, au niveau de l’immunité innée donc. Les effets protecteurs de la vaccination, eux, impliquent l’immunité acquise (ou adaptative) et se mettent en place sur plusieurs jours. Ils nécessitent l’injection d’un antigène, c’est-à-dire un ersatz inoffensif du pathogène contre lequel on veut protéger l’organisme. Quant aux visages apeurés, qui évoquaient également une forme de menace, ils avaient un effet intermédiaire en intensité et concernaient différents marqueurs.
Quand la menace infectieuse pénètre l’espace péripersonnel
Ce lien entre détection d’une menace potentielle et réaction de l’organisme se base sur un concept essentiel: l’espace péripersonnel. « C’est l’espace qui nous entoure, dont le rôle fondamental est l’anticipation du toucher dans un but défensif », explique le spécialiste en neuro-ingénierie Michel Akselrod, co-signataire de ces travaux. « Il y a donc un fort avantage immunitaire à pouvoir éviter le contact en cas de détection de menace infectieuse dans l’espace péripersonnel ». Fondamental pour éviter les dangers, l’espace péripersonnel est régi par un réseau neuronal dédié dans nos cerveaux dans le cortex postérieur pariétal et l’aire prémotrice du cortex frontal.
En fonction de la nature de la menace, sa taille varie et nos temps de réaction raccourcissent lorsqu’il est violé. Pour tester la perception de la menace infectieuse dans l’espace péripersonnel des participants, ils devaient appuyer sur un bouton le plus vite possible à chaque stimulation par les électrodes – simulant un toucher – à mesure que l’avatar s’approchait d’eux.
L’hypothalamus, le lien entre l’identification de la menace et l’activation de l’immunité
Et en effet, plus l’avatar était proche, et plus les temps de réaction des sujets étaient courts lors de la stimulation par électrodes. « Quand le visage est plus proche, le temps de réponse est plus court, les gens sont plus alertes », résume Michel Akselrod. Mais lorsque l’avatar présentait des signes d’infection, il n’avait pas besoin de s’approcher autant que les autres pour que les temps de réaction raccourcissent. « Cela montre un élargissement de l’espace péripersonnel quand l’avatar était infectieux », interprète Sara Trabanelli. A l’IRM et l’électroencéphalogramme, l’activité cérébrale montrait l’activation du réseau neuronal dédié à la gestion de l’espace péripersonnel, ainsi que le réseau de saillance qui permet l’allocation de l’attention et des ressources aux différents réseaux du cerveau.
En particulier, les chercheurs observent une augmentation de la connectivité entre le réseau de saillance et l’hypothalamus lorsque les visages montraient des signes d’infection par rapport aux visages neutres. « On pense que c’est cette modulation de l’activité avec l’hypothalamus qui va ensuite générer une cascade de signalisation, notamment au travers de la libération d’hormones, et finalement une réponse immunitaire », explique Michel Akselrod. Mais pour en être sûrs, il faudra des études sur des souris permettant d’éteindre certaines voies de signalisation et en analyser les effets.
A la recherche du parfait stimulus
« Nous étions très surpris du pouvoir de la réalité virtuelle, de voir un réel changement au niveau cellulaire alors que le stimulus était virtuel et non physique », pointe Sara Trabanelli. Un effet qui peut se rapprocher de celui de l’effet placebo, plus étudié, et dont les chercheurs pensent qu’il partage probablement des mécanismes communs avec ce qu’ils ont observé en termes d’interaction entre le cerveau et le système immunitaire. « Il s’agit aussi de prédictions cognitives sur ce qu’il va se passer dans le futur et leurs effets sur les systèmes qui régulent le corps », compare Michel Akselrod. « L’effet placebo est encore plus impressionnant, car il repose sur une croyance aux effets mesurables sur le système immunitaire, là les stimuli sont virtuels mais plus tangibles ».
L’équipe est à présent en quête du « parfait stimulus », qui générera la meilleure réponse immunitaire, pour le stimuler sans risque et améliorer l’efficacité d’approches existantes. « Nous travaillons sur la modulation de la vaccination et l’amélioration de la désensibilisation aux allergies aux guêpes en simulant une piqure », illustre Sara Trabanelli. Les premiers résultats, encore non communiqués, semblent prometteurs.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Congo Kinshasa, suivez Africa-Press