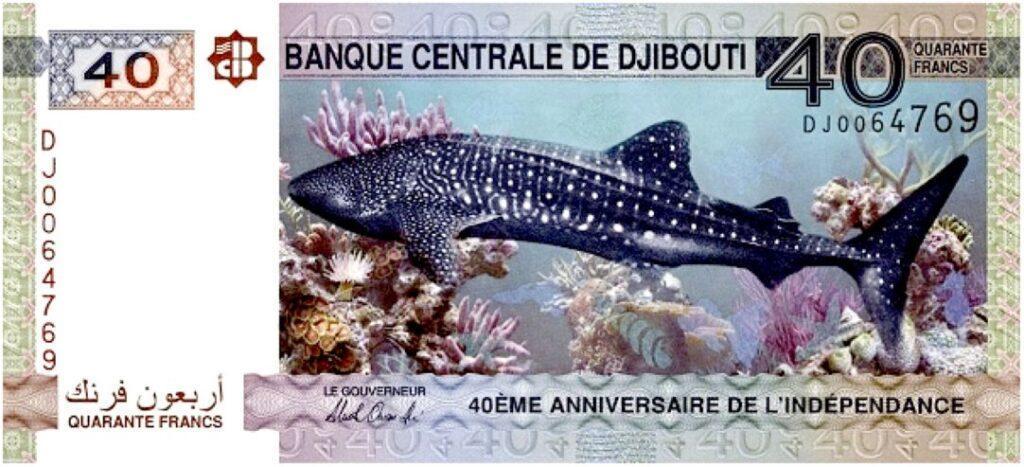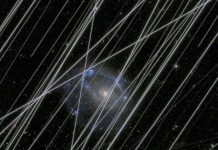Africa-Press – Djibouti. Au confluent des empires et des monnaies, Djibouti a toujours été bien plus qu’un simple point sur la carte. En 1949, alors que le monde se relève à peine de la Seconde Guerre mondiale, ce petit territoire à l’entrée de la mer Rouge devient le théâtre d’une décision monétaire sans précédent: la création du franc de Djibouti, arrimé non pas au franc français, mais au dollar américain. Une orientation audacieuse, dictée autant par la géopolitique mondiale que par la défense d’intérêts locaux. Derrière cette réforme, des figures visionnaires comme Saïd Ali Coubèche incarnent l’éveil politique et économique d’un territoire qui, bien avant son indépendance, a su affirmer sa souveraineté monétaire et stratégique face aux grandes puissances.
À l’entrée de la mer Rouge, Djibouti représente depuis plus d’un siècle l’artère vitale reliant l’Asie, l’Afrique et l’Europe. En 1949, au sortir de la Seconde guerre mondiale, ce petit bout de territoire a été amené à vivre un épisode monétaire révélateur de la dimension géopolitique que peut revêtir une devise.
De la zone ‘‘franc’’ à l’arrimage au dollar
Affaiblie par les dévaluations successives du franc, la France a opté en 1949 pour une décision radicale, celle de doter la Côte française des Somalis (actuel Djibouti) de sa propre monnaie. En mars, le franc Djibouti remplace le franc des Colonies Françaises d’Afrique (franc CFA). Particularité inédite, il n’est pas arrimé au franc français, mais directement au dollar américain. Une bascule qui s’inscrit dans le nouvel ordre monétaire international façonné par les institutions de Bretton Woods qui consacre la montée en puissance, voire la suprématie du dollar.
Derrière ce choix monétaire se cache une logique éminemment géopolitique. Paris accepte de renoncer à sa souveraineté monétaire pour maintenir son implantation stratégique dans la Corne de l’Afrique. Jamais, au grand jamais, la France n’aurait accordé une telle exception sans un motif d’ordre impérial.
L’histoire l’a montré, chaque tentative de sortie de la zone ‘‘franc’’ s’est heurtée à des résistances, parfois même à de véritables représailles. La Guinée en 1958, le Mali en 1962, la Mauritanie en 1973 en ont d’ailleurs fait les frais à leurs propres dépens. Chacune de ces expériences s’est traduite par de graves difficultés, voire par des échecs. La leçon est claire. Les choix monétaires relèvent avant tout des rapports de puissance. Plus récemment, encore, nous constatons que cette réalité perdure comme l’a démontrée en 1998 l’ancrage du franc CFA à l’euro, décidé, là aussi sans réelle consultation des États africains,
Dans ce paysage, Djibouti fait pourtant figure d’exception. Sa « sortie » de la zone ‘‘franc’’, en 1949, n’a rien d’une rupture conflictuelle. Elle fut le fruit d’une manœuvre hautement stratégique venue de Paris, assumée comme tel est surtout comme le prix à payer pour préserver un avant-poste stratégique au carrefour de la mer Rouge.
Un bras de fer invisible avec Londres
Mais cette réforme ne pouvait voir le jour sans l’aval du FMI, et elle se heurta aux fortes réticences britanniques. Londres redoutait qu’avec le franc Djibouti, la livre sterling ne se retrouve indirectement cotée face au dollar à un taux défavorable, échappant à son contrôle. Autrement dit, Djibouti risquait de devenir la vitrine d’une vérité gênante: la faiblesse de la livre sterling face au dollar.
Pour annihiler l’opposition britannique, Paris actionne ses réseaux. Jean de Largentaye, économiste réputé et traducteur de Keynes, mène en coulisse la manœuvre. Dans les couloirs de Bretton Woods, il multiplie les contacts discrets: avec l’Américain M. Southard, l’Éthiopien M. Saad… tout en écartant le représentant britannique, M. Tansley. Il fallait s’assurer que le Conseil du FMI ne s’opposerait pas à la réforme monétaire en CFS lors de sa saisine officielle. Il fallait également qu’il puisse exister des interlocuteurs locaux et cet étonnant contexte de débats autour de la souveraineté monétaire a mis en lumière le rôle déterminant de M.Saïd Ali Coubèche.
Saïd Ali Coubèche, la Voix des Intérêts Locaux et du Franc Djibouti
Figure incontournable de la vie politique et économique djiboutienne, Saïd Ali Coubèche s’est imposé dès 1949 comme la voix des intérêts locaux dans les débats monétaires décisifs. Conseiller de l’Union française, il s’illustre lors de la fixation du taux de change du franc Djibouti, dénonçant avec force le taux proposé de 250 FDJ pour 1 USD, jugé trop élevé et dangereux pour le pouvoir d’achat des citoyens. En proposant un taux plus réaliste de 180 FDJ, il défend une vision équilibrée et protectrice, avant que le compromis soit fixé à 214,392 FDJ. Son intervention marque un tournant en montrant que les élus djiboutiens n’étaient plus de simples spectateurs, mais des acteurs influents du débat monétaire international.
Lors de la séance du 10 mars 1949, Coubèche se distingue par une prise de parole structurée et courageuse, appelant à défendre l’intégrité du territoire djiboutien. Il élargit la notion de défense au-delà du militaire, y intégrant les services publics, les institutions locales et la cohésion sociale. Son discours, salué pour sa clarté et son engagement, recentre le débat sur les enjeux humains et territoriaux, suscitant respect et adhésion.
En mars 1973, alors que le monde est secoué par la crise du système monétaire international, Coubèche devient un véritable rempart contre l’instabilité. Président de la Chambre de Commerce, il alerte les autorités sur les effets concrets des décisions prises à Paris. Il agit comme vigie économique, traduisant les inquiétudes des commerçants et industriels en propositions diplomatiques, et contribue à préserver la stabilité du franc Djibouti dans un contexte mondial incertain.
Enfin, lors de l’indépendance, Saïd Ali Coubèche et les autorités djiboutiennes, sous la présidence de Hassan Gouled Aptidon, se sont opposés à l’entrée de Djibouti dans la zone franc CFA, défendant avec conviction l’autonomie monétaire du pays. Grâce à leur engagement, Djibouti conserve sa propre devise, symbole de souveraineté et d’indépendance économique.
Le parcours de Saïd Ali Coubèche incarne une vérité fondamentale: les choix monétaires sont aussi des choix politiques, et leur réussite repose sur la vigilance, le courage et la vision d’hommes d’État tels que lui — des figures dont l’héritage continue d’inspirer les défenseurs de l’intérêt national.
Une mise en œuvre accélérée
Le 17 mars 1949, la France signe le décret instituant officiellement le franc de Djibouti. L’acte précède même l’avis du FMI, rendu seulement le lendemain. Paris impose sa ligne et obtient gain de cause, en s’engageant à ce que les organismes officiels en Côte française des Somalis n’appliquent aucun taux croisé livre-dollar en dehors du cours officiel. Toute fluctuation est désormais renvoyée au « mécanisme du marché », conséquence assumée de la fin du contrôle des changes.
Le dollar devient l’unique référence officielle, tandis que la livre sterling échappe à toute régulation et ne circule plus qu’au travers des transactions privées, dans un régime de liberté totale.
Les archives diplomatiques et financières révèlent que ce geste n’avait rien d’improvisé: il fut l’aboutissement de tractations discrètes entre Paris et Washington dans les coulisses du Fonds Monétaire International. Télégrammes confidentiels, notes internes et correspondances montrent un alignement tacite franco-américain destiné à sécuriser l’arrimage au dollar… et à marginaliser l’influence britannique dans la région.
Ainsi s’ouvrait, au cœur d’une zone dominée par la livre sterling, une enclave ‘‘dollarisée’’, où la dépréciation de la monnaie britannique pouvait être présentée comme le résultat “naturel” du jeu de l’offre et de la demande. Ce fut le début d’un déclin non pas brutal mais maîtrisé, presque négocié, où l’influence britannique céda progressivement le pas à l’hégémonie américaine.
Les communistes de l’époque dénoncèrent alors une « opération militaire déguisée », estimant que la dollarisation ouvrait la voie à l’implantation future de bases américaines dans la Corne de l’Afrique. Prémonition ou prédiction vieille de plus d’un demi-siècle et qui trouve son écho en 2002 avec l’implantation d’une base militaire au camp Lemonier. Djibouti devint, en somme, un laboratoire colonial où la monnaie fut utilisée comme une arme géopolitique.
Quand l’histoire de 1949 éclaire les débats d’aujourd’hui
La réforme de 1949 ne fut pas un simple ajustement monétaire. Elle révéla que, pour Djibouti, toute orientation monétaire était inséparable des rivalités mondiales. Déjà, le choix d’arrimer la nouvelle monnaie au dollar traduisait avant tout les rapports de force internationaux, bien plus que les besoins locaux. C’est d’autant plus frappant que tous les rapports techniques issus des missions effectuées à Djibouti recommandaient, au contraire, un ancrage à la livre sterling.
Soixante-quinze ans plus tard, la scène a changé d’acteurs, mais non de logique. Le même théâtre accueille une nouvelle guerre d’influences. Tandis que les BRICS plaident pour la dédollarisation et que le yuan progresse très lentement, le dollar reste hégémonique: 60 % des réserves de change mondiales, 80 % des transactions internationales. Djibouti, carrefour des routes commerciales, en ressent directement les effets avec un financement de ses infrastructures par la Chine, paradoxalement libellé en dollars US. Cette situation illustre une nouvelle équation: Pékin étend son influence mais en utilisant la monnaie de son rival américain.
La question n’est donc pas ou plus de savoir quelle devise dominera demain, mais quel prix stratégique chaque option impose en termes de perspectives, de dépendances et de contraintes.
Pour Djibouti, l’enjeu est de transformer sa position géographique « unique » en véritable levier d’influence. Il s’agit désormais, non plus de rester un pion dans le grand échiquier monétaire, mais de devenir un arbitre régional, capable de tirer parti de son emplacement à la croisée de la mer Rouge, du Golfe et de la Corne de l’Afrique.
L’histoire du franc de Djibouti comme l’histoire de toutes les monnaies, rappelle qu’une monnaie n’est jamais neutre. Elle reflète les rapports de force internationaux autant qu’elle sert d’instrument de souveraineté nationale. Forte de cette expérience, Djibouti peut devenir ce lieu d’équilibre, où les puissances se confrontent mais aussi se compensent.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Djibouti, suivez Africa-Press