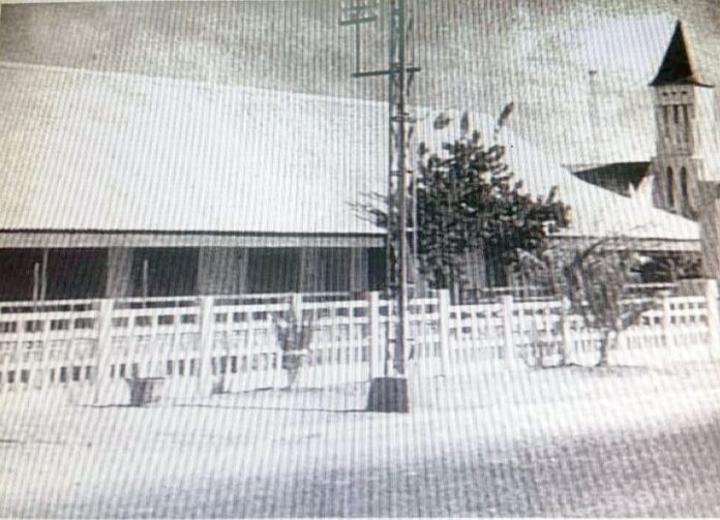Africa-Press – Djibouti. Une école publique chargée de symboles au milieu du désert scolaire de la Côte française des Somalis
L’école de la République a été fondée en 1922 à Djibouti par l’administration coloniale française de l’époque, dans le cadre de sa politique éducative. Il s’agissait d’une initiative institutionnelle de la part des autorités coloniales pour établir la première école publique laïque dans la région. Cette école est née dans un contexte particulier de l’époque coloniale marqué entre autres par des tensions politiques entre religieux et laïques autour de la mise en œuvre de la loi sur la laïcité de 1905. Pendant des décennies, elle a été la seule école publique de Djibouti-ville.
Le contexte particulier de la création de l’École de la République
Pour rappel, la présence française sur le territoire de Djibouti date officiellement de 1862 avec la signature du premier traité de cession de la baie d’Obock. En 1888, l’administration coloniale a été transférée d’Obock vers Djibouti-ville qui est officiellement choisie comme capitale, en raison de sa position géographique et des meilleures conditions qu’elles offraient pour la construction d’un port en eau profonde. La colonie « Côte française des Somalis » avec comme chef-lieu Djibouti-ville, est officiellement née en 1896.
Comme nous l’avons évoqué dans un article précédent, dès les années 1880, l’enseignement était dispensé par des missionnaires catholiques. A Obock, puis à Djibouti-ville, les frères et sœurs missionnaires ont rapidement créé des écoles catholiques. L’administration coloniale de l’époque soutenait globalement les initiatives et efforts des missionnaires engagés dans la prise en main de l’éducation de la population de la jeune colonie. En fait, les administrateurs coloniaux de cette période avaient d’autres priorités à gérer comme par exemple mettre en place des infrastructures économiques indispensables pour le fonctionnement de la nouvelle colonie.
Mais en France, la loi sur la laïcité concernant la séparation des Églises et de l’État entre en vigueur le 9 décembre 1905. Cette loi établit la séparation juridique entre l’État et les organisations religieuses en France et donc aussi dans l’ensemble de son empire colonial. Les autorités coloniales en place à Djibouti se sont donc trouvées dans l’obligation d’appliquer ladite loi.
Néanmoins, certaines colonies étaient soumises à des régimes particuliers, et même là où la loi a été introduite, des aménagements ont été apportés notamment pour l’islam. Justement la question de la manière d’appliquer la loi sur la laïcité se posait aussi pour le cas de Djibouti. Il était évident qu’il serait compliqué d’appliquer de manière intégrale la loi sur sa forme métropolitaine dans un contexte où la population locale est majoritairement musulmane et où de toute façon l’administration coloniale a beaucoup d’autres priorités comme la sécurisation et le développement de la colonie.
Malgré l’arrivée de la loi de 1905, l’administration coloniale en place à Djibouti n’a pas stoppé net sa collaboration avec la mission et a préféré continuer à soutenir la gestion des écoles par les missionnaires catholiques. En outre, l’union sacrée pendant la guerre 1914-1918 a accentué cette collaboration entre l’administration coloniale et les missionnaires catholiques.
Mais, après la Première Guerre mondiale, des voix se sont élevées (à Djibouti et en France) pour réclamer la séparation effective entre l’Église et l’administration coloniale qui représente l’État y compris dans la Côte française des Somalis. L’administration coloniale décida alors de créer une école publique et laïque en 1922. La création de cette école publique visait à transférer officiellement la responsabilité de l’éducation du domaine religieux vers l’État français.
L’école de la République, la première école publique et laïque
L’École de la République, fondée à Djibouti en octobre 1922, n’était pas la première école du territoire. Cependant, elle fut la première école publique et laïque, succédant aux établissements d’enseignement religieux. Elle se voulait un symbole de la laïcité républicaine. Le choix de son nom, « École de la République », n’était pas fortuit. Il illustre clairement la volonté des autorités coloniales d’établir une école républicaine, par opposition aux écoles catholiques ou privées. L’école avait pour mission d’éduquer les citoyens français et de transmettre les valeurs de la République (liberté, égalité, fraternité, laïcité) à la population colonisée, dans le cadre plus large d’une « mission civilisatrice ». Elle visait également à former le personnel local subalterne (employés de bureau, fonctionnaires, traducteurs) indispensable au fonctionnement de l’administration et de l’économie de la colonie.
Située sur le boulevard de la République, dans le quartier du Plateau, au centre de Djibouti, l’école primaire accueillait des élèves de 6 à 12 ans.
À l’origine, c’était une école de garçons. Les filles continuaient de fréquenter une école séparée, gérée par des sœurs de la mission catholique. L’école est toujours en activité et est gérée par le ministère de l’Éducation nationale. Au fil des ans, elle a été rénovée pour répondre aux normes modernes, tout en conservant certains de ses bâtiments historiques d’origine. Depuis la création de l’École normale (centre de formation des enseignants), elle fait office d’école d’application pour les futurs enseignants. En 2025, l’établissement est désormais devenu une grande institution comptant 24 salles de classe. Elle accueille actuellement 1 057 élèves et 38 enseignants. Elle a formé de nombreuses personnalités locales et a contribué au développement de l’enseignement primaire dans le pays.
Pourtant, à l’époque coloniale, l’École de la République était une école publique relativement isolée pendant une période assez significative.
L’école de la République, une institution au milieu d’un désert scolaire
Après la création de l’école de la République, il faudra attendre des décennies pour voir la construction d’autres écoles publiques à Djibouti-ville. Dans les régions, la première école primaire de Tadjourah est créée en 1932. Puis une école publique est créée à Dikhil en 1939. À Ali Sabieh, l’école primaire Saint-Louis gérée par la mission catholique a été créée en 1948. À l’heure de la politique de l’éducation gratuite pour tous de Jules Ferry, le nombre d’établissements scolaires est resté très limité à Djibouti durant toute la période coloniale.
La lenteur de la création de nouvelles écoles publiques après 1922 à Djibouti s’explique principalement par les objectifs et les contraintes de la politique coloniale française de l’époque, qui n’avait pas pour priorité une éducation de masse pour les populations locales.
Plusieurs facteurs clés ont contribué à cette situation: Le système éducatif colonial était conçu pour former une petite élite d’auxiliaires locaux (interprètes, commis, personnel subalterne pour l’administration et le port) plutôt que pour scolariser l’ensemble de la population. L’objectif était de répondre aux besoins limités de l’administration coloniale et non de développer l’instruction générale.
L’administration coloniale disposait de budgets limités et la création d’une offre d’enseignement laïc étendu était considérée comme trop coûteuse. Les ressources étaient allouées en priorité aux infrastructures portuaires et militaires, jugées plus stratégiques.
En l’absence d’une offre d’enseignement laïc suffisante, l’éducation (notamment pour les filles) a longtemps reposé sur les missions catholiques (Frères de Saint-Gabriel et sœurs franciscaine de Calais), qui opéraient avec l’aval et parfois le soutien de l’administration, comblant ainsi le vide laissé par l’État colonial.
La société djiboutienne était majoritairement composée de pasteurs nomades, pour qui la scolarisation de leurs enfants, notamment la scolarisation sédentaire de type occidental, n’était pas forcément une priorité ou s’intégrait difficilement dans leur mode de vie et leur structure sociale.
En somme, l’école de la République est restée longtemps une institution isolée, reflétant une politique coloniale sélective plutôt qu’une volonté de généralisation de l’enseignement. Cependant, avant et pendant la colonisation, les écoles coraniques jouaient un rôle central dans l’éducation religieuse et sociale locale, offrant une alternative au système scolaire français.
Conséquences du désert scolaire à Djibouti.
Le désert scolaire en matière de création de nouvelles écoles publiques après 1922 a eu des conséquences importantes et durables sur le développement socio-économique et culturel de Djibouti: La conséquence la plus immédiate a été un très faible accès à l’éducation pour la majorité de la population, limitant les opportunités d’instruction à une infime minorité d’élèves.
L’éducation était centralisée à Djibouti-Ville, créant un fossé important entre les élites urbaines scolarisées (qui avaient accès aux postes subalternes de l’administration coloniale) et la vaste population rurale et nomade, qui restait largement non scolarisée.
En l’absence d’alternatives publiques, les écoles coraniques sont restées le pilier de l’éducation traditionnelle et religieuse. Les missions catholiques ont également joué un rôle important dans l’éducation “moderne”, notamment pour les filles.
L’accès à l’éducation était le principal moyen d’accéder à des opportunités économiques et sociales dans le contexte colonial. Le manque d’écoles a donc freiné l’ascension sociale de la population locale, la cantonnant majoritairement à des rôles traditionnels ou subalternes. Cette politique a laissé en héritage un système éducatif marqué par des inégalités structurelles et une dualité entre l’enseignement religieux/traditionnel et l’enseignement public moderne, que les réformes post-indépendance (notamment celle de 2000) ont cherché à corriger.
Le nombre limité de personnes formées dans le système éducatif moderne a potentiellement contribué à un manque de cadres pleinement qualifiés au moment de l’indépendance du pays en 1977, rendant plus difficile la transition vers une administration et un développement entièrement gérés par les Djiboutiens.
L’école de la République vient de fêter ses 103 ans. C’est une école chargée d’histoire et témoin des politiques éducatives et de ses contradictions de l’époque coloniale. Elle est aussi le témoin de l’’évolution de l’éducation de Djibouti après l’indépendance en 1977. Elle évolue désormais parmi les 200 écoles publiques du pays qui accueillent plus de 150 mille élèves en 2025. Néanmoins, sa préservation est recommandée ainsi qu’une meilleure conservation de ses archives.
Abdallah Hersi
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Djibouti, suivez Africa-Press