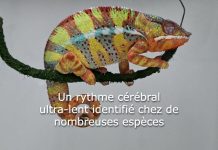Africa-Press – Guinee Bissau. C’est le défi faire face l’agriculture dans le monde entier. Tout l’enjeu est de maintenir des rendements de culture assez élevés pour sauver l’équilibre économique des exploitations, tout en réduisant les apports en eau pourtant indispensables à la croissance des plantes. C’est une “chasse au gaspi ” de grande échelle qui est menée partout sur la planète confrontée à des sécheresses plus fréquentes et plus intenses, conséquences du changement climatique en cours. Scientifiques et ingénieurs qui travaillent sur les besoins des plantes et les systèmes d’irrigation sont aujourd’hui extrêmement sollicités tant par les gouvernements que par les filières agricoles.
Gravitaire, aspersion et micro-irrigation
Au niveau mondial, 70 % de la ressource en eau est utilisée pour l’agriculture. Une statistique qui, en soi, ne dit pas grand-chose puisqu’elle mélange les zones équatoriales humides, les climats tempérés technologiquement développés et les régions semi-désertiques qui abritent deux milliards d’humains dont plus de la moitié sont des agriculteurs. “Dans ces régions, c’est encore le système gravitaire qui domine, c’est-à-dire la distribution de l’eau par canaux en profitant des pentes “, détaille Bruno Cheviron, coanimateur du réseau “systèmes agricoles et eau” à l’Institut national pour la recherche sur l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae).
Ces techniques millénaires assurent un partage équitable de l’eau entre les cultivateurs mais ne permettent pas d’optimiser l’usage de la ressource ni de faire coïncider les besoins des plantes avec leur arrosage. Au moyen des pompes et moteurs coïncidant avec la “révolution verte” des années 1950, l’agriculture des pays développés a opté pour des techniques par aspersion. Les canons-enrouleurs, les pivots et les rampes permettant d’arroser les cultures font ainsi partie du paysage rural depuis des décennies.
En France, 90 % des 2 millions d’hectares de cultures irriguées sont ainsi arrosés par aspersion. Selon les experts, passer du gravitaire à l’aspersion fait économiser 60 % de la ressource. “L’aspersion permet de remonter les pentes grâce aux pompes, d’atteindre toutes les parcelles et de couvrir de plus grandes surfaces. L’inconvénient, c’est que cela dépense de l’énergie. Or la flambée récente des coûts des carburants incite les agriculteurs à raisonner leur irrigation “, explique Bruno Cheviron.
La troisième voie est la plus récente : c’est la micro-irrigation. L’eau est acheminée par un réseau de tuyaux jusqu’au pied des plantes où elle est appliquée goutte à goutte. Ces tuyaux peuvent être installés en surface ou enterrés. Dans les deux cas, cela implique que les parcelles équipées ne peuvent pas entrer dans des rotations de culture. La technique concerne donc principalement l’arboriculture et le maraîchage, des cultures à forte valeur ajoutée qui justifient des investissements plus importants. Le goutte à goutte permet d’économiser 25 % d’eau par rapport à l’aspersion.
Depuis les années 1980, de très nombreux travaux ont été menés pour améliorer les engins par aspersion, notamment en optimisant la dispersion des gouttelettes d’eau et en orientant mieux les angles d’arrosage des canons. Mais ces progrès techniques plafonnent et, surtout, ne permettent plus de répondre aux enjeux du changement climatique. La hausse des températures, une pluviométrie plus erratique et des périodes de sécheresse plus longues bousculent les habitudes des irrigants.
Si, en France, la part des terres irriguées est de 12 % (contre 73 % au Portugal, 61 % en Espagne, et 24 % en moyenne en Europe), 90 % des prélèvements s’effectuent en fin de printemps et en été, lorsque les rivières sont à l’étiage et les nappes phréatiques au plus bas. Ainsi, le plan sécheresse 2023 du gouvernement interdit-il toute irrigation par aspersion entre 9 heures et 20 heures cet été en cas d’alerte renforcée. La situation est particulièrement dramatique en Nouvelle-Aquitaine où la hausse moyenne des températures est en train de “méditerranéiser” un climat auparavant océanique, ainsi que le décrit l’étude de l’agence de l’eau Adour-Garonne dans une prospective à 2050, avec des conséquences irréversibles sur la biodiversité et les cultures.
Des outils numériques pour affiner les pratiques
Que ce soit à Sivens dans le Tarn ou à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, ces conflits entre agriculture et société sont les marqueurs d’un changement local profond du couvert végétal et de son exploitation par l’humain. “C’est pourquoi les économies passent aussi par un deuxième levier, un changement de stratégie agronomique “, statue Bruno Cheviron. Dans un premier temps, les irrigants ont été contraints et forcés de respecter des règles strictes d’usage. Ce fut d’abord des interdictions d’arroser en plein jour, puis, année après année, ont été instaurés des “tours d’eau”, quotas imposés exploitation par exploitation.
Depuis 2014, l’Union européenne refuse tout soutien à l’investissement d’un nouveau système d’irrigation s’il ne garantit pas de 5 à 25 % de réduction des besoins selon les installations. Mais les stratégies portent aussi sur la gestion des cultures. Ainsi, les semis à l’automne permettent de diminuer le besoin de céréales, qui peuvent par ailleurs être moissonnées plus tôt dans l’été. Des cultures très gourmandes comme le maïs commencent même à être remplacées par le sorgho. L’Inrae mène actuellement des travaux pour mesurer les gains en eau de techniques comme celle – sans labour -de conservation des sols, ou encore de l’agroforesterie.
La nouvelle étape, c’est l’intégration du numérique, car les techniques actuelles sont dans une impasse. “Les économies d’eau potentiellement réalisables en passant de l’aspersion à un système localisé d’irrigation sont limitées, voire impossibles, lors des années très sèches, assène Claire Wittling, ingénieure à la Plate-forme de recherche et expérimentation en sciences et technique de l’irrigation (Presti) de l’Inrae. Au contraire, le pilotage de l’irrigation à l’aide de sondes donnant l’état hydrique du sol permet des économies d’eau moins dépendantes des conditions climatiques. ” L’idée est donc de mieux comprendre les besoins des plantes afin d’y répondre le plus précisément possible. “Il s’agit d’apporter à l’agriculteur des informations comme la disponibilité en eau des sols et l’état de la culture à l’échelle de la parcelle afin de déterminer la bonne et suffisante dose à apporter “, table Bruno Cheviron.
Le laboratoire Optimisation du pilotage des technologies de l’irrigation, minimisation des intrants, transferts dans l’environnement (Optimiste), qu’il anime, est ainsi à l’origine du développement du modèle “Optirrig”, en cours de test avant une commercialisation prévue dans les deux prochaines années. Il s’agit d’intégrer des modèles de croissance d’une plante au contexte pédologique, agronomique, météorologique et climatique dans lequel elle croît. Une démarche qui fait l’objet de très nombreux essais en champ et en laboratoire pour nourrir les algorithmes d’une multitude de données permettant de faire face à un éventail très large de circonstances lors de la saison de croissance de la culture. La prochaine génération d’agriculteurs devrait donc combiner à la fois des stratégies agronomiques incluant la biodiversité (haies, arbres) régulant et conservant dans les sols les eaux de pluies, et les outils de l’intelligence artificielle : capteurs d’humidité et de besoins en azote au bord des parcelles, suivi par satellite de l’avancée des cultures, aide à la décision d’irrigation ou de fertilisation directement et clairement accessible sur smartphone. Et passer ainsi de “l’eau quand je veux” à “l’eau quand il faut”.
Les satellites à la rescousse
Les satellites permettront-ils bientôt de fixer les besoins en eau des cultures et, surtout, les surfaces qui ont été irriguées ? “Les données satellitaires informent déjà de l’état général du couvert végétal, explique Nicolas Baghdadi, chercheur à l’Inrae. Les satellites européens Sentinel du programme Copernicus nous donnent désormais accès à la teneur en humidité des sols. ” L’idée est donc de coupler les données de télédétection obtenues conjointement par les imageries radar et optique. Les deux technologies associées effacent l’obstacle des nuages par exemple, ce qui permettra à terme de fournir des informations sur l’état d’humidité des sols, actuellement sur une fourchette de 5 jours. Ce laps de temps est aujourd’hui trop important puisqu’en été, un sol arrosé met moins de 3 jours à s’assécher. Mais les chercheurs estiment pouvoir très bientôt donner une idée très précise de l’usage de l’eau par l’agriculture. Et dénoncer ainsi ceux qui ne respecteraient pas les règles du jeu des quotas, lesquels devraient se durcir au fur et à mesure que les températures grimperont.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinee Bissau, suivez Africa-Press