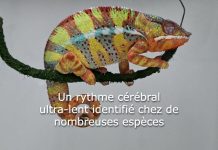Africa-Press – Guinee Bissau. L’eau du robinet pourra-t-elle demeurer potable ? En mars, le dernier rapport publié par le laboratoire d’hydrologie de Nancy (LHN), un organisme de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) a dévoilé de nouvelles pollutions dans l’eau : des résidus de pesticides, d’explosifs et d’un solvant, qui n’étaient pas mesurés jusque-là ! Pourtant, en France, l’eau du robinet est le produit de consommation le plus contrôlé : environ 800 molécules y sont recherchées, et leurs taux de concentration surveillés afin qu’ils ne dépassent pas les limites imposées par le code de la santé publique.
“Quelque 320.000 prélèvements et plus de 18 millions d’analyses sont réalisés annuellement, depuis les eaux brutes jusqu’aux eaux distribuées au robinet du consommateur, explique Laurence Cate*, membre de la direction de l’eau au ministère de la Santé. De nouvelles molécules sont régulièrement ajoutées au contrôle sanitaire, comme les perturbateurs endocriniens. ” La liste des substances à surveiller est révisée tous les six ans. Mais avec “environ 33.000 points de captage d’eau, 16.000 stations de traitement et 900.000 km de réseau de distribution, des pollutions transitoires passent nécessairement sous les radars, ainsi que toutes les pollutions que l’on ne connaît pas encore “, analyse Christophe Rosin*, chef de l’unité chimie des eaux au LHN.
L’eau du robinet est prélevée dans les lacs, les rivières, les nappes souterraines. Soit des ressources dont “les contaminations peuvent se faire par les sols, qui les enrichissent par exemple en arsenic, naturellement présent dans l’environnement, détaille Éléonore Ney, responsable de l’unité d’évaluation des risques liés à l’eau à l’Anses. Mais également par des apports humains tels les engrais ou les pesticides. D’où la nécessité de traiter l’eau pour la rendre potable. ”
Depuis les années 1930, le nombre de substances chimiques produites a été multiplié par 400. Et les eaux étant le réceptacle final de ce que l’on consomme à travers les ruissellements, infiltrations et autres lessivages, on y retrouve aussi “des médicaments, des substances liées au traitement de l’eau potable ou aux réseaux de distribution d’eau, tel le chlorure de vinyle monomère “, énumère Christophe Rosin. Ce composé synthétique principalement utilisé pour la fabrication du PVC (polychlorure de vinyle) est largement présent dans les canalisations. C’est un agent cancérogène certain pour l’humain, selon le Centre international de recherche sur le cancer, mais cela n’a été prouvé qu’à des doses importantes en milieu professionnel, et non “dans le cas d’une consommation quotidienne d’eau du robinet “, indique le ministère de la Santé. En l’état actuel des connaissances.
Le dernier rapport du LHN résulte de l’une de ses missions qui consiste à identifier de nouvelles pollutions de l’eau potable, à l’aide de campagnes périodiques de prélèvements de molécules nouvellement synthétisées ou utilisées en grandes quantités. La campagne 2020-2021 du LHN s’est ainsi intéressée à trois classes de composés : des pesticides et leurs produits de dégradation (appelés métabolites), des résidus d’explosifs et de 1,4-dioxane, un solvant très utilisé dans la seconde partie du 20e siècle et cancérogène avéré sur le rat. Une opération d’échantillonnage d’eaux brutes et traitées a été réalisée sur 300 sites répartis sur le territoire français, qui alimentent environ 20 % de la population. Sur les 157 composés de pesticides et leurs métabolites recherchés, 89 ont été quantifiés en eaux brutes et 77 en eaux traitées. Plus inquiétant : “la totalité des eaux brutes et traitées prélevées en Bretagne et dans les Hauts-de-France contiennent au moins un pesticide ou métabolite, relève le rapport. Ces deux régions présentent également des fréquences de non-conformité élevées en eaux traitées : 92 % en Bretagne et 76 % dans les Hauts-de-France. […] Les concentrations les plus élevées en somme de pesticides et métabolites dans l’eau traitée ont été observées dans les régions Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté. ”
Mais c’est surtout la présence quasi généralisée dans les eaux de métabolites du chlorothalonil, un pesticide utilisé pendant cinquante ans et interdit en Europe depuis 2019, qui inquiète. Des chercheurs suisses avaient préalablement détecté ces contaminants sur tout le territoire helvète, ce qui a éveillé les soupçons du LHN. Or ce pesticide – considéré comme cancérogène probable par les autorités européennes – et ses sous-produits sont détectés à des taux bien supérieurs aux normes de qualité…
Les limites des carafes filtrantes
Pour éliminer le goût de chlore ou le calcaire de l’eau, certains foyers utilisent des carafes filtrantes. Mais selon l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation), si ces systèmes diminuent efficacement chlore, cuivre et plomb, ils peuvent aussi favoriser la multiplication de micro-organismes, diminuer le pH de l’eau – autorisant alors la dissolution de métaux composant bouilloires ou casseroles -, libérer de l’argent et autres substances présentes dans les filtres. Il est recommandé de conserver l’eau filtrée au réfrigérateur et de la consommer sous 24 h, de nettoyer la carafe et de remplacer la cartouche selon les règles du fabricant.
Les industriels produisent toujours plus de molécules
“Nous assistons à une généralisation de la présence de pesticides dans les eaux souterraines, souligne Marie-Laure Métayer*, adjointe au directeur de la direction de l’eau du ministère de la Transition écologique. Ces pollutions ont augmenté considérablement entre 2010 et 2018. Et des produits comme l’atrazine, interdit depuis vingt ans, sont toujours présents dans l’environnement. Une étude a ainsi montré que sur 100 enfants testés, neuf présentaient des traces de ce pesticide dans leurs cheveux. ” Selon cet organisme gouvernemental, les nitrates, composant utilisé dans les engrais, sont le deuxième sujet de dépassement des limites de qualité en France. L’interdiction de certains composés jugés dangereux est-elle la solution ? “Il est facile ensuite pour les industriels de mettre sur le marché d’autres produits de la même famille, avec simplement des chaînes carbonées différentes. Le bisphénol A a été interdit, mais d’autres bisphénols ont été développés, moins toxiques peut-être… ” Mais pas forcément anodins.
Le véritable problème est que l’industrie produit des molécules, plus ou moins toxiques, à un rythme bien plus élevé que ce que peuvent analyser les organismes chargés de leur détection et de l’évaluation de leur toxicité. Ainsi, la production de nouveaux composés pourrait tripler d’ici à 2050, d’après une étude de janvier 2022. Comment établir des normes dans ces conditions ? “Le nombre de molécules commercialisées en Europe est d’environ 100.000, explique Christophe Rosin. Mais on a détecté à ce jour 350.000 substances dans l’environnement, et il y en a potentiellement des millions présentes, que nous ne mesurons pas… Nous n’avons pas de connaissances exhaustives des métabolites de chaque pesticide, souvent plus stables que le pesticide initial. Sans parler des polluants dits éternels qui, avec une liaison carbone-fluor très solide, sont difficilement biodégradables… On intervient a posteriori, mais il faudrait agir à la source pour conserver l’eau potable. ”
Des résidus d’explosifs résultant de la guerre de 14-18
L’histoire récente aurait pourtant pu susciter plus de prudence. L’étude du LHN a en effet relevé, dans certaines régions, la présence dans l’eau de 18 résidus d’explosifs, résultant pour l’essentiel des deux guerres mondiales. Et plus particulièrement de la période 1914-1918, au cours de laquelle “environ 1 milliard de munitions tirées par les belligérants et environ 500.000 tonnes de composés nitroaromatiques [ont été] fabriqués en Allemagne “, engendrant une pollution environnementale d’une grande diversité chimique. C’était il y a un siècle…
“La pollution chimique existe depuis longtemps et est devenue planétaire, avec des mélanges complexes et une exposition chronique des populations, alerte Yves Lévi*, professeur émérite de santé publique à l’université de Paris-Saclay. C’est un problème d’une dimension colossale, avec des incidences sur la reproduction, des cancers, le diabète et même sur notre immunité. Il n’y a véritablement qu’une solution : réduire l’exposition aux substances chimiques toxiques et donc réduire leur nombre dans l’environnement.” .
Comment l’eau est rendue potable
L’eau prélevée dans la nature est rendue potable après divers traitements. La première étape consiste à éliminer gros et petits débris à l’aide de sas grillagés, de tamis et râteaux mobiles. La deuxième utilise des coagulants pour agréger les particules suspendues en grumeaux, qui tombent au fond de bassins de décantation. L’eau clarifiée est alors filtrée par des couches de sable, du charbon actif ou des membranes qui retiennent les plus petites particules. Virus, bactéries, micro-organismes – mais aussi ammoniaque, fer ou manganèse – sont ensuite éliminés par traitements chimiques (ozone, chlore, etc.) ou rayons ultraviolets. Ces traitements ne suffisent néanmoins pas à éliminer toute trace de pesticides, nitrates et autres polluants qui se multiplient dans l’environnement.
Aussi, certains édiles se tournent aujourd’hui vers la technique dite d’osmose inverse basse pression, à l’instar de la mairie de Pussay (Essonne), qui vient d’inaugurer la première station du genre en Île-de-France. Ce procédé recourt à des membranes de mailles nanométriques, enroulées en spirale dans des tubes dans lesquels l’eau est injectée à haute pression. Les partisans de ce traitement vantent l’eau “ultra-pure” ainsi obtenue. Mais pour les défenseurs de l’environnement tel Pascal Grandjeat, de l’association Eau publique Orge-Essonne, “cette technique, qui consomme plus d’eau, plus d’électricité et coûte plus cher, est une fuite en avant technologique qui appartient au siècle dernier. La prévention ou la protection des zones de captage réalisée grâce aux changements de pratiques des agriculteurs a pourtant montré son efficacité ailleurs. ”
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinee Bissau, suivez Africa-Press