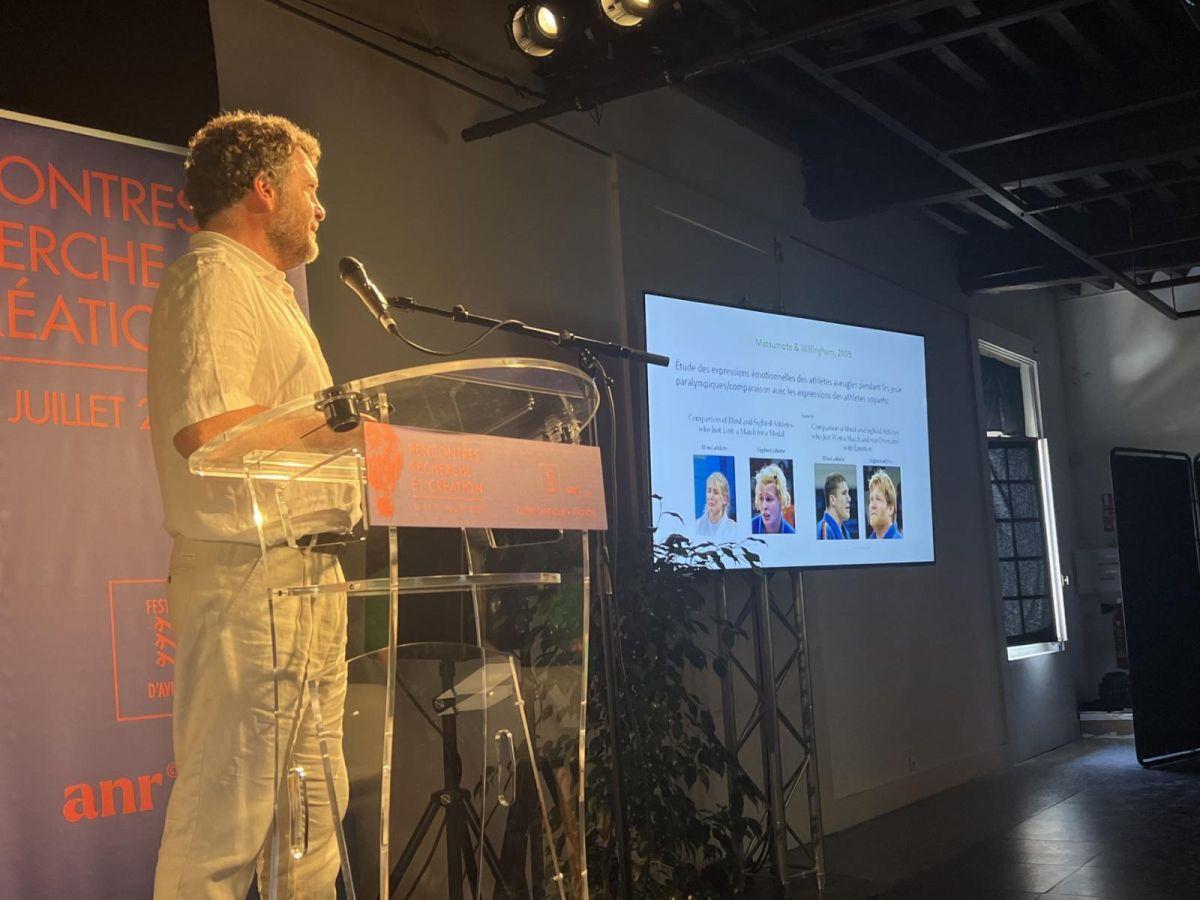Africa-Press – Guinee Bissau. Sur l’immense scène de la Cour d’honneur du Palais des Papes, une mère seule crie son désespoir de ne pouvoir nourrir ses cinq enfants. Dans la pièce coup de poing Welfare (lire l’encadré ci-dessous), le groupe de démunis regroupés dans un centre d’aide sociale de New York exhibent tour à tour la peur qui les tenaille, leur colère, leur tristesse… Encore faut-il aux travailleurs sociaux bien percevoir leurs appels à l’aide, quand les explications des parcours de vie des laissés pour compte peuvent sembler incohérentes. Et les reconnaître pour, in fine, leur venir en aide. Que l’expression des émotions joue un rôle fondamental dans les relations humaines semble une évidence. Pourtant, elle n’est pas toujours aussi facile qu’on croit à décoder.
Welfare, d’après le film de Frederick Wiseman (1973). A noter, pour cette première année de direction artistique du Festival d’Avignon par Tiago Rodrigues, Julie Deviquet est la 2ème metteuse en scène de théâtre après Ariane Mnouchkine en 1982 à être accueillie dans la Cour d’Honneur.
A travers les expressions faciales “seules six expressions sont exprimées et comprises à travers le monde”
Lors des journées Recherche et Création (lire l’encadré ci-dessous titré “La Fabrique des sociétés”) qui se déroulaient au cloître Saint-Louis, Edouard Gentaz (professeur de psychologie du développement à l’Université de Genève, directeur de recherche au CNRS, coordinateur du projet Family-Air, membre des projets IMADOI et images tactiles, financés par l’ANR) a rappelé qu’à travers leurs expressions faciales seules “six émotions dites primaires sont exprimées et comprises à travers l’ensemble du monde et des cultures : peur, joie, colère, dégoût, tristesse, surprise” (voir la vidéo ci-dessous).
Les travaux de Paul Ekman, à la fin des années 1960, reprenant les idées de Darwin au 19e siècle, en ont apporté la preuve : ces émotions étaient reconnues sur photos par des adultes aussi bien au Chili qu’en Argentine ou au Brésil, aux Etats-Unis que par une ethnie (peuple Fore) en Nouvelle-Guinée. Aujourd’hui, insiste Edouard Gentaz, l’important est encore ailleurs, dans le fait que les scientifiques ne font plus la séparation “émotion-raison”. Changement radical que beaucoup, dans nos sociétés, n’ont pas encore enregistré !
“Tous nos processus cognitifs et tous nos processus émotionnels sont pensés comme liés et en forte interaction”, explique le professeur de l’université de Genève. Pour le monde académique, leur disconnexion n’est plus qu’une vieille lune d’il y a plusieurs décennies, quand les spécialistes voyaient d’un côté “Freud s’occupant du développement affectif et de l’autre, Piaget s’occupant du développement cognitif”. Ce qui n’empêche pas les spécialistes du développement de continuer à traquer d’autres inconnues, et à s’interroger sur ce qui est véritablement inné. “Comment des aveugles de naissance expriment-ils leurs émotions s’ils ou elles n’ont jamais pu les visualiser chez d’autres humains ?” s’interrogent-ils par exemple. “Les aveugles de naissance et les voyants produisent spontanément les mêmes types d’expression faciale, en particulier pour les expressions primaires comme la joie, la tristesse et la peur”, constate Edouard Gentaz, rappelant les résultats de Matsumoto et Willingham (2009). Ces derniers ont en effet comparé les photos des réactions d’athlètes voyants et non-voyants tout à la joie d’avoir gagné un match ou, au contraire, tristes d’avoir perdu l’occasion d’une médaille. Et constaté les similarités.
La “Fabrique des sociétés”
Plus d’une vingtaine de scientifiques, historiens et préhistoriens, philosophes, sociologues, économistes et artistes ont échangé les 10 et 11 juillet 2023, lors des Rencontres Recherche et Création organisées par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et le festival d’Avignon. Au cœur de leurs réflexions, la “Fabrique des sociétés”. Depuis l’origine de l’Homme jusqu’aux formes modernes de protections collectives et aux droits humains, en passant par l’invention de l’écriture, l’importance des perceptions et émotions ou les combats pour la liberté.
A sept mois, les bébés savent déjà distinguer la peur de la colère
Les bébés, eux, mettent un peu de temps à s’y retrouver. S’ils reconnaissent les visages des proches extrêmement rapidement, on ne sait toujours pas si, avant sept mois, ils font vraiment la différence entre la peur et la joie qui s’y expriment (lire l’encadré ci-dessous titré “J’y vais ou j’y vais pas ?”). En revanche, on observe qu’à sept mois, ils savent déjà distinguer la peur de la colère. Bien plus tard, entre 6 et 10 ans, la surprise et le dégoût entrent dans la danse mentale des humains. Pourquoi est-ce si important de savoir pourquoi et comment ces émotions émergent ? “Parce qu’elles seront intimement liées à toutes sortes d’autres compétences, notamment pro-sociales qui ont des effets sur la santé mentale et les apprentissages”, explique Edouard Gentaz.
J’y vais ou j’y vais pas ?
C’est un dispositif expérimental un peu pervers. Sur le sol, un dessin représente une falaise d’où l’on pourrait tomber. D’un côté, un bébé de 12 mois, de l’autre côté sa maman. Dans un cas, cette maman exhibe un visage très joyeux. Dans un autre cas, très apeuré. Question : que va faire le bébé ? J’y vais ou j’y vais pas ? Le professeur Edouard Gentaz explique que dans la dernière situation, “aucun bébé ne traverse”. Mais dans le premier cas, “trois bébés sur quatre traversent”. Preuve qu’ils savent, à cet âge, faire la différence entre la peur et la joie sur le visage de leur mère (voir la vidéo ci-dessous). Ce qui les a alertés et immobilisés dans un cas et au contraire, pour une majorité, rassurés dans l’autre.
Le cas des “émotions dites morales”
L’apprentissage des émotions lui-même ne cessera ultérieurement de se raffiner, et tout particulièrement quand il s’agit des “émotions dites morales” telles que la honte, la culpabilité, la gratitude… au cœur des relations sociales. “Leur expression nécessite la capacité de prendre en compte les normes sociales et culturelles, d’appréhender les implications de ses actions sur autrui, et de maîtriser plusieurs compétences cognitives telles que la conscience de soi, une théorie de l’esprit et un sens moral”, détaille Edouard Gentaz. Rien de simple. On imagine en effet à quel point un même événement pourra être jugé très différemment par des personnes différentes qui en auront toutes fait une évaluation, un traitement cognitif, suivi ou pas de toute une série de composantes, dans le système nerveux périphérique, poussant à l’action ou non, etc. Très important émotionnellement pour les uns – ce qui entraînera de nombreuses réactions – il pourra être ressenti comme peu important par d’autres qui, très vite, n’y attacheront plus aucune importance et ne s’en souviendront même pas…
“Le fait d’être capable d’identifier, de comprendre et de réguler ses émotions est extrêmement important pour pouvoir interagir avec son prochain, pouvoir apprendre, avoir une bonne santé mentale et de bonnes relations sociales”, résume Edouard Gentaz. Voire développer de l’empathie ! Tout un programme pour la bonne cohésion d’une société.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinee Bissau, suivez Africa-Press