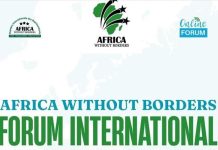Africa-Press – Guinée. Cinq dollars par crédit pour un pays aussi riche que Madagascar, c’est injuste ! » lançait Max Andonirina Fontaine, alors ministre de l’Environnement, désormais engagé dans la promotion d’une « justice carbone » africaine. Son intervention, au deuxième jour du Sommet pour le climat en septembre dernier à Addis-Abeba, a mis en lumière la colère d’un continent encore marginalisé sur un marché mondial qui fixe ses prix sans lui.
Responsable d’environ 4 % des émissions de gaz à effet de serre, l’Afrique subit de plein fouet les effets du changement climatique. Or les crédits carbone, qui ont été introduits par le protocole de Kyoto en 1997, permettent théoriquement de remédier à ce déséquilibre historique. Ils offrent ainsi la possibilité de récompenser chaque tonne de CO2 évitée ou séquestrée grâce à un projet de réduction ou de préservation des puits de carbone (océans, forêts, marais, tourbières). En 2015, l’article 6 de l’accord de Paris a établi un cadre permettant aux pays et aux entreprises de générer, de certifier et d’échanger des crédits carbone à l’échelle internationale. Mais comme bien souvent, les pays africains restent pour l’heure désavantagés, faute de tarifs unifiés.
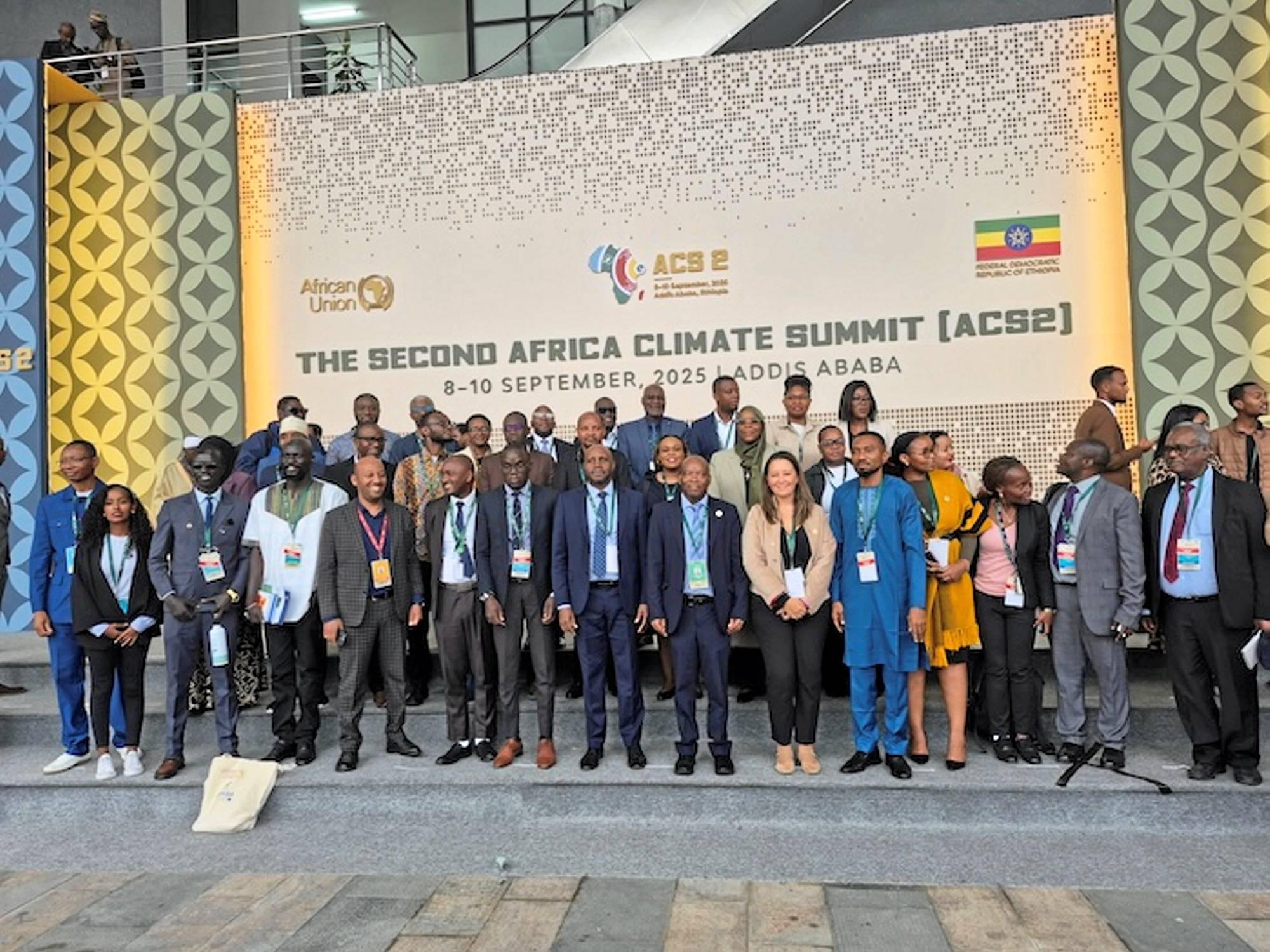
La déclaration adoptée au dernier jour de ce rendez-vous continental appelle à la mise en œuvre du plan d’action africain sur les marchés du carbone, finalisé en février. Le document exhorte « les États membres à renforcer leurs capacités nationales et à établir des cadres réglementaires solides pour les marchés du carbone afin de garantir l’intégrité environnementale, la transparence et le partage équitable des bénéfices pour les communautés africaines ». Mais les défis demeurent nombreux.
Vers une tarification différenciée
« Le premier obstacle, c’est vraiment le manque d’expertise, souligne Nassim Oulmane, qui dirige la section de l’économie verte et bleue au sein de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA). Une approche coordonnée et collaborative sur les processus de suivi, de vérification et de certification des rapports est donc indispensable pour accélérer la crédibilité de l’offre africaine. »
Plus les pays font certifier leurs crédits carbone par des institutions reconnues, plus vite cette crédibilité peut permettre de faire grimper les prix. Le FMI et la Banque mondiale préconisent ainsi d’établir un tarif plancher de la tonne de carbone autour de 75 dollars (environ 63 euros) — bien au-dessus des cinq dollars proposés jusqu’à récemment aux Malgaches.
Depuis l’accord de Paris, la CEA accompagne les États africains dans l’élaboration de registres carbone nationaux et de protocoles harmonisés à l’échelle régionale. Les nations disposant déjà de leur propre registre sont en outre encouragées à soutenir leurs voisines, souvent dépourvues des ressources nécessaires pour bâtir ces écosystèmes.
« Le Gabon, qui renforce de plus en plus son système national de MVR (mesure, vérification et rapportage) pour certifier ses crédits carbone forestiers, pourrait exporter cette expertise vers les pays du bassin du Congo ne disposant pas d’une infrastructure de certification aussi développée. Cette approche leur éviterait d’importer cette expertise à un coût plus élevé depuis des pays développés », illustre Nassim Oulmane. Cet expert appelle par ailleurs à envisager « des mécanismes qui instaurent un tarif mondial mais avec une tarification différenciée qui intègre les niveaux de développement et l’historique des émissions » afin de prendre en compte les spécificités du continent.
La course aux crédits carbone risque d’accroître la dépendance de l’Afrique
« L’Afrique n’est pas un pollueur. Par conséquent, les taxes carbone soulèvent des problèmes de justice et d’équité quand il s’agit d’appliquer les mêmes tarifs au continent alors qu’il est le premier à subir les conséquences du réchauffement climatique, insiste Nassim Oulmane. Les pays africains doivent veiller à ce que l’accord de Paris maintienne son ambition tout en tenant compte de leur nécessaire développement. » Le mot d’ordre du Sommet africain sur le climat consistait précisément à changer de paradigme, appelant les dirigeants africains à s’ériger en acteurs d’un développement durable, plutôt qu’en simples victimes du changement climatique. Cela vaut également pour les crédits carbone. « Nous revendiquerons la souveraineté sur les données climatiques. Nous cartographierons nos propres forêts, mesurerons notre propre carbone et fixerons le prix de nos propres écosystèmes. Les données climatiques ne relèvent pas seulement de la science: elles constituent la nouvelle monnaie du pouvoir », soulignait le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, dans son discours d’ouverture. La course aux crédits carbone risque bel et bien d’« accroître la dépendance de l’Afrique si elle ne parvient pas à consolider son alliance », nous confiait, en marge du sommet, Linda Annala Tesfaye, chercheuse finlandaise postdoctorante au Centre pour la responsabilité des entreprises de l’École d’économie de Hanken.
L’Éthiopie planche sur son propre cadre législatif
« Il est important que l’Afrique mette en place son propre cadre commun pour les marchés du carbone et pour garantir une tarification équitable obligatoire. Autrement, ces crédits seront traités comme pour toutes les autres matières premières, avec des acheteurs qui feront baisser les prix », décryptait la chercheuse. De son côté, le pays hôte planche sur son propre cadre législatif, qui devrait être présenté au Parlement d’ici six mois. Un prix de référence de la tonne carbone sera indiqué, puis négocié avec les États et entreprises intéressés.
« L’objectif principal est de renforcer la participation de l’Éthiopie au marché du carbone international de haute intégrité tout en soutenant les objectifs nationaux en matière de climat et de développement, expliquait une source au sein du ministère de la Planification et du Développement. Nous voulons aussi éviter le double comptage ou la double déclaration des résultats d’atténuation. » Le développement des crédits carbone s’accompagne en effet de nombreux scandales, qui ont, par exemple, fait perdre 5 milliards d’euros de recettes fiscales nationales à des membres de l’Union européenne, en particulier la France et le Danemark.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinée, suivez Africa-Press