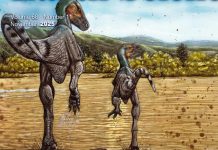Africa-Press – Guinée. Guillaume Coudray est journaliste d’investigation, spécialisé dans les pratiques de l’industrie agroalimentaire. Diplômé de Sciences Po, il est notamment l’auteur de Nitrites dans la charcuterie: le scandale (2023). Son nouvel essai, De l’essence dans nos assiettes. Enquête sur un secret bien huilé, est publié aux Éditions La Découverte. Il y revient sur l’utilisation d’un solvant controversé, l’hexane, employé pour extraire les huiles végétales. Pour Sciences et Avenir, il a accepté d’expliquer les enjeux de l’article de loi voté samedi à l’Assemblée nationale.
Sciences et Avenir: Pourquoi dites-vous qu’il y a de l’essence dans nos assiettes?
Guillaume Coudray: Aujourd’hui, pour extraire l’huile des graines de soja, de tournesol ou de colza, les industriels utilisent un solvant étonnant: l’hexane, un hydrocarbure dérivé du pétrole. L’huile obtenue arrive ensuite dans nos supermarchés, tandis qu’une partie sert à fabriquer gâteaux, viennoiseries et pâtisseries industrielles… Le résidu de cette extraction, appelé tourteau, riche en protéines et fibres, n’est pas gaspillé: il nourrit les animaux dans les élevages industriels. Mais il y a un hic: que ce soit dans l’huile ou dans les tourteaux, des traces d’hexane peuvent persister. Autrement dit, une petite partie de ce dérivé du pétrole se retrouve, indirectement, dans nos assiettes…
« Le tourteau dans lequel il reste de l’huile a une valeur commerciale moindre »
De quelle façon l’huile est-elle obtenue par extraction chimique?
Les graines sont d’abord nettoyées, séchées, décortiquées, aplaties et broyées, jusqu’à former des flocons dont la structure cellulaire est brisée. L’hexane est ensuite pulvérisé sur ces flocons. Le mélange obtenu, appelé miscella, contient entre 70 et 80 % d’hexane et 20 à 30 % d’huile. Ensuite, pour séparer l’huile du solvant, le mix est chauffé à 100 °C et de la vapeur d’eau est injectée.
L’huile brute obtenue est ensuite raffinée grâce à plusieurs traitements chimiques: acidification avec de l’acide phosphorique, neutralisation avec de la soude caustique, blanchiment à l’aide d’argiles, hydrogénation (si nécessaire), désodorisation pour éliminer odeurs et goûts indésirables.
Enfin, l’huile est refroidie, traitée à l’acide citrique et filtrée, et parfois, des antioxydants de synthèse y sont ajoutés pour prolonger sa conservation.
Quels sont les avantages d’une extraction chimique par rapport à une extraction mécanique?
Pour extraire plus d’huile… et donc gagner en rentabilité. Dès le milieu du XIXe siècle, les industriels ont cherché à améliorer l’extraction de l’huile des graines oléagineuses en utilisant des solvants, notamment le disulfure de carbone. Cette technique concernait au départ la fabrication d’huile destinée à la fabrication de savons ou la production d’huiles à usage technique.
Ce n’est qu’au XXe siècle que l’industrie agroalimentaire a repris ce principe et s’est tournée massivement vers un autre solvant, jugé à l’époque plus sûr: l’hexane. Sans utiliser de solvant, il est presque impossible de récupérer les derniers 15-20 % d’huile qui sont contenus dans la graine. L’huile reste alors dans le tourteau destiné aux animaux. Or le tourteau a une valeur commerciale moindre.
Qu’est-ce que l’hexane commercial?
L’hexane est un composé chimique de la famille des alcanes (C6H14).
Il est obtenu par distillation du pétrole ou du gaz naturel et fait partie des fractions légères de l’essence.
Pour l’extraction des graines oléagineuses, on n’utilise pas de l’hexane pur (appelé n-hexane ) mais de « l’hexane commercial ». C’est un mélange d’hydrocarbures, principalement constitué de n-hexane, généralement entre 50 et 70%, mais pouvant descendre à 20% ou monter jusqu’à 80%. Les autres composants sont des isomères, c’est-à-dire des molécules ayant la même formule chimique mais une structure différente et des propriétés physiques sensiblement différentes.
En conséquence, l’hexane qui est utilisé dans les usines d’extraction a une composition chimique très variable selon les fournisseurs et les techniques de distillation qu’ils adoptent. Sa composition non réglementée rend très difficile l’évaluation précise de sa toxicité pour l’organisme humain.
En France, quelles sont les parts de marché des huiles alimentaires extraites à l’hexane?
Il est difficile de le savoir avec précision. C’est l’une des questions auxquelles tente de répondre la mission flash en cours à l’Assemblée nationale.
Dans un rayon de supermarché, la grande majorité de l’offre d’huiles végétales contient de l’huile qui a été extraite grâce à ce solvant. Il faut noter que les producteurs de taille artisanale ne recourent jamais à cet hydrocarbure. Dans le bio, cette méthode est interdite par le cahier des charges. Quant à l’huile d’olive, qu’elle soit bio ou non, les industriels n’utilisent pas l’hexane, sauf lorsque l’étiquette précise que l’huile a été obtenue à partir de grignons d’olive.
Ce solvant est-il également utilisé pour l’extraction d’autres types de produits?
Oui. L’hexane peut être utilisé pour extraire des arômes naturels ou des huiles essentielles, pour des extractions d’actifs destinées à des produits cosmétiques, ou encore pour la production de colorants, par exemple l’extrait gras de paprika. Cet hydrocarbure peut aussi être utilisé pour extraire de l’huile de lin, de l’huile de pépins de raisin, de l’huile de sésame, de l’huile de germe de blé… mais cela représente des volumes nettement moins importants que l’huile de tournesol, de colza et de soja, qui représentent, les principales matières premières qui sont traitées par le procédé hexanique.
Le consommateur peut-il connaître le mode d’extraction de ces huiles en lisant les étiquettes?
Non. Du point de vue réglementaire, l’hexane est considéré comme un « auxiliaire technologique », c’est-à-dire qu’il est supposé ne servir qu’à la production de l’aliment, et ne pas constituer un ingrédient de la recette. Le règlement européen de 2008, qui encadre l’utilisation des additifs dans les aliments, n’exige donc pas son indication sur l’étiquette. Cela pose évidemment un problème en matière de droit à l’information du consommateur, qui n’est pas informé de la présence éventuelle de résidu d’hexane dans le produit qu’il achète.
Les règles autorisent une perte comprise entre 550 et 700 g d’hexane par tonne de graines traitées, une partie restant dans l’huile et une autre étant émise dans l’atmosphère. Depuis 2009, la législation européenne fixe la limite maximale à 1 mg d’hexane par kilogramme dans les huiles, les graisses et le beurre de cacao.
Cette norme repose sur des données obsolètes, notamment sur des évaluations datant des années 1990, réalisées par les industriels, au cours desquelles de l’hexane était administré à des rats et des souris pendant quelques mois, sans lien direct avec les conditions réelles de consommation humaine.
D’alleurs, dans un rapport publié en septembre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu qu’ »il est nécessaire de réévaluer la sécurité de l’utilisation de l’hexane technique comme solvant d’extraction dans la production de denrées alimentaires et d’ingrédients alimentaires », à la lumière des nouvelles données scientifiques.
« L’hexane a notamment des effets délétère sur la fertilité, aussi bien chez l’homme que chez la femme »
Et pour les tourteaux donnés aux animaux?
La réglementation actuelle fixe la limite maximale à 1 kilogramme de résidus d’hexane par tonne de tourteau, ce qui est considérable. Les industriels affirment qu’une très grande partie du solvant résiduel dans les tourteaux serait perdue lors de l’entreposage, du transport et de la transformation alimentaire. Mais des analyses indépendantes ont bien montré des teneurs résiduelles mesurables dans les tourteaux commercialisés, en particulier celles récemment menées par Greenpeace France. Or, aucune étude complète n’existe à ce jour concernant les effets de la présence d’hexane, tant sur la santé des animaux que sur la qualité des produits issus de leur élevage. D’après une étude publiée en 2025, des résidus d’hexane ont été détectés dans 5 sur 6 échantillons de lait de vaches nourries avec du tourteau extrait à l’hexane.
Dans votre livre, vous dites que ce n’est pas l’hexane qui est dangereux en soi
Oui. Lorsque l’hexane est présent dans l’organisme, le corps cherche à s’en débarrasser au niveau du foie, en l’oxydant, c’est-à-dire en le faisant réagir avec des molécules d’oxygène. À l’issue de ce processus, il se forme une molécule appelée 2,5-hexanedione (2,5 HD).
C’est ce métabolite qui est toxique. La 2.5 HD a fait l’objet d’un nombre considérable de publications. Un article scientifique datant de 2022, faisant la synthèse des connaissances sur le sujet, rappelle qu’il à la fois nocif pour les systèmes nerveux et reproducteur. Cet article souligne que des recherches récentes ont mis en évidence de nouveaux effets toxiques possibles, notamment en matière de perturbation endocrinienne. Dans mon livre, je dresse un tableau aussi complet que possible de l’état de la recherche en 2025 en ce qui concerne les liens entre l’exposition à l’hexane et les maladies neurodégénératives (telles que les polyneuropathies périphériques, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques). Je décris également l’état des connaissances scientifiques concernant l’effet délétère de l’hexane et de son métabolite (la 2,5 HD) sur la fertilité, aussi bien chez l’homme que chez la femme.
Connaît-on les concentrations d’hexane dans les produits alimentaires vendus en France?
Oui, grâce à deux enquêtes récentes. En mai dernier, la cellule investigation de Radio France a révélé la présence de résidus d’hexane dans de nombreux produits alimentaires. Sur 54 échantillons analysés par le Centre commun de mesures de l’université de la Côte d’Opale à Dunkerque et un laboratoire privé, près de la moitié contenaient des traces mesurables de ce solvant. Les concentrations détectées allaient de 0,01 à 0,4 mg/kg, grâce à des méthodes bien plus sensibles que celles utilisées pour fixer la limite réglementaire.
Quelques mois plus tard, en septembre, Greenpeace publiait à son tour un rapport sur une cinquantaine de produits vendus dans les supermarchés — huiles, volailles, produits laitiers et laits infantiles. Résultat: des traces d’hexane allant jusqu’à 80 microgrammes par kilogramme, les huiles étant les plus contaminées, suivies du beurre, des laits infantiles et du lait de vache.
Ces concentrations restent dix fois inférieures à la limite maximale autorisée par l’Union européenne. Mais c’est bien là le problème: cette norme repose sur des données anciennes, sans prendre en compte l’exposition répétée des consommateurs au fil du temps, surtout pour les plus fragiles (nourrissons, enfants, femmes enceintes, personnes ayant des prédispositions génétiques aux maladies neurodégénératives,…).
Et pour les professionnels travaillant avec ce solvant?
L’exposition à l’hexane est dangereuse pour les personnes manipulant ce solvant, et les conséquences de cette exposition sont reconnues comme maladie professionnelle depuis 1973. L ’ANSES a plusieurs fois rappelé ses effets neurotoxiques et reprotoxiques, conseillant dès 2014 aux femmes enceintes d’éviter toute inhalation via peintures, colles ou aérosols.
L’hexane est également très inflammable et fortement explosif, et des accidents graves ont marqué l’histoire industrielle française: Marseille (1952), Bordeaux (1991), Soustons (2004) et, plus récemment, Dieppe (2018), où deux employés ont perdu la vie.
Où en sommes-nous aujourd’hui?
Une prise de conscience s’installe: l’hexane figure désormais dans les agendas scientifiques et politiques. Le 7 octobre, une trentaine de scientifiques et professionnels ont publié dans Le Monde une tribune demandant une révision des seuils autorisés, voire l’interdiction de ce solvant, au profit d’alternatives déjà disponibles. En mars dernier, une première proposition de loi visant à interdire l’hexane avait déjà été déposée.
Samedi 8 novembre, un pas en avant capital a été accompli à l’initiative du député Richard Ramos: l’adoption en première lecture d’un article dans la loi de financement de la sécurité sociale prévoit qu’à partir du 1er janvier 2026, toutes les entreprises produisant, vendant ou important du n-hexane devront verser une contribution de 0,003 € par litre. La moitié de cette somme financera la conversion des outils industriels vers des alternatives sans hexane, l’autre moitié des actions de prévention, et le produit de cette contribution sera reversé à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Espérons que ce texte soit définitivement adopté, car le consommateur reste scandaleusement démuni face à la présence de résidus d’hexane dans les aliments du quotidien.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinée, suivez Africa-Press