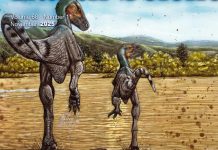Africa-Press – Guinee Equatoriale. Au terme du premier G20 africain, les fractures du système économique mondial sautent aux yeux. Pour l’experte kenyane Attiya Waris, remettre la justice fiscale au cœur du multilatéralisme est urgent.
Au centre de ce G20 sud-africain, un mot a hanté les couloirs des délégations: inégalités. Derrière les discours sur l’inclusion ou le « multilatéralisme réinventé », les discussions ont buté sur les mêmes lignes rouges — la taxation des ultra-riches, l’accès à l’information financière et le poids écrasant de la dette dans les budgets africains. Attiya Waris, spécialiste reconnue des politiques fiscales mondiales, observe d’un œil critique une présidence sud-africaine « volontaire mais isolée » et un G20 « paralysé par l’année Trump à venir ». Elle analyse, pour Le Point Afrique, les angles morts d’un ordre économique mondial qu’aucune grande puissance ne semble prête à réformer.
Le Point Afrique: L’égalité est l’un des thèmes principaux du G20. Qu’a accompli la présidence sud-africaine, qui s’achève avec ce sommet, pour faire bouger les lignes?
Attiya Waris: Des progrès ont été réalisés vers un certain rééquilibrage dans l’espace du G20. Le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud ont déployé des efforts considérables pour avancer ensemble. Le simple fait que l’Union africaine soit désormais membre du G20 par exemple en est un.
Mais ce sont des avancées minimes et chèrement acquises. Et je crois, malheureusement, que la volonté mondiale d’un espace plus égalitaire n’est pas encore présente.
Cette année, l’Afrique du Sud a fait ce qu’elle a pu pour faire avancer le débat, mais les pays européens et les autres membres du G20 sont occupés à chercher leur voie dans le contexte actuel de déclin du multilatéralisme, et se posent aussi la question de savoir si cela vaut la peine de consacrer du temps et de l’énergie dans ces débats alors que les Etats-Unis s’apprêtent à prendre la présidence du G20. Cela freine probablement beaucoup les négociations, car les engagements pris cette année pourraient ne plus avoir aucune valeur l’année prochaine.
Au G20 de Rio, les dirigeants avaient promis d’avancer sur la taxation des ultra-riches. Un an plus tard, force est de constater que le dossier n’a guère bougé. Pourquoi?
Non, je ne pense pas qu’ils soient réellement parvenus à la mettre à l’agenda. Et je pense qu’il y aura une forte opposition de la part des ultra-riches.
Mais nous devons avoir des conversations très ouvertes et honnêtes car nous sommes à nouveau en pleine crise économique mondiale. Et cela se traduit par des réalités, beaucoup de gens ont du mal à se nourrir.
La taxation des personnes fortunées est cruciale. Or, je constate déjà une incapacité à définir ce que cela signifie. On entend parler d’élite, de super-élite, de super-riches, d’ultra-riches. Le vocabulaire autour des personnes fortunées est abondant, mais il n’existe pas de définition claire. Il y a un manque constant de consensus sur la définition des termes. Et si nous ne parvenons pas à une compréhension commune d’un mot ou d’une expression, nous ne pouvons pas, par exemple, conclure un traité. Nous ne pouvons même pas parvenir à un accord. Comment taxer une personne qui n’est pas définie? De qui parle-t-on? Il faudrait un débat clair sur ce sujet, mais malheureusement, je n’ai pas vu cela se produire jusqu’à présent au G20.
Nous devons parler de la taxation de l’économie numérique, de toutes ces nouvelles fortunes créées grâce à ces industries très innovantes qui ne sont pas imposées. C’est presque illogique, quand on y pense. Ils bénéficient de subventions et de crédits d’impôts, et une fois bien installés, ils ne contribuent toujours pas aux impôts.
C’est l’une des conclusions du rapport commandé par la présidence sud-africaine et dirigé par l’économiste Joseph Stiglitz. Les 1 % les plus riches du monde ont accumulé 41 % de toutes les nouvelles richesses créées entre 2000 et 2024. Durant la même période, seulement 1 % des nouvelles richesses est allé aux 50 % les plus pauvres. Quel est votre avis sur ce rapport?
Je pense que c’est un bon rapport. Il met en lumière les problèmes clés. J’espère qu’ils seront abordés sérieusement et qu’ils susciteront des discussions, mais je n’anticipe pas de décisions pour le moment. Je ne vois pas vraiment ce qui va en ressortir. C’est très flou pour l’instant.
On parle aussi de la création d’un groupe d’experts internationaux pour avancer sur les questions d’inégalités, j’espère que cela se fera, mais je n’en vois pas encore la concrétisation, et dans mes cercles je n’ai eu de retour d’aucun expert qui aurait pu être contacté.
Que pourrait changer ce groupe d’experts?
Il y a actuellement trois principaux enjeux financiers mondiaux: la dette, la fiscalité et les flux financiers illicites. Si nous pouvions mettre en place un groupe d’experts de haut niveau, véritablement multidisciplinaire, couvrant ces trois domaines et se concentrant sur les inégalités, ce qui est crucial, il serait possible que, même en l’absence de consensus mondial ou de consensus du G20, des idées émergent et soient prises au sérieux à l’échelle des pays et des régions. Nous pourrions assister au début d’un rapprochement entre groupes de nations pour tenter de corriger ces inégalités progressivement.
Ils pourraient aussi exiger la mise en place de bases de données publiques. C’est essentiel. Les gouvernements manquent d’accès à l’information, et les citoyens aussi ignorent les tenants et les aboutissants des engagements pris par leurs gouvernements. C’est très inquiétant à une époque où la confiance est en net déclin.
Par exemple, tous les accords de dette sont privés. Vous connaîtrez donc le montant de la dette et le taux d’intérêt. Mais vous ignorerez souvent les modalités et conditions. Or, nombre de ces modalités comportent actuellement un volet fiscal. Cela signifie que la politique fiscale du pays débiteur est donc désormais sous le contrôle du créancier. Ainsi, si vous souhaitez augmenter l’impôt sur le revenu, on pourrait vous recommander d’augmenter plutôt la TVA. Le FMI par exemple est connu pour son penchant à pousser pour des augmentations de TVA.
La question de la dette est centrale, particulièrement dans le sud global. Plus de 40 % des pays africains dépensent ainsi davantage aujourd’hui pour le service de leur dette que pour la santé. Quelles sont les problématiques en jeu?
Elles sont nombreuses. Par exemple, lorsqu’un nouveau gouvernement arrive au pouvoir, il découvre souvent à ce moment là les accords d’endettement contracté par ses prédécesseurs. Cette situation prend les pays au dépourvu. Surtout lorsque des dettes sont contractées juste avant des élections, elles sont parfois utilisées à des fins de campagne politique. Il en résulte une mauvaise gestion quasi immédiate de la dette. Cependant, ces dirigeants qui l’ont contracté ne sont pas ceux qui vont devoir la rembourser. Donc le nouveau gouvernement se retrouve dans une situation impossible: Il doit planifier la construction des infrastructures et commencer le remboursement de la dette, mais il n’en a déjà plus les moyens. On se retrouve ainsi face à un cercle vicieux inextricable.
D’autant que la crise de la dette a été aggravée par l’épidémie de Covid-19…
Oui, la crise du COVID a indéniablement aggravé le problème de la dette. La pandémie a bouleversé toutes les données économiques, mais les dettes et les taux d’intérêt n’ont pas été gelés. Par conséquent, les analyses, les emprunts et les échéanciers de remboursement actuels des pays sont désormais complètement déconnectés de leur situation économique réelle.
De ce fait, la dette contractée, censée stimuler la croissance et permettre le remboursement, ne remplit plus cette fonction. Résultat: on va opérer des coupes budgétaires dans les dépenses sociales, la santé et l’éducation, qui sont toujours les premiers postes de dépenses à être sacrifiés pour rembourser la dette.
Actuellement, je n’entends aucune réflexion sur les conséquences de la Covid, et cela m’inquiète beaucoup.
Comment sortir de ce cercle vicieux?
En 2000, on a assisté à l’annulation de plus de 100 milliards de dollars de dette internationale. Je crois fermement à la nécessité d’annuler la dette, surtout celle des pays en développement. Le Vatican soutient d’ailleurs cette mesure. Le Pape a appelé à un jubilé dédié à la remise de la dette des pays du Sud. C’est un des appels internationaux à geler et annuler la dette. Je trouve intéressante aussi l’idée de vendre une partie des réserves d’or du FMI pour annuler la dette, notamment celle des pays à faible revenu.
Mais on ne peut pas se contenter d’annuler la dette et s’arrêter là. Il faut au contraire faire comme les États-Unis avec l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale: geler la dette, puis donner un coup de pouce au pays pour qu’il puisse remettre son économie sur les rails.
Il faut veiller à ce ces pays puissent percevoir des recettes, pour leur donner un peu d’espace et permettre de briser le cycle, et repartir sur de bonnes bases avant de contracter de nouvelles dettes.
Malgré la crise économique mondiale, je pense qu’il est essentiel aujourd’hui de dépenser, en ciblant les populations les plus défavorisées. Les classes populaires sont aujourd’hui dans une situation extrêmement difficile. Les pays les moins avancés sont dans une situation catastrophique, tout comme les petits États insulaires en développement, qui risquent de sombrer sous le poids du dérèglement climatique. Il est essentiel d’en tenir compte, et d’humaniser le débat.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinee Equatoriale, suivez Africa-Press