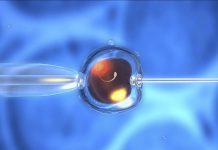Africa-Press – Guinee Equatoriale. Sous l’effet conjoint de la hausse globale des températures et de la fonte des glaces des pôles, le niveau de la mer monte de 3,6 millimètres par an. Dans le même temps, les côtes européennes s’affaissent de plus de 1 millimètre.
Ce phénomène dit de “subsidence” aggrave ainsi les risques liés à l’érosion du littoral et aux submersions marines. C’est le principal enseignement à tirer du travail du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) que vient de publier la revue scientifique Earth’s Future.
Les chercheurs sont arrivés à ce résultat en croisant les mesures de deux instruments, l’un ancien, le GPS, l’autre très récent puisque le “service européen de surveillance des mouvements du sol” du programme satellitaire Copernicus fournit des données sur les mouvements des sols au niveau européen depuis 2015 grâce à un interféromètre radar embarqué sur un des satellites de la constellation Sentinel.
Le service gratuit ouvert à tous types d’utilisateurs permet de surveiller à l’échelle du millimètre les incessants mouvements de terrain ainsi que les changements apportés à la surface terrestre par les tremblements de terre. “Nous avons donc eu l’idée d’appliquer ce service aux littoraux afin d’en vérifier la stabilité”, narre Rémi Thieblemont, chercheur spécialisé sur le changement climatique et les risques côtiers au BRGM et co-auteur de l’article.
Avec la subsidence, la mer monte de 5 millimètres par an
Le résultat est inquiétant. Près de la moitié des littoraux de plaines européens s’enfoncent de plus de 1 mm par an. Si on ajoute la subsidence à la hausse du niveau des mers, c’est autour de 5 mm par an de montée des eaux que subissent la plupart des côtes.
Les causes sont à la fois naturelles et anthropiques. Ainsi, la Scandinavie fait elle exception avec une hausse de l’altitude de cette région du monde du fait de la fonte de la couverture glaciaire. Soulagé du poids de glace qui, au maximum glaciaire il y a 20.000 ans pouvait dépasser les trois kilomètres d’épaisseur, le sol se relève.
“Mais la redistribution des masses au sein du manteau terrestre fait qu’à la périphérie de ces régions, le sol au contraire s’abaisse” poursuit Rémi Thieblemont. Un autre phénomène naturel affecte les deltas des fleuves.
Cette fois-ci, c’est l’accumulation des sédiments qui par leur poids provoque l’affaissement du sol. L’action de l’homme aggrave ces mouvements selon deux causes principales. La première, c’est l’extraction de gaz ou d’eau dans les régions littorales, la seconde c’est le poids des constructions et des infrastructures qui pèsent sur des sols généralement sédimentaires.
On retrouve ces contraintes mêlées sur les deux principales régions européennes concernées par la subsidence. La première, c’est la région nord des Pays-Bas. “L’exploitation du gaz naturel est ici en cause avec la situation géographique de la région, qui s’abaisse car elle est en bordure de ce nord européen qui se soulève”, détaille Rémi Thieblemont.
La seconde région européenne la plus affectée, c’est la plaine du Pô, en bordure de l’Adriatique. Cette-fois ci, la compaction sédimentaire, des mouvements tectoniques, ou encore des ajustements isostatiques s’ajoutent à l’exploitation des nappes phréatiques (jusque dans les années 1970 où les autorités ont décidé l’arrêt des pompages) et au poids des infrastructures côtières. C’est ainsi que Venise s’enfonce.
Un risque accru de submersions marines
La France ne connaît pas de subsidence aussi importante. Deux zones particulièrement affectées sont l’aéroport de Nice construit en partie sur la mer et la région des lagunes languedociennes principalement autour de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault). “Mais si l’on regarde plus attentivement des périmètres plus restreints, on détecte des subsidences importantes sur des zones portuaires comme le Havre ou la partie est du port de Brest”, note Rémi Thieblemont. Dans ces cas-là, il est probable mais pas prouvé que ce sont la création de nouvelles infrastructures qui expliquent l’affaissement des sols.
La subsidence augmenterait ainsi en moyenne de 25% l’élévation du niveau des mers actuelle. Et elle est plus forte là où les aménagements pèsent sur les sols. Or, les ports accueillent aujourd’hui de nouvelles activités qui multiplient les besoins en bâtiments et en infrastructures.
Les ports méthaniers sont ainsi destinés à accueillir du gaz liquéfié destiné à remplacer le gaz russe tandis que le développement des parcs éoliens offshore augmentent les besoins en usines de construction et de maintenance. Le travail du BRGM sonne ainsi comme un avertissement. Pour tout projet futur sur le littoral, il faudra dimensionner les ouvrages de protection contre les submersions marines en prenant en compte à la fois la hausse du niveau des mers et l’affaissement des terres.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinee Equatoriale, suivez Africa-Press