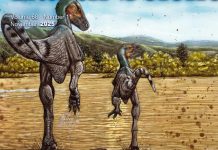Africa-Press – Guinee Equatoriale. L’autonomie et la recharge sont les deux principaux verrous technologiques qui pèsent sur la voiture électrique. Mais les solutions existent et certaines sont même déjà au stade de la commercialisation.
1. À quand 1000 km d’autonomie ?
Ce sont les marques chinoises qui ont, les premières, avancé ce chiffre mirobolant. GAC, tout d’abord, avec l’Aion LX Plus équipée d’une batterie de 144 kWh au graphène. Ce matériau est un dérivé du graphite, lui-même issu du carbone. Encore cher, il présente malgré tout de gros avantages : charge rapide (les électrons circulent 100 fois plus vite que dans le silicium d’une batterie lithium-ion) et gains en poids et volume. Zeekr, ensuite, avec la 001 qui innove par l’intégration de sa batterie 140 kWh, dont les cellules sont directement dans le châssis. Cela permet de gagner en poids (les batteries n’ont plus besoin de structure propre) et en quantité de cellules (positionnement optimisé dès la conception du châssis).
Attention cependant, l’autonomie de la GAC a été mesurée selon l’ancien protocole NEDC et celle de la Zeekr selon la norme chinoise CLTC. Des cycles plus optimistes que le WLTC appliqué en Europe, ce dernier étant lui-même plus optimiste que les conditions réelles de roulage…
2. Pourrait-on simplement changer de batterie ?
Le principe de battery swap (échange de batterie) est défendu par le constructeur chinois Nio, qui a déployé plus de 1300 stations d’échange dans son pays d’origine et s’apprête à en ouvrir en Europe. Le principe est simple : la voiture entre dans une station d’échange en forme de gros conteneur ; elle se positionne sur la plateforme et un système robotisé remplace la batterie vide par une pleine. L’échange ne prend pas plus de 5 minutes, contre 25 minutes de charge sur une borne rapide (de 10 à 80 % de la batterie).
Sur les plus grosses stations déjà installées dans les mégalopoles chinoises, dont Shanghai, la capacité d’échange constatée atteint les 150 par jour. Ce système souffre pour le moment d’une absence de standardisation des packs de batteries entre les marques, et de la lourde mise en place des stations qui demandent un investissement initial bien supérieur aux bornes.
3. La recharge va-t-elle s’accélérer ?
La vitesse de recharge dépend de plusieurs facteurs, à commencer par la puissance de la borne. En France, c’est Tesla qui avance la valeur la plus élevée avec 250 kW (pour rappel, puissance en watts = tension en volts × intensité en ampères) sur ses superchargeurs V3, et bientôt 350 kW sur les V4. Mais ce sont les marques chinoises qui sont encore les mieux-disantes : Nio a annoncé une borne capable d’atteindre une puissance de 500 kW, alors que le groupe Geely (Volvo, Smart, Zeekr) table sur 600 kW. Cela permettrait de recharger une batterie (de 10 à 80 %) en 12 minutes, contre 25 minutes pour les meilleurs modèles actuels.
Mais augmenter la puissance d’une borne entraîne une intensité élevée qui fait peser des contraintes (risques de surchauffe, voire d’incendie) sur les câbles et les batteries. Une solution consiste à augmenter la tension et réduire l’intensité. Mais les modèles dotés d’un système 800 volts sont encore rares, la plupart fonctionnant en 400 V. Il est aussi possible de travailler sur le refroidissement : grâce à une technologie spatiale, la Nasa a développé un chargeur capable de délivrer 1400 ampères sans surchauffe du câble. Une telle valeur permettrait de recharger une batterie en… 5 minutes.
4. La charge par induction est-elle réaliste ?
Plus de câble ici, la recharge se fait grâce à un champ électromagnétique entre une bobine située dans le sol et une sous la voiture. Tous les constructeurs travaillent sur une telle solution et en particulier Tesla qui, lors du dernier “Investor day”, a laissé apercevoir un tel système au détour d’une photo… Cette technologie a deux inconvénients : sa puissance limitée (20 kW aujourd’hui) et les fortes déperditions (plus de 20 %).
Mais l’université de Chalmers, en Suède, a annoncé avoir mis au point un dispositif pouvant atteindre 500 kW, tout en réduisant les pertes à moins de 3 %. Des résultats obtenus grâce à l’utilisation de carbure de silicium pour les semi-conducteurs, matériau déjà utilisé, en 2019, par l’Oak Ridge National Laboratory, aux États-Unis, pour faire fonctionner un système de 120 kW. À terme, cette solution pourrait être intégrée dans le revêtement routier, ce qui permettrait aux voitures électriques de se recharger en roulant.
5. L’hydrogène est-il la solution ?
La voiture à hydrogène ne stocke pas l’électricité mais la produit à bord. Cela présente plusieurs avantages : le plein ne prend pas plus de temps qu’un plein d’essence, l’autonomie offerte est équivalente et la transformation de l’hydrogène en énergie ne dégage que de l’eau. Mais trois freins pénalisent encore cette technologie. Le premier est le coût induit par une pile à combustible (qui transforme l’hydrogène en énergie) et le réservoir d’hydrogène (capable de supporter des pressions de 700 bars). La berline Toyota Mirai s’affiche à 71.500 euros et le SUV Hyundai Nexo à 80.600 euros !
Le défi de la distribution est également complexe et seules une vingtaine de stations sont accessibles au grand public. Enfin, il faut que la production d’hydrogène soit neutre en carbone. On parle d’hydrogène “vert” lorsqu’il est produit par électrolyse de l’eau et que cette opération n’utilise que de l’électricité renouvelable. Cela a un prix : l’hydrogène “vert” coûte environ 5 euros /kg contre 1,50 euro/kg pour le “gris”, selon le spécialiste BloombergNEF. Mais ce prix devrait diminuer grâce à la multiplication des équipements d’électrolyse, la baisse du prix de l’électricité zéro carbone et le soutien des États.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinee Equatoriale, suivez Africa-Press