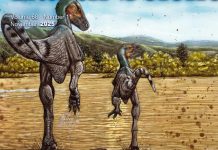Africa-Press – Guinee Equatoriale. Lequel du volcan ou de la météorite est à l’origine de l’extinction des dinosaures, il y a 66 millions d’années ? Des chercheurs ont programmé un modèle informatique pour qu’il réponde à cette question et tranche sur ce débat de longue date. En deux jours, il a analysé plus de 300.000 scénarios en les comparant aux données d’archives fossiles et n’en a retenu qu’un seul.
Depuis la découverte, par Luis et Walter Alvarez, du cratère de Chicxulub au Mexique, causé par un astéroïde de plusieurs kilomètres de large, le débat fait rage entre les scientifiques : les dinosaures ont-ils finalement été tués par cet impact, ou plutôt par le déversement de gaz provenant de volcans dans la région de l’Inde actuelle ?
Des chercheurs du Dartmouth College (Etats-Unis) ont expérimenté une nouvelle approche, en retirant les scientifiques de la discussion. Ils ont conçu un programme informatique capable d’analyser des milliers d’archives fossiles. A partir des données géochimiques et organiques que ces fossiles contiennent, le réseau de processeurs a tranché : l’extinction du Crétacé-Paléogène (K-Pg) serait attribuée à de grands volcans, connus sous le nom de trapps du Deccan. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Science.
Analyser les fossiles… à l’envers
Pour analyser les conditions climatiques d’une période, les chercheurs disposent d’une source d’information précieuse : les fossiles, qui enregistrent et figent la température et la chimie des océans à un instant t. Dans la plupart des modèles informatiques, les scientifiques proposent un scénario et le programme compare le résultat à ces archives fossiles, c’est le sens “direct”. “Leur portée est limitée car les scientifiques donnent des “causes” à un ordinateur, qui analyse les effets”, explique Alexander Cox, premier auteur de l’étude pour Sciences et Avenir.
Au contraire, un modèle dit “inverse” utilise les “effets” comme données d’entrée et s’efforce de trouver leurs causes. Le programme qu’ont élaboré les chercheurs américains utilise donc les données géochimiques capturées dans les fossiles pour comprendre les changements environnementaux qui se sont opérés à l’époque de l’extinction des dinosaures. “Nous ne pouvons pas observer directement la quantité de gaz qui a été rejetée par les volcans du Deccan, par exemple, mais nous pouvons observer les changements chimiques qui se sont produits à cette époque, tels qu’ils sont enregistrés dans les fossiles”, résume-t-il.
Les chercheurs ont une idée précise du climat qui devait régner alors. La composition de l’atmosphère la rendait instable. Chargée en soufre, elle empêchait le soleil d’atteindre le sol, et emmagasinait de la chaleur à cause des minéraux en suspension dans l’air et du dioxyde de carbone. Restait à identifier leur origine.
128 processeurs interconnectés
Pour cela, l’équipe d’Alexander Cox a établi un réseau de processeurs interconnectés : 128 exactement. Chacun est capable d’analyser des données géologiques et climatiques sans intervention humaine et de comparer ses résultats avec les autres processeurs dans le but d’affiner son hypothèse. “Nous proposons à un processeur une première estimation des émissions de dioxyde de carbone et de soufre, aux alentours de la limite d’extinction, ainsi que d’autres facteurs biologiques. Le modèle calcule ensuite les conditions et la température qui résulteraient de cette quantité de gaz”, précise Alexandre Cox.
Un “score” est alors attribué au résultat, en fonction de la qualité du modèle. Le processeur modifie ensuite de manière aléatoire la quantité de dioxyde de carbone et de soufre, puis exécute à nouveau le modèle et lui attribue un nouveau score. Si le score est meilleur, il considère cette nouvelle solution comme la meilleure estimation actuelle. “Lorsque 128 processeurs travaillent en interconnexion, cela signifie qu’une fois que chaque processeur a terminé ses calculs, ils peuvent comparer les résultats entre eux et parvenir à une solution plus rapidement”, indique le chercheur.
Les volcans en cause
Il aura fallu seulement 48 heures à ce programme pour quantifier les émissions de gaz nécessaires aux perturbations chimiques enregistrées dans les fossiles de cette période. “Celles-ci correspondent à nos estimations concernant les grands volcans du Deccan”, affirme Alexander Cox. Les trapps du Deccan étaient en effet en éruption depuis 300.000 ans avant que l’astéroïde Chicxulub ne percute la Terre. Au cours de leurs éruptions, étalées sur un million d’années, ils auraient donc rejeté 10.400 milliards de tonnes de dioxyde de carbone et 9.300 milliards de tonnes de soufre.
Au moment de l’impact de l’astéroïde Chicxulub, le modèle relève toutefois que l’océan a stocké beaucoup moins de carbone organique. D’après les chercheurs, ce résultat pourrait être dû à la disparition de nombreuses espèces animales et végétales. Par ailleurs, si l’impact a probablement émis du dioxyde de carbone et du soufre, le programme informatique n’a pas identifié d’augmentation significative : l’astéroïde n’aurait donc pas contribué à l’extinction par le biais de ces gaz.
A titre de comparaison, la combustion de combustibles fossiles entre 2000 et 2023 a rejeté environ 16 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère par an : “C’est 100 fois plus haut que le taux d’émission annuel le plus élevé prévu par les scientifiques pour les pièges du Deccan. Bien qu’alarmant en soi, il faudrait encore quelques milliers d’années pour que les émissions actuelles de dioxyde de carbone atteignent la quantité totale rejetée par les anciens volcans”, déclare Alexander Cox.
D’une efficacité redoutable, le modèle établi par les chercheurs du Dartmouth College pourrait être utilisé pour “tout système terrestre dont nous connaissons l’effet mais pas la cause”, d’après les scientifiques. Il pourrait s’agir d’autres extinctions massives, ou du Miocène par exemple, afin d’expliquer les températures très élevées que cette période a connu. Par ailleurs, les chercheurs souhaitent désormais travailler sur la preuve mathématique formelle de leur méthode et sur l’incidence du nombre de processeurs utilisés.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinee Equatoriale, suivez Africa-Press