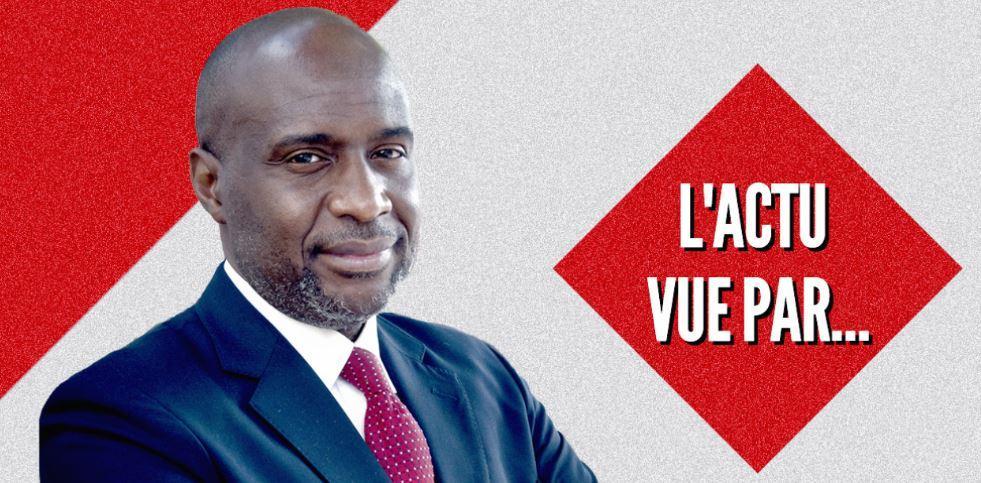Manon Laplace
Africa-Press – Mali. L’ancien Premier ministre, moins critique envers le régime d’Assimi Goïta qu’une grande partie de la classe politique malienne, dresse un bilan nuancé de la transition, trois ans après le coup d’État qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta.
L’ACTU VUE PAR – Le 18 août 2020, un quarteron de militaires renversait le président Ibrahim Boubacar Keïta après des mois de contestation populaire. Trois ans plus tard, le Mali continue de subir les assauts jihadistes et de s’enfoncer dans l’insécurité. Alors que des élections législatives sont prévues pour la fin de l’année 2023, et avant la présidentielle de 2024, une partie de la classe politique craint que la junte, que dirige Assimi Goïta, ne cherche à se maintenir au pouvoir.
Moins tranchant que certains de ses pairs à l’égard des autorités maliennes, Moussa Mara, qui fut Premier ministre en 2014-2015, dresse, pour Jeune Afrique, le bilan de ces trois années de transition.
Jeune Afrique : Le 26 juillet dernier, après le Mali et le Burkina Faso, le Niger a subi un coup d’État. Que vous inspire la prolifération de régimes militaires au Sahel ?
Moussa Mara : Tout d’abord, il convient de définir avec exactitude les événements survenus au Niger. Il s’agit d’un individu qui, pour des raisons de convenance personnelle et profitant de sa fonction de chef de la garde présidentielle, a décidé de séquestrer le chef de l’État. D’autres individus ont saisi cette occasion pour se joindre à lui et perpétrer un coup d’État. Il faut nous demander si c’est ce que nous voulons pour nos pays : voir certaines personnes s’emparer du pouvoir par la force en utilisant les moyens militaires que l’État a mis à leur disposition.
Le message ainsi véhiculé revient à dire que tout dépositaire de la force peut s’emparer du pouvoir. C’est la loi de la jungle ! Je comprends le désenchantement des populations s’agissant de la gouvernance et du comportement des hommes politiques. Mais ces mêmes populations sont périodiquement appelées à choisir pacifiquement leurs leaders. C’est à cette occasion qu’elles peuvent exprimer leur désapprobation. La démocratie est critiquée, mais il n’y a pas, actuellement, de meilleure option. Les putschs n’apportent aucune solution aux problèmes qu’ils prétendent corriger. Que ce soit en matière de sécurité, de gouvernance ou d’économie, ils n’ont aucun impact positif.
Ce bilan s’applique-t-il à votre pays, le Mali ?
C’est un constat général. Il suffit d’observer les pays qui ont subi un coup d’État.
Êtes-vous favorable à une intervention armée de la Cedeao au Niger ?
Cette option n’est souhaitée par personne. Pas même par la Cedeao, dont les dirigeants, qui ont participé à son dernier sommet, le 10 août, disent privilégier la voie de la diplomatie. Misons tout sur cette dernière et sur la politique, avec pour objectif un retour à l’ordre constitutionnel, la réinstallation du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, et cela pacifiquement.
Trois ans après le coup d’État qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta, au Mali, quel bilan dressez-vous de la transition en cours ?
D’abord, les forces armées disposent d’un équipement beaucoup plus important que par le passé, ce qui était attendu de la part d’un régime dirigé par des militaires. Sur le terrain, force est de constater qu’il n’y a pas eu de progrès, pour l’instant, en matière de réouverture d’écoles, de redéploiement de l’administration sur l’ensemble du territoire, ou encore de retour des déplacés chez eux. Mais il faut reconnaître que les attaques dirigées contre les camps militaires maliens ont diminué.
Depuis leur arrivée au pouvoir, les autorités de la transition ont procédé à des renversements d’alliances, notamment dans le domaine sécuritaire. Comment jugez-vous le départ de la force française Barkhane et de la Minusma ?
Le Mali est dans une situation d’extrême fragilité. La communauté internationale doit nous permettre de sortir des difficultés, pas l’inverse. S’isoler, c’est créer les conditions pour qu’adviennent davantage de crises. Depuis l’indépendance, notre pays s’est toujours caractérisé par sa capacité à travailler avec tout le monde et par son non-alignement. Il est dommage de nous détourner de nos partenaires. Il n’y a pas d’avenir pour notre pays en dehors des organisations internationales et régionales.
Au-delà de l’aspect sécuritaire, que pensez-vous des actions entreprises par le gouvernement de la transition ?
Des réformes institutionnelles et politiques ont été engagées, comme celle de la loi électorale ou le vote de la nouvelle Constitution, qui sont une avancée. On ne peut cependant pas tout attendre d’une transition, par définition provisoire. Sa tâche principale est de mettre le pays sur de nouveaux rails et de baliser le chemin d’un retour à l’ordre constitutionnel.
Nous disposons désormais d’un chronogramme qui établit que des élections, à commencer par la présidentielle, doivent se tenir au début de 2024. Il faut maintenant employer tous les moyens nécessaires pour respecter ce calendrier.
Quels sont les chantiers que la transition doit encore mener à bien, selon vous ?
La situation économique reste très difficile, notamment du fait du contexte international. Mais le Mali ne s’est pas effondré. Il tient tant bien que mal, mais il tient.
La contestation populaire qui a précédé le putsch de 2020, et le soutien qu’une partie de la population apporte aux militaires sont autant de symptômes d’un ras-le-bol vis-à-vis de la classe politique. Peut-on organiser des élections sans que la confiance soit restaurée ?
Aller à des élections est un engagement de la transition. Restaurer la confiance n’est pas un préalable. Aux hommes politiques de convaincre qu’ils portent un projet qui rompra avec tout ce qu’on a connu dans le passé en matière de mauvaise gouvernance et de corruption. S’il y a un grand ménage à faire au sein de la classe politique, c’est au peuple de le faire, à travers les élections.
Comment s’assurer que les élections seront transparentes et incontestables dans le contexte actuel, alors que les colonels semblent tout mettre en œuvre pour se maintenir au pouvoir ?
Les Maliens ont récemment [en juin] été appelé aux urnes, à l’occasion du référendum constitutionnel, qui, dans son ensemble, s’est bien déroulé. Il y a bien eu quelques endroits où les populations n’ont pas voté, ce qui est à déplorer, mais, d’après ce que j’ai pu observer sur le terrain, il n’y a pas eu de problème majeur.
Une candidature d’Assimi Goïta à la présidentielle, réclamée par certains de ses soutiens, est-elle souhaitable ?
À ce jour, les membres du gouvernement de la transition n’ont pas annoncé leur volonté de se présenter, alors ne faisons pas de procès d’intention. Par ailleurs, la charte qui organise la transition est très claire : ce document stipule que les acteurs de la transition ne peuvent pas se présenter, et que cette disposition ne peut être modifiée.
Seuls 38% des électeurs se sont prononcés sur le projet de révision constitutionnelle. Ce référendum a-t-il été suffisamment inclusif ?
Il aurait pu l’être davantage – comme la transition elle-même, qui s’est révélée clivante. Mais il faut aller de l’avant, et assurer des élections crédibles et transparentes.
Depuis la signature, en 2015, de l’accord d’Alger, qui tient lieu de cessez-le-feu entre Bamako et l’ancienne rébellion du Nord, la situation n’a jamais été aussi tendue*. Faut-il craindre une reprise des hostilités ?
Il faut tout faire pour l’éviter. Avec le départ de la Minusma, nous entrons dans une période de relative incertitude. Il faut espérer que le voyage du colonel Modibo Koné [pilier de la junte et patron des renseignements maliens] à Kidal sera le premier signe d’une reprise du dialogue. Il est impératif que les discussions bilatérales reprennent, entre Maliens. S’il y a une volonté de rediscuter l’accord, rediscutons-le. S’il n’y a pas lieu de le rediscuter, appliquons-le.
Que répondez-vous à ceux qui estiment que cet accord pave la voie à une partition du pays ?
Depuis le début de son histoire, le Mali est un pays hyper-centralisé, qui fait face à des rébellions. Cessons d’argumenter en dépit du bon sens. Cette hyper-centralisation est en grande partie responsable de l’instabilité qui règne dans le pays. Comment expliquer que, pour avoir accès à l’enseignement supérieur, un jeune de Tombouctou doive encore venir à Bamako ? Que pour avoir accès aux soins, des familles de Gao doivent se rendre à Niamey ? Cette situation n’est pas acceptable, et le seul moyen d’y remédier, c’est de décentraliser.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press