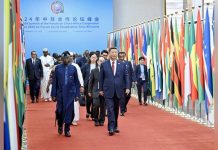Africa-Press – Mali. Un petit sous-marin américain, l’Alvin, embarque une équipe de géologues au large des Galápagos pour observer la tectonique des plaques dans les fonds marins. À 2.500 mètres de profondeur, les chercheurs découvrent pour la première fois des sources hydrothermales, et avec elles une surprise de taille. Autour de ces cheminées géologiques, qui rejettent dans l’eau des fluides pauvres en oxygène, très acides et pouvant atteindre 400 °C, prolifèrent des bancs de moules jaunes, des palourdes blanches, des anémones, des poulpes, des crevettes, des vers tubicoles pouvant atteindre deux mètres de long, des crabes…
Une oasis de vie là où on la pensait impossible, étant donné les conditions qui y règnent: obscurité totale rendant la photosynthèse impossible, température glaciale stagnant entre 0 et 4 °C, et pression pouvant atteindre jusqu’à 1.000 fois celles de la surface. Malgré ces conditions extrêmes, la vie y foisonne. Colorée et diversifiée ! Depuis, au fil d’expéditions menées dans les grandes profondeurs, le bestiaire de la vie abyssale n’a cessé de s’étoffer. Alors, comment toute cette faune peut-elle s’épanouir dans un milieu qui semble a priori si hostile?
Jusqu’à 200 mètres de profondeur, l’environnement marin concentre la majeure partie de la vie océanique connue et décrite. Dans cette zone, dite photique, la lumière du soleil pénètre. Les organismes photosynthétiques qui s’en nourrissent fourmillent et, à leur suite, toute une faune variée: de l’oursin au requin en passant par les coraux, poissons et pieuvres. Au-delà de ce seuil, on entre dans un monde aphotique: la zone crépusculaire, d’abord, jusqu’à 1.000 mètres de profondeur, où règne une pénombre qui interdit la photosynthèse ; puis la zone de minuit, de 1.000 à 4.000 mètres de profondeur ; avant la zone abyssopélagique elle-même, qui va jusqu’à 6.000 mètres et où l’obscurité est… totale? Pas exactement, car les organismes qui vivent dans ce milieu obscur produisent leur propre lumière: c’est la bioluminescence.
« Ce phénomène n’est pas l’apanage des organismes abyssaux, note cependant Séverine Martini, océanographe au CNRS et à l’Institut méditerranéen d’océanologie, à Marseille. Près de 75 % de tous les organismes marins de plus d’un centimètre seraient capables d’émettre de la bioluminescence. » Présent à toutes les profondeurs, le phénomène apparaît cependant plus clairement dans ces zones obscures de l’océan, où il s’inscrit dans de surprenantes stratégies de chasse, de reproduction et de survie.
Au-delà de 200 mètres, et en l’absence de plantes, la chaîne alimentaire repose sur un autre socle: la neige marine. Une « pluie » de flocons blancs, dans laquelle « on trouve tous les produits dérivés de la photosynthèse, explique Jozée Sarrazin, chercheuse en écologie benthique à l’Ifremer. Des algues, du phytoplancton et du zooplancton qui, une fois morts, tombent vers les abysses ». À cela s’ajoutent les déjections et restes d’animaux en décomposition, l’ensemble formant un nuage diffus – et permanent – de particules carbonées suspendues entre deux eaux. Un véritable festin pour les petits poissons, crevettes, gastéropodes et autres vers.
Mais comment trouvent-ils leur chemin vers ces particules infimes? En suivant la lumière, bien sûr ! « Des bactéries bioluminescentes, par exemple, colonisent cette neige marine et, grâce à leur lumière, attirent ceux qui viennent s’en repaître, explique Séverine Martini. Elles profitent alors de la protection du système digestif de leur nouvel hôte pour proliférer avant d’être relarguées dans les selles. » Le secret de ce balisage bioluminescent aux teintes turquoise? L’oxydation d’une molécule, la luciférine, par une enzyme, la luciférase, au sein des bactéries.
Certains de ces micro-organismes ont mis cet atout à profit en développant une relation de symbiose avec d’autres espèces. Ainsi, la bactérie Enterovibrio escacola s’est confortablement installée dans le pédoncule frontal d’un poisson patibulaire devenu dans l’imaginaire collectif une icône des profondeurs océaniques: la baudroie abyssale (Melanocetus johnsonii). Vivant jusqu’à 1.500 mètres de profondeur, celle-ci se sert de cette « lanterne » comme d’un leurre pour attirer ses proies, qu’elle engloutit ensuite dans son immense mâchoire aux dents rétractables.
« Imaginez-vous plongé dans une pièce totalement obscure, propose Séverine Martini. Une lumière qui s’allumerait soudain pourrait avoir sur vous divers effets: vous aveugler, vous faire fuir ou, au contraire, vous intriguer, et inviter à vous approcher. Dans tous les cas, elle véhiculerait une information. » De la même manière, la bioluminescence est un outil de communication dont le dessein varie d’une espèce à l’autre – parfois au sein d’une même espèce. Ainsi, les femelles Linophryne lucifer, qui ressemblent à s’y méprendre aux baudroies abyssales, se servent également de leur lumignon pour attirer des partenaires sexuels. Les mâles, dix fois plus petits, peuvent ainsi les repérer dans l’immensité abyssale. Un sacré exploit… après lequel ils ne lâcheront plus prise ! En effet, ce « parasite sexuel » s’accroche à la femelle avec ses dents, finissant par « fusionner » avec elle jusqu’à sa mort, échangeant son sperme contre des nutriments.
La plupart du temps, les organismes bioluminescents émettent une lumière turquoise, entre le bleu et le vert, la zone du spectre lumineux que peuvent majoritairement percevoir les animaux à ces profondeurs. Mais un excentrique tire son épingle du jeu à contre-courant: le poisson-dragon du genre Malacosteus, qui vit aux alentours de 1.000 mètres de profondeur, diffuse une lueur… rouge ! Plus surprenant encore, il s’en sert pour mieux voir. Grâce à des photophores – des organes où se concentrent des cellules luminescentes, les photocytes – situés dans des replis sous ses yeux, il produit un faisceau « invisible » qui lui permet de repérer et chasser ses proies.
À l’inverse, certains spécimens « éblouissent » leurs prédateurs le temps de filer en douce. Le vampire des abysses (Vampyroteuthis infernalis), un céphalopode d’une trentaine de centimètres vivant entre 600 et 1.000 mètres de profondeur, est lui aussi équipé de photophores, disposés le long de ses bras. Capable de moduler sa bioluminescence, cet animal peut émettre de rapides flashes lumineux pour aveugler et désorienter ses prédateurs, de la même façon que des céphalopodes plus proches de la surface, telle la seiche, se serviraient de leur encre pour distraire un ennemi et s’enfuir.
Dans les grands fonds, il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent…
Si l’on continue de descendre, pour atteindre 3.600 mètres de profondeur environ, on croisera la route de la hachette d’argent (Argyropelecus hemigymnus ), de la famille des sternoptychidés, qui a développé une stratégie encore plus étonnante. Ce poisson passe ses journées bien à l’abri dans l’obscurité de la zone de minuit. Mais, sous le couvert de la nuit, il remonte vers la zone photique, où il se nourrit de crustacés minuscules, comme le krill. Lors de cette migration verticale, durant laquelle il risque d’être attaqué, il recourt à ce qu’on appelle la contre-illumination. Ses yeux captent l’intensité de la lumière qui vient de la surface, et les photophores qui tapissent son ventre s’y ajustent. Ainsi, pour les prédateurs qui nagent à un étage inférieur et scrutent la surface à sa recherche, il est virtuellement invisible !
À mesure qu’on s’éloigne de la surface, la neige marine se raréfie, à force d’être grignotée tout au long de sa descente. Dans les grands fonds, les organismes benthiques – qui vivent sur les sols marins – n’ont plus grand-chose à se mettre sous la dent. Et pourtant… La découverte de l’Alvin en 1977 a montré que la vie peut également foisonner dans ces plaines abyssales présumées désertes. « Le secret de cette prolifération de vie est un procédé connu des biologistes depuis sa découverte en 1890 par le microbiologiste ukrainien Sergueï Vinogradski: la chimiosynthèse « , raconte Marie-Anne Cambon, microbiologiste à l’Ifremer. Ce mécanisme, d’abord observé dans des milieux sombres et pauvres en oxygène, comme des grottes et des sols sédimentaires, permet à certaines bactéries et archées d’utiliser des éléments qui sont d’ordinaire inexploitables, voire toxiques, pour la plus grande part du règne vivant.
« Au lieu de l’énergie solaire qu’utilisent, à la surface, les organismes photosynthétiques, bactéries et archées des profondeurs tricotent de la matière organique à partir de l’énergie chimique – sulfure d’hydrogène, fer, méthane, etc. – qu’ils tirent des fluides rejetés par les sources hydrothermales « , poursuit la chercheuse. Ils produisent ainsi les protéines, lipides et sucres dont ils ont besoin, ce qui fait d’eux la base alléchante d’une tout autre chaîne alimentaire. « La chimiosynthèse permet d’entretenir une énorme biomasse à la biodiversité toutefois limitée, car l’environnement des sources hydrothermales est très contraignant », souligne Jozée Sarrazin. En effet, l’ambiance y est des plus hostiles: obscurité totale, présence de métaux lourds, températures pouvant atteindre 400 °C, radioactivité, forte acidité et pauvreté en oxygène.
Mais certaines créatures se maintiennent aux abords de ces structures géologiques en profitant de la matière organique produite par les micro-organismes chimiosynthétiques. « Certains de ces animaux sont qualifiés d’espèces ingénieures, en raison de leur impact sur l’écosystème », poursuit la chercheuse. Parmi elles, dans le nord-est du Pacifique, les vers tubicoles géants (Riftia pachyptila) ont la particularité de vivre à l’intérieur de tubes qu’ils sécrètent, formant de larges colonies qui s’étendent sur plusieurs mètres carrés. En résulte une vaste « forêt » de tubes dans laquelle d’autres petits animaux, comme des gastéropodes ou des vers, peuvent s’abriter.
Plus surprenant encore, Riftia est un exemple éloquent de symbiose totale et obligatoire. Si la larve de ce ver possède bien un système digestif, elle finit par le perdre lorsque le symbiote chimiosynthétique la colonise, engendrant une métamorphose durant laquelle l’anus et la bouche se ferment. À l’âge adulte, Riftia utilise ses branchies rouges et rétractiles pour capter les éléments chimiques dans l’eau, avant de les acheminer via son système sanguin vers un sac interne de bactéries chimio-synthétiques qui les exploitent pour produire la matière organique (sucres, lipides, protéines…) nécessaire à son alimentation.
Ces symbioses entre faune et micro-organismes se manifestent parfois de manière surprenante. Dans le sud de l’océan Pacifique, un drôle de crustacé rôde près des sources hydrothermales en secouant ses longues pinces velues. Celles-ci sont en effet couvertes de filaments – des soies -, desquels l’animal tient son nom: Kiwa hirsuta, ou crabe yéti. « C’est un cas intéressant, note Marie-Anne Cambon. Le crabe ‘cultive’ des bactéries sur ses soies en agitant ses pinces, le mouvement engendrant un meilleur accès de ses passagères aux éléments chimiques contenus dans l’eau qui l’entoure. Il peut ensuite brouter les tapis bactériens qui se sont ainsi développés sur lui. »
Vivre sans oxygène, c’est possible !
En 1977, des chercheurs faisaient une surprenante découverte dans les profondeurs du golfe du Mexique: des poches d’eau si salées (trois à huit fois plus que le reste de l’océan) et à la densité si élevée qu’elles ne se mélangent pas avec l’eau environnante, et sont totalement dépourvues d’oxygène. Si un animal décide d’y piquer une tête, le manque d’oxygène et le choc toxique dû à l’extrême salinité provoquent chez lui des lésions cérébrales causant rapidement sa mort. En témoigne la quantité de carcasses de poissons, gastéropodes et autres crabes que les chercheurs ont observée à la surface de ces étendues, que l’on a depuis repérées également en mer Méditerranée et en mer Rouge.
Pourtant, ces lacs de saumure – dont la surface s’échelonne entre 1 mètre carré et 120 kilomètres carrés – ne sont pas déserts. Ils sont souvent associés à des suintements froids, des lieux similaires aux sources hydrothermales mais dont les fluides riches en sulfure d’hydrogène, méthane et autres hydrocarbures jaillissent à une température comprise entre 0 et 4 °C. Ces émanations sont propices aux bactéries chimiosynthétiques et à leurs symbiotes, comme les poissons de l’ordre des chimaéridés, ou encore les moules Bathymodiolus, qui tapissent les bordures des lacs de saumure. Plus surprenant encore, certains micro-organismes, comme les archées de l’ordre des halobactéries, raffolent des milieux très salins et prospèrent directement dans les poches d’eau sans oxygène.
Des mécanismes d’adaptation uniques qui alimentent la biodiversité
D’autres animaux profitent de la chimiosynthèse bactérienne sans en dépendre totalement. Les moules du genre Bathymodiolus sont équipées, sur leurs branchies, de véritables communautés de bactéries, où cohabitent plusieurs espèces. « Certaines utilisent le sulfure, d’autres le méthane. On pense que cette diversité de métabolismes permet aux moules de composer avec les variations du milieu », note Marie-Anne Cambon. Mais ces moules ont aussi gardé leur capacité de filtration propre. De même pour la crevette Rimicaris exoculata, qui a la particularité d’héberger ses petits assistants microbiologiques dans son céphalothorax hypertrophié. Elle a quant à elle conservé son système digestif ouvert et fonctionnel. Si le rôle précis de ce dernier reste à élucider, des données publiées en 2022 suggèrent qu’il jouerait un rôle nutritif, détoxifiant et peut-être protecteur, en améliorant son système immunitaire.
Les chercheurs le reconnaissent: l’étendue réelle de la biodiversité abyssale nous échappe encore. Les grands fonds marins représentent 93 % du volume de la biosphère sur Terre, mais à ce jour, environ 25 % ont été cartographiés finement, contre moins de 1 % physiquement exploré. On a coutume de dire que l’on connaît mieux la surface de la Lune que le fond de nos océans, et c’est à juste titre… Ces environnements extrêmes sont peu aisés à atteindre, et les organismes qui y évoluent aussi surprenants que difficiles à observer in situ.
Hélas, cette biodiversité, comme partout ailleurs, est en danger. Les fonds marins, pour leurs ressources en terres rares et autres minéraux, suscitent la convoitise de compagnies minières qui lorgnent du côté des nodules polymétalliques mais aussi des cheminées hydrothermales pour exploiter de potentiels minerais, mettant ainsi en danger des écosystèmes précieux. « La biodiversité des grands fonds constitue pourtant une tout autre richesse, bien plus intéressante et durable, alerte Jozée Sarrazin. Dans les environnements extrêmes qui sont les leurs, l’évolution a pourvu ces organismes de mécanismes d’adaptation uniques. Des enzymes, par exemple, capables de fonctionner à haute pression, et à des températures extrêmes, ou encore des molécules aux propriétés antitumorales, découvertes chez certaines éponges. Il serait catastrophique de perdre toute cette diversité au profit de quelques minerais non renouvelables… »
Le son du corb, le soir, au fond des eaux…
L’océan n’a rien d’un monde du silence. Dans la zone littorale, un micro pourra capter un crépitement, comme celui d’une poêle à frire sur feu vif ou d’une averse franche. C’est le concert des invertébrés: le claquement des grosses pinces d’une crevette, le craquement d’un oursin qui mastique, le grouillement des crabes sur les fonds rocheux… À la nuit tombée, en Méditerranée, monte le chant nuptial d’un poisson, le corb (Sciaena umbra): un roulement de tambour très régulier. Et il n’est pas seul !
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les poissons sont des animaux très volubiles, et leurs vocalisations représentent la plus grande part des sons captés par les éco-acousticiens. Mais quid des grandes profondeurs? Dans l’eau, le son se propage quatre fois plus vite que dans l’air. La vastitude de l’océan résonne ainsi du chœur des cétacés, avec le chant lancinant des baleines à bosse et des baleines bleues, ou encore le caquètement pincé des orques. Le grand cachalot, capable de plonger à plus de 2000 mètres, émet quant à lui des séries de clics sonores pouvant atteindre 230 décibels – 100 de plus qu’un avion au décollage – qui lui permettent de communiquer et de se repérer. Le répertoire des cétacés ne cesse de surprendre. En 2024, des chercheurs américains parvenaient à identifier le rarissime rorqual tropical comme la source d’un son étrange – un grondement grave suivi d’une trille aiguë – enregistré dans les parages de la fosse des îles Mariannes dix ans plus tôt.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press