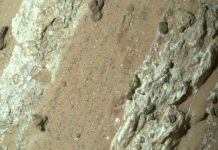Africa-Press – Mali. C’est une étude destinée à fournir de premières bases objectives à un débat conflictuel sur l’exposition des riverains de champs agricoles. PestiRiv, rendue publique le 15 septembre 2025, répond à quatre questions: « les personnes vivant à proximité des vignes sont-elles plus exposées aux pesticides que celles qui en sont éloignées? Quels sont les facteurs qui influencent cette exposition? Varie-t-elle dans l’année? Quels liens entre les niveaux de contamination et l’imprégnation des personnes? », énumère Benoît Vallet, directeur général de l’agence nationale santé environnement (Anses). Le résultat de l’étude peut paraître évident. Oui, les habitants vivant près des vignobles ont des teneurs plus élevées de pesticides dans leur urine et leurs cheveux. Encore fallait-il le vérifier et le prouver.
Conduite en 2021 et 2022, l’enquête a mobilisé d’importants moyens de l’Anses, de Santé publique France (SPF) les deux principaux acteurs, mais aussi d’une dizaine de laboratoires nationaux et des associations régionales de qualité de l’air. « Nous voulions obtenir des données fiables, robustes, en vie réelle des populations aux pesticides, ce qui impose des visites chez les personnes choisies, des prélèvements sur elles mais aussi sur leur environnement, deux périodes pour différencier la saison de traitement des plantes de celles où il n’y a pas d’épandages, ce qui demande du temps et de l’argent », plaide Caroline Semaille, directrice générale de Santé Publique France.
Ainsi, chaque participant a vu son urine prélevée pendant 14 jours, des échantillons de poussière ont été recueillis par aspirateur pendant deux semaines, des recueils d’air ambiant à l’intérieur des maisons pendant sept jours, des prélèvements de légumes et de fruits de jardins quand il y en avait. PestiRiv a ainsi mobilisé 11 millions d’euros, dont 7,5 millions apportés par l’Office français de la biodiversité (OFB).
La vigne choisie car c’est une culture pérenne haute sur pied
L’étude a porté sur 250 communes dans six régions viticoles. 2000 adultes, 750 enfants de 3 à 17 ans, ont ainsi été prélevés d’échantillons d’urine et de cheveux durant la période hivernale et au moment des traitements de printemps et d’été. 56 pesticides ont été recherchés comme le folpel et le cuivre pour les fongicides, le glyphosate pour les herbicides, les pyréthrinoïdes pour les insecticides. Le choix de la vigne s’est imposé. « Il n’était pas possible techniquement et financièrement d’étudier toutes les cultures », avoue Benoît Vallet. La vigne a l’avantage d’être une culture pérenne, au contraire des autres plantes qui suivent des assolements. C’est une culture haute, ce qui implique une pulvérisation des produits dans l’air ambiant. Et enfin, 4% de la population française vit à moins de 500 mètres d’une parcelle viticole. Tout au long de l’enquête, les organisations viticoles, les élus, les associations ont été informés du déroulement de l’opération.
Nous savons donc désormais avec un haut degré de certitude que pour les urines, les poussières et l’air ambiant, les teneurs en produits phytosanitaires sont plus élevés chez les riverains qu’en zones éloignées de toute culture. L’imprégnation urinaire est supérieure de 15 à 45% et l’augmentation de la contamination des poussières est dix fois plus élevée, celle de l’air ambiant 12 fois supérieure. Les jeunes enfants ont des concentrations en polluants plus élevées dans leurs urines, un constat qui confirme les résultats engrangés par des enquêtes épidémiologiques de long terme, comme Elfe et Esteban.
Le cuivre retrouvé partout
Les concentrations sont bien plus fortes en période de traitement (de mars à août). Les deux pesticides dont les teneurs sont les plus élevées sont le folpel et le cuivre, deux produits très utilisés en agriculture. L’étude reste cependant relativement prudente sur l’occurrence des phytosanitaires retrouvés. Les chercheurs n’ont pu accéder aux données réelles d’utilisation des produits qui ne sont pas centralisées au niveau national. Le cuivre et le soufre sont par ailleurs des substances de base de traitement des maladies fongiques comme le mildiou, utilisées aussi bien en viticulture conventionnelle qu’en bio, ce qui gomme toute différence entre les deux types de culture. Deux « règles » sont désormais bien définies: l’exposition augmente quand la distance entre la culture et le logement diminue et la quantité de pesticides utilisés augmente l’exposition des riverains.
En se rendant chez les habitants, les chercheurs ont pu mesurer l’efficacité de quelques gestes simples pour diminuer l’exposition. Ainsi, se déchausser en entrant dans sa maison est un geste efficace. Le nettoyage régulier hebdomadaire des sols, l’installation d’une ventilation mécanique (VMC), le séchage du linge à l’intérieur de la maison en période de traitement, permettent également de réduire les teneurs, ainsi que l’épluchage des fruits et légumes du jardin et la diminution de la consommation des œufs de poules de son poulailler.
Il faudra d’autres études pour connaître les impacts sur la santé
A la suite de ces résultats, l’Anses et SPF font une série de recommandations. « La première, c’est de limiter l’usage des phytosanitaires au strict nécessaire », invite Benoît Vallet. Les deux agences appellent donc à respecter strictement le plan Ecophyto 2030 qui vise une réduction de 50% de l’usage des pesticides. Initiées en 2010, les différentes phases du plan Ecophyto ont jusqu’ici échoué à réduire la consommation agricole. La seconde demande est que désormais, les campagnes de traitement soient précédées d’une information à la population. Celle-ci pourra alors fermer les fenêtres ou rentrer le linge qui sèche dehors. Ces deux mesures sont aussi pertinentes pour les autres cultures. Les deux agences publiques demandent enfin la création d’une base de données sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques car elles regrettent de « n’avoir pas eu accès aux données nécessaires à l’exercice de leur mission ».
PestiRiv donne un instantané le plus précis possible de l’exposition des populations riveraines lors de l’épandage de pesticides. Mais elle ne dit rien de plus ni sur le degré de dangerosité des produits, ni sur leur impact sur la santé. « Les analyses de risques sont fournies par les industriels qui vendent les phytosanitaires que nous examinons au regard des résultats scientifiques les plus récents avant l’autorisation de mise sur le marché, rappelle Benoît Vallet. Il y a beaucoup de travail à faire pour que l’exposition des populations puisse être réellement prise en compte lors de cette procédure ».
Autre limite de l’étude: elle ne permet en rien de produire des valeurs seuils d’exposition à un produit. Là aussi, le travail reste à faire pour bien caractériser et mesurer le risque pour les personnes exposées et plus particulièrement les enfants de développer des maladies. A ce jour, ces études interviennent lorsque apparaissent des surcroîts de cancers, par exemple dans des communes qui soudain sortent des moyennes nationales d’occurrence d’une pathologie. Ces « clusters » fonctionnent à ce jour comme des signaux d’alarme sans que des liens avec l’environnement soient formellement établis.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press