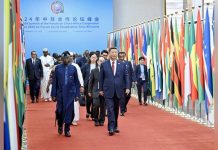Africa-Press – Mali. Gilles Fumey est professeur de géographie culturelle (Sorbonne Université) et chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Sciences et Avenir: Votre livre affiche un titre à contre-courant des discours nutritionnels actuels, qui insistent sur l’importance du petit-déjeuner. Pourquoi ce choix?
Gilles Fumey: Parce que l’organisation des repas n’a rien d’universel. L’heure des prises alimentaires, leur fréquence ou leur composition ont énormément varié au fil du temps.
Prenons l’exemple de la Rome antique: le repas principal – la cena – était pris en fin d’après-midi, vers 16 heures, notamment dans les milieux urbains aisés. Ce dîner copieux pouvait se prolonger tard dans la soirée. Le matin, les Romains mangeaient peu, voire pas du tout. Le prandium, pris autour de midi, se réduisait à une collation frugale: pain souvent sec, vin, olives, un peu de fromage, parfois quelques fruits. Un modèle alimentaire bien éloigné de nos normes actuelles, qui valorisent un petit-déjeuner énergétique et un dîner léger.
Et nos habitudes contemporaines témoignent elles aussi d’une grande souplesse. Le week-end, par exemple, les horaires de repas sont souvent décalés. Lors du confinement, j’ai mené une enquête sur ces pratiques et constaté que nombre de personnes s’étaient spontanément réorganisées autour de deux repas par jour: un premier en milieu de matinée, un second en soirée avec une ou deux séquences de grignotage entre les deux.
Sciences et Avenir: Dans votre essai, vous insistez aussi sur les contraintes matérielles qui influencent les rythmes alimentaires. Pourquoi est-ce important de le rappeler?
Parce qu’il ne faut pas oublier que se nourrir demeure une activité exigeante, mobilisant du temps, de l’énergie et des ressources. Dans la Rome antique, les plus pauvres – la plèbe – ne disposaient pas d’aménagements pour cuisiner à domicile. Il fallait donc acheter ou glaner de la nourriture à l’extérieur: galettes, pois chiches, saucisses, vendus dans la rue ou dans de petites échoppes, voire de la nourriture offerte au nom de l’évergétisme des riches.
Aujourd’hui encore, cette contrainte reste une réalité dans certaines zones rurales d’Afrique ou d’Amazonie, où un seul repas par jour constitue la norme. Le reste du temps, des aliments sont consommés de manière fragmentée – un comportement souvent mal perçu dans nos sociétés, où le grignotage est associé à des produits ultra-transformés. Mais grignoter, dans ces contextes, n’a rien de malsain: c’est une nécessité quand l’alimentation repose sur un repas unique.
Sciences et Avenir: Quand l’organisation des repas en trois temps – matin, midi, soir – est-elle devenue la norme en France?
Avec la contrainte des horaires de travail, l’habitude de prendre un repas matinal s’est progressivement imposée dans les milieux populaires. Chez les ouvriers agricoles comme chez les travailleurs des manufactures qui exerçaient des métiers demandant de la force physique, il était courant de manger quelque chose avant le travail. Une soupe ou du pain trempé dans du vin chaud étaient souvent avalés à l’aube, faute de pouvoir se nourrir de nouveau avant la fin de la matinée. Même si on a des exemples comme les canuts à Lyon au 19e siècle qui cassaient la croûte dans les célèbres mâchons en milieu de matinée.
Dans les milieux plus à l’aise financièrement, en revanche, la norme est restée plus longtemps celle de deux repas par jour. Le premier était pris en fin de matinée, le second en début de soirée, environ dix heures après le lever. Le dîner se tenait avant la tombée de la nuit, car l’absence d’éclairage artificiel empêchait de prolonger les échanges ou les repas dans de bonnes conditions.
« Un modèle à trois repas s’est imposé à la fin du 19e siècle et au début du 20e dans les milieux bourgeois »
Sciences et Avenir: Et dans les classes encore plus aisées?
Un modèle à trois repas s’est imposé à la fin du 19e siècle et au début du 20e dans les milieux bourgeois. Il ne s’agissait pas seulement de manger à heures fixes, mais aussi de faire du repas un moment codifié de sociabilité familiale. Le déjeuner ou le dîner devenait alors un espace d’apprentissage des règles sociales, notamment pour les enfants: se tenir droit, ne pas parler la bouche pleine, servir les autres avant soi, etc.
Le petit-déjeuner bourgeois se distinguait nettement des pratiques populaires. Exit la soupe rustique: place à des boissons coûteuses issues de circuits commerciaux lointains – thé, café, chocolat chaud – accompagnées de tartines. Ces produits, encore rares et onéreux, incarnaient une forme de distinction sociale.
Sciences et Avenir: A l’époque, il n’était évidemment pas question de jus d’orange ni de céréales au petit-déjeuner. Quand et comment ces produits ont-ils fait leur apparition dans les habitudes françaises?
Dans les années 1970, sous l’effet d’une offensive marketing venue des États-Unis. Les grandes marques américaines ont misé sur la puissance de l’image pour vendre leurs produits, en associant les boîtes de céréales à des héros de dessins animés que les enfants retrouvaient à la télévision.
Le jus d’orange – une invention californienne – a profité de l’apparition du Tetra Pak pour se diffuser massivement. La promesse d’un produit « plein de vitamines » a suffi à l’ancrer dans les routines matinales, même si sa consommation reste très contestable d’un point de vue nutritionnel, pour les dégâts qu’il peut commettre dans l’intestin.
Cette américanisation du petit-déjeuner s’est révélée redoutablement efficace, y compris dans l’hôtellerie. Facile à mettre en place, peu coûteuse et rassurante, il suffit d’y ajouter une baguette et quelques croissants pour offrir une formule standardisée, familière et perçue comme complète.
Sciences et Avenir: Mais le petit-déjeuner anglo-saxon n’était-il pas, à l’origine, plutôt salé?
En réalité, le petit-déjeuner anglo-saxon était à l’origine un repas tardif, pris vers dix heures. Il se composait d’aliments rustiques, fermentés ou transformés, ne nécessitant aucune préparation immédiate: lard, fromage, pains toastés… Un héritage direct des pratiques paysannes.
L’époque victorienne (1837–1901) change la donne. Avec l’industrialisation, les journées de travail s’allongent et deviennent plus éprouvantes physiquement. Les ouvriers sont alors incités à avancer l’heure de ce repas salé pris au saut du lit, avant de partir travailler. Le full English breakfast – œufs, bacon, saucisses, haricots à la tomate, toasts, champignons, tomates grillées, thé, parfois black pudding -apparaît d’abord dans les milieux aisés, à la fin de l’époque victorienne, avant de se diffuser plus largement. Aujourd’hui, la plupart des enfants britanniques se contentent de céréales industrielles au petit-déjeuner, comme les petits Français.
« Un autre frein à l’importation du modèle américain est le café italien »
Sciences et Avenir: Tous les pays d’Europe ont-ils vraiment modifié en profondeur la structure de leurs repas?
Pas tous. En Italie notamment, les rythmes alimentaires modernes ont rencontré une forte résistance culturelle. La cena – le repas du soir – demeure le moment central de la journée, au cœur de la sociabilité familiale, souvent préparé par la mamma, avec des plats traditionnels autour des pâtes.
Les discours hygiénistes, selon lesquels il serait néfaste de se coucher en pleine digestion ou qu’il faudrait dîner léger, ne trouvent pas d’écho en Italie. Ce qui prime, c’est le partage du repas et son inscription dans un rythme collectif. Et on comprend qu’un dîner copieux et tardif atténue la sensation de faim au réveil, relativisant aussi la place du petit-déjeuner dans l’équilibre alimentaire quotidien.
Un autre frein à l’importation du modèle américain est le café italien. Non pas le café-filtre dilué à l’anglo-saxonne, mais le ristretto matinal, hérité du café ottoman introduit à Venise via Istanbul. Boisson courte, concentrée, servie chaude dans de petites tasses, il ne relève pas d’une simple consommation domestique. Le ristretto se boit souvent debout, au comptoir d’un café, et conserve le statut d’un rituel social à part entière – historiquement masculin, aujourd’hui largement partagé.
Sciences et Avenir: Finalement, prendre un petit-déjeuner dès le réveil relève-t-il avant tout d’une norme sociale, plus que d’un impératif nutritionnel?
Oui. Historiquement, les sociétés humaines n’ont pas toujours structuré leur journée autour d’un repas matinal. Le petit-déjeuner s’est imposé à partir du 19e siècle comme une source d’énergie socialement justifiée, censée permettre de tenir une matinée de travail ou une journée d’école.
Au fil du 20e siècle, il a été ritualisé et valorisé, présenté comme « le repas le plus important de la journée »», injonction datant de 1917 due à Lena F. Cooper, nutritionniste américaine travaillant pour John Kellogg’s, largement relayée par les discours de santé publique et les campagnes de l’industrie agroalimentaire.
Rien d’anormal, donc, à préférer une collation de qualité en milieu de matinée plutôt qu’un petit-déjeuner avalé mécaniquement dès le lever.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press