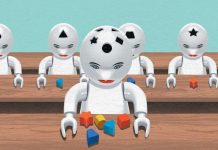Anouar CHENNOUFI
Africa-Press – Mali. Dans les pays africains, plus particulièrement dans le Sahel, on constate des transitions à durée indéterminée et les putschistes ne semblent pas pressés de remettre le pouvoir aux civils, arguant d’une refondation de la nation.
Le Burkina Faso s’est joint…au mois de Mai…à plusieurs pays, dont principalement le Mali et le Tchad, qui ont reporté les élections électorales que les autorités militaires s’étaient engagées à organiser après leur prise du pouvoir, sous prétexte que la principale priorité reposait sur la sécurité, ce qui ouvre la voie à la prolongation des phases de transition.
De nouvelles pages d’incertitude se sont ouvertes dans les pays d’Afrique centrale et occidentale, après la prise du pouvoir par l’armée, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, tout comme au Gabon.
Dans ce contexte, les périodes de transition fixées par les autorités militaires au pouvoir pour rétablir le chemin constitutionnel ont jusqu’à présent échoué dans la plupart des pays, sachant que les conseils militaires de ces pays africains ayant annoncé le report des élections.
Les prétextes et arguments ne reflètent aucunement la vérité

Selon les spécialistes des questions de sécurité en Afrique, « la dégradation des conditions sécuritaires dans la région sahélo-saharienne continuera d’être exploitée aux fins de prolonger les phases de transition annoncées, notamment dans les pays ayant subi des coups d’Etat ».
Ils expliquent, dans ce contexte, que: « Les prétextes invoqués ne reflètent peut-être pas la vérité derrière la décision de reporter les élections et de prolonger la phase de transition, d’autant plus que le terrorisme et la détérioration de la situation sécuritaire dans la région sahélo-saharienne n’ont pas empêché les pays de cette région d’organiser des élections présidentielles et législatives pendant au moins la dernière décennie.
Les mêmes sources soulignent qu’« Au Mali, des élections ont eu lieu en 2013 et 2018, au cours desquelles le président déchu Abou Bakr Keita l’avit emporté, même si le pays souffrait de la pression de groupes terroristes et extrémistes qui contrôlaient de vastes zones en 2012 ».
Par conséquent, la sortie des coups d’État et la transmission du pouvoir à un gouvernement civil restent soumises à des pressions internes et externes qui conduisent à l’érosion de la légitimité des autorités militaires et les forcent à renoncer et à céder le pouvoir aux civils. Mais ce que l’on constate, c’est qu’il existe jusqu’à présent un rassemblement national autour des autorités militaires au pouvoir.
La question qui se pose toujours: Les peuples soutiennent-ils les conseils militaires ?

Dans cette optique, nous évoquons ici l’écrivain et activiste politique tchadien, Ibrahim Zain Congy, qui affirme que « les peuples de ces pays africains ne se soucient pas actuellement des appellations tels que ‘transfert de pouvoir’ et ‘élections’, mais plutôt de ce que le dirigeant leur apporte en termes de justice sociale, de bonne gouvernance, d’opportunités d’emploi et de réduction de la pauvreté ».
Il estime aussi que « les peuples des pays d’Afrique centrale et occidentale, qui ont été témoins de coups d’État contre l’autorité civile, n’ont pas besoin d’élections, car tout le monde sait qu’il y a des falsifications et des fraudes dans les élections ».
En général, la plupart des présidents qui sont issus des urnes dans ces pays n’ont pas été choisis par les citoyens, mais sont plutôt le résultat d’une manipulation des urnes électorales.
D’autant plus que les promesses qu’attendaient les Africains sont la libération de leurs pays de l’hégémonie française et de son exploitation et pillage obscènes des richesses de ces pays. Quant à la carte de sécurité, des élections, des droits de l’homme, de la passation pacifique du pouvoir et de la voie démocratique et constitutionnelle, ce sont des armes françaises utilisées nommément pour faire perdurer le contrôle.
Le politologue tchadien s’attend à ce que « la période de transition se prolonge dans les pays libérés de l’exploitation française », à savoir le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger.
Toutefois, il faut reconnaître qu’avec des autorités souvent mal élues, une situation sécuritaire instable et un développement économique qui stagne, les « putschistes » ont pu s’appuyer certes sur un terreau fertile, celui d’un mécontentement social grandissant. Une majeure partie des populations concernées ont d’ailleurs accueilli ces coups d’État par des scènes de liesse et d’euphorie populaires. Mais l’heure est déjà au bilan.
Ces putschs militaires ont-ils répondu aux attentes, souvent légitimes, des populations ?
Force est de constater que ce n’est pas le cas, car les indicateurs de pauvreté s’aggravent, et de facto, l’instabilité politique est rarement synonyme de prospérité économique. Historiquement, après un putsch, une récession ou un ralentissement économique à court et moyen termes est généralement observé, et à titre d’exemple, après chacun des coups de force qui ont frappé le Niger, le PIB du pays a chuté.
Pour rappel, voici une brève rétrospective des événements
• Au Mali, le 18 août 2020, le colonel Assimi Goïta a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, au pouvoir depuis 2013. En mai 2021, le colonel Assimi Goïta a démis et remplacé le président de la transition, Bah N’Daw.
• Au Tchad, le 21 avril 2021, le général Mahamat Déby a succédé avec l’appui d’un Conseil militaire de transition (CMT) à son père tué en pleine opération militaire.
• En Guinée, le 5 septembre 2021, le colonel Doumbouya a renversé le président Alpha Condé réélu depuis 2010.
• Au Soudan, le 25 octobre 2021, le général Abdel Fatah al-Burhane a perpétré un putsch au sein de la transition ouverte par la chute du régime d’el-Béchir en 2019 en mettant fin au gouvernement civilo-militaire et en arrêtant le premier ministre Hamdok, en poste depuis 2019.
• Au Burkina Faso, le 24 janvier 2022, le colonel Damiba a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré élu depuis 2015. En octobre 2022, puis le capitaine Ibrahim Traoré a démis et remplacé à son tour le lieutenant-colonel Damiba.
Bien que la région de l’Afrique de l’Ouest ait été témoin d’un certain nombre de coups d’État, réussis ou non, depuis 2020, les coups d’État au Niger et au Gabon sont venus fait sentir leurs positions à un large bloc de dirigeants en raison de leurs effets significatifs, qui ont dépassé la région locale pour atteindre l’échelle régionale. Cela a peut-être ébranlé le continent tout entier, en plus des influences géopolitiques liées aux positions internationales.
Bien qu’également tous ces pays aient une longue histoire de pouvoirs militaires, il faut distinguer, dans cette succession de coups de force, que ces juntes ne sont pas toutes uniformes. En revanche, elles ont toutes la même stratégie pour résister à un retour rapide à l’ordre constitutionnel, qui est une demande à la fois interne (partis politiques, organisations de la société civile) et externe (CEDEAO, Union africaine, UE, ONU, etc.). Les juntes font ainsi des concessions illusoires pour gagner du temps en retardant l’application du schéma habituel de retour à l’ordre constitutionnel.
La Constitution reste la 1ère victime des coups d’État

Les craintes sont fortes que les « périodes exceptionnelles » ne deviennent une situation permanente dans ces pays, d’autant plus que certains pensent qu’un coup d’État militaire est un moyen presque naturel par lequel le pouvoir est transféré dans ces pays, surtout avec une « perturbation » implicite de la constitution existante.
Il semble bien que « les putschistes ne croient qu’à la pensée militaire et à l’idéologie sécuritaire dans la planification, car dans de nombreux putschs réussis, des périodes de transition s’étendant sur des années sont établies sans référence constitutionnelle ou exercice institutionnel qui respecte l’ABC de la gestion politique de l’État.
Par conséquent, cette approche de sécurité militaire cherche à tout contrôler par la force, l’autorité et les armes, en tant que mécanismes qu’elle maîtrise parfaitement, alors que dans la pensée politique, la culture constitutionnelle et l’organisation civile contemporaine, ce sont des mécanismes militaires qui ne peuvent pas être une source de légitimité de gouvernance et d’assujettissement, quelles que soient les justifications.
Ce qui est constant est la représentation électorale, même à travers des conseils ou des organes temporaires de consultation politique, ce qui signifie que les nombreuses justifications pour rechercher le pouvoir dans la gestion des affaires publiques, même aux dépens du contexte, sont des tentatives pour contourner le structure naturelle de la gestion politique de l’État.
La période de transition sujette à des prolongations répétitives
Concernant les inquiétudes qui se rapportent à la monopolisation du pouvoir par les conseils militaires qui le détiennent, certains chercheurs en affaires africaines estiment qu’« il ne fait aucun doute que les groupes putschistes dans les pays où une vague de coups d’État s’est produite de 2020 à aujourd’hui ne céderont pas le pouvoir et qu’il y aura une période de transition à long terme ».
Par conséquent, ces dirigeants militaires s’efforceront d’organiser la scène politique pour revenir au pouvoir par le biais d’élections, ou tenteront de prolonger la période de transition en tirant leur légitimité des conditions de sécurité turbulentes, comme cela se produit dans la région du Sahel africain, notamment au Niger, au Burkina Faso et au Tchad, ce qui menace de mettre à mal l’expérience de transfert pacifique du pouvoir et la démocratie en général.
Il importe de noter que les défis auxquels sont confrontés les pays africains qui ont été témoins de coups d’État militaires doivent être sérieusement abordés, sinon ces élections ne pourront pas être organisées de façon efficace et d’une manière qui permette une participation significative du bloc électoral.
Le processus le plus fréquent et le plus sûr à être mis en application

• Un dialogue national:
L’organisation d’un dialogue national inclusif permet généralement de créer un consensus sur les principes de la future Constitution et de l’organisation des élections.
• Une nouvelle Constitution:
L’élaboration d’une nouvelle constitution est généralement validée par un référendum.
• Des élections présidentielles et législatives:
La mise en place d’un gouvernement et d’un Parlement élus au suffrage universel clôture la transition.
A ce propos, à l’heure actuelle, seules les autorités maliennes, tchadiennes et guinéennes ont franchi cette première étape. Encore ont-elles mis un an pour organiser un dialogue national qui a été en partie boycotté et qui a abouti, au Tchad, à une répression violente.
Ceci dit, on estime que toutes ces transitions militaires devraient donc s’achever par des élections en 2024. Si cette date est respectée, seul le Burkina Faso aura connu une transition de deux ans, et les autres putschistes seront restés au pouvoir trois ou quatre ans avant l’échéance électorale. Ils auront donc réussi à imposer des transitions longues, décrocher quelques années de pouvoir et, pour certains d’entre eux (Tchad, Mali, Soudan), refuser le principe de l’inéligibilité des dirigeants des juntes aux prochaines échéances électorales. Dans ces trois pays, l’installation des putschistes aux commandes du pays pendant plusieurs années et la possibilité de se présenter aux élections ne laissent guère de doutes sur leur intention de conserver le pouvoir après la transition.
Toutefois, les blocs africains se précipitent pour ramener la situation à la normale dans les pays africains qui ont été témoins de coups d’État militaires, et tentent d’obtenir de véritables promesses des conseils de transition au pouvoir, sans parvenir à atteindre leurs objectifs malgré le langage des « menaces », à l’instar des démarches de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) envers le Niger par exemple.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press