Anouar CHENNOUFI
Africa-Press – Mali. Les efforts d’explication du phénomène du terrorisme en Afrique et les efforts pour apporter de vraies solutions à la crise qui frappe le continent et menacent d’élargir l’éparpillement géographique des groupes terroristes, de leurs alliances et de leurs diverses sources de financement, nécessitent encore un enracinement non traditionnel les approches de ce phénomène et la compréhension de ses contextes sociétaux pour déterminer les véritables responsabilités nationales de l’État face à la crise, et pas seulement coordonner les rôles des acteurs externes face au phénomène, et ce que cela signifie, c’est renforcer la durabilité des menaces terroristes, et offrir des opportunités de propagation des activités des groupes armés, en l’absence de développement économique et de véritables réformes politiques, sous prétexte d’efforts de lutte contre le terrorisme, et la nécessité d’un soutien extérieur pour les régimes dans les foyers d’activités terroristes en Afrique subsaharienne.
Aujourd’hui, toujours dans le même thème que nous traitons, en l’occurrence « les groupes armés », nous avons voulu en profiter pour revenir sur le livre publié par Dr Benedikt Erforth, intitulé « Contemporary French Security Policy in Africa » (Politique de sécurité française contemporaine en Afrique).
Dans ce livre, l’auteur a pris le Mali comme exemple classique de l’inefficacité de la seule approche sécuritaire pour appréhender le phénomène du terrorisme.
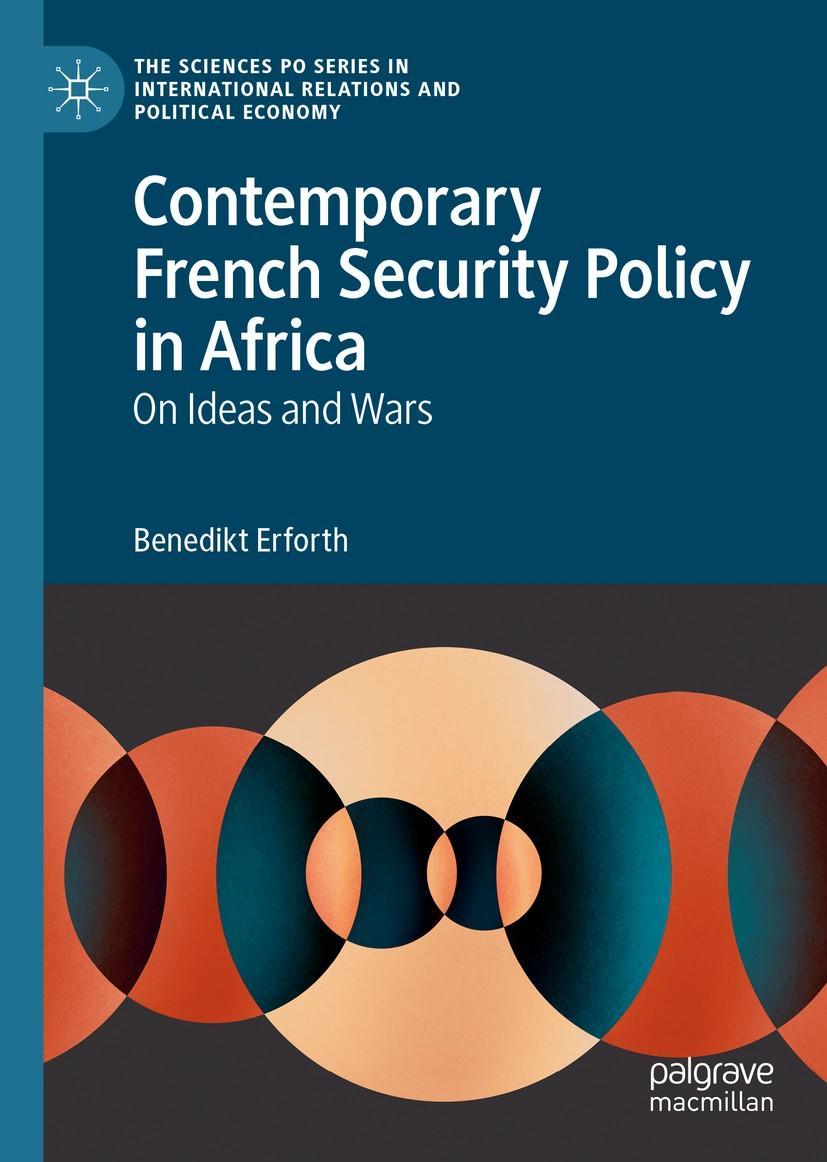
Benedikt Erforth a présenté cette année là un ouvrage important sur la politique de sécurité française contemporaine en Afrique, dans lequel il a attiré l’attention sur le « nouvel interventionnisme » de la France en Afrique, représenté par le retour de la France, depuis 2013, à une politique d’intervention militaire directe dans les affaires du continent, après les frappes militaires conjointes avec la Grande-Bretagne pour renverser le régime de Mouammar Kadhafi en Libye en 2011, et la contribution militaire de Paris à l’arrestation de l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, en avril 2011.
C’est ainsi que Paris, au début de l’intervention française dans la crise au Mali en 2013, n’a pas exprimé ses efforts pour intervenir pour résoudre une crise humanitaire ou protéger ses citoyens sur place, mais a plutôt déclaré, d’emblée, que son intervention était de combattre le phénomène du « Jihad mondial », et qu’il s’agissait d’une guerre internationale contre ce qu’on qualifiait de « terrorisme islamique ».
Dans ce contexte, les médias français se sont concentrés sur les craintes de terroristes occupant le Mali et sur le fait que la France devrait éliminer toute zone de contrôle ou d’influence islamique au Mali. Des termes tels que « djihadiste, islamiste et terroriste » ont été utilisés de manière interchangeable, synonymes d’un même sens, et les objectifs de la guerre ont changé, passant de la protection de la souveraineté du Mali et de l’expulsion des islamistes et des djihadistes armés à « l’élimination du terrorisme », ce qui explique l’agitation continue, à cette époque, de l’administration politique et économique du président Ibrahim Keita, sous prétexte d’affronter le terrorisme, jusqu’au coup d’État qui l’a écarté du pouvoir en août 2020, sur fond de crises sociales et économiques, qui ont failli ramener le pays à l’atmosphère de l’année 2012-2013, qui indiquait l’échec catastrophique des efforts de lutte contre le terrorisme soutenus par la France en raison de sa focalisation sur la promotion du dilemme sécuritaire, et de l’incapacité à s’attaquer aux causes profondes de la crise de l’État national, et de l’exclusion de ses options démocratiques sous prétexte de menaces terroristes.
La France a pris l’initiative de déployer ses forces au Mali et en Centrafrique, revenant ainsi et en force dans sa dernière arrière-cour.
En effet, la période 2014-2019 a vu le retour des forces françaises d’Afghanistan, la baisse de la dotation annuelle de défense à 1,5 % du PIB français, et la suppression de 34.000 emplois de défense sur la période 2014-2020. Ce retour est intervenu malgré la conviction de l’administration socialiste dans le slogan des solutions africaines aux problèmes africains. La contradiction entre la rhétorique française et la pratique réelle est restée évidente dans les opérations militaires françaises au Sahel et en République centrafricaine (sous la bannière d’éviter une répétition du modèle rwandais).
Dans une lecture perspicace, Dr Erforth note que la politique de sécurité actuelle de la France envers l’Afrique oscille encore entre les solutions traditionnelles de gestion de la crise et une approche multilatérale actualisée qui renforce le rôle de l’Afrique, et malgré la réduction continue des budgets militaires français au cours des deux dernières décennies, la capacité de la France à intervenir en dehors de son territoire est restée l’un des outils les plus importants de la politique étrangère française.
Au total, l’importance que les hommes politiques français attachent aux capacités militaires de leur pays, et leur interprétation de l’effort de guerre comme un outil diplomatique essentiel, reflètent une compréhension clausewitzienne (attribué au théoricien militaire russe Karl Philip von Clausewitz 1780-1831) qui considérait la guerre comme ayant d’importants aspects moraux et politiques) du domaine militaire.
La France a officiellement compris, dès le début, que l’élimination des conditions propices à la propagation du terrorisme passait par des programmes de développement et une bonne gouvernance, et pas seulement par des politiques de sécurité. Cependant, l’expérience pratique, après un examen approfondi du rôle français dans la lutte contre le terrorisme en Afrique au cours de la dernière décennie, a démontré qu’il existe une compréhension tacite que « l’extrémisme islamiste » doit être transcendé, avant que toute situation politique ne soit conçue (au Mali en particulier) , et ce concept contredit le discours officiel précédent. Pour le ministère français des Affaires étrangères, qui considérait le terrorisme comme un résultat et non comme une cause du problème, et plaçait la situation politique dans le sud, au centre de la résolution du problème.
Cette approche révèle la généralisation de la priorité sécuritaire et face à la menace islamique dans les perceptions des acteurs extérieurs (notamment la France) et de ses partenaires à l’intérieur de l’Afrique. Cette approche ignore délibérément les facteurs internes qui constituent un soutien durable au terrorisme et à sa et les réseaux de soutien régionaux.
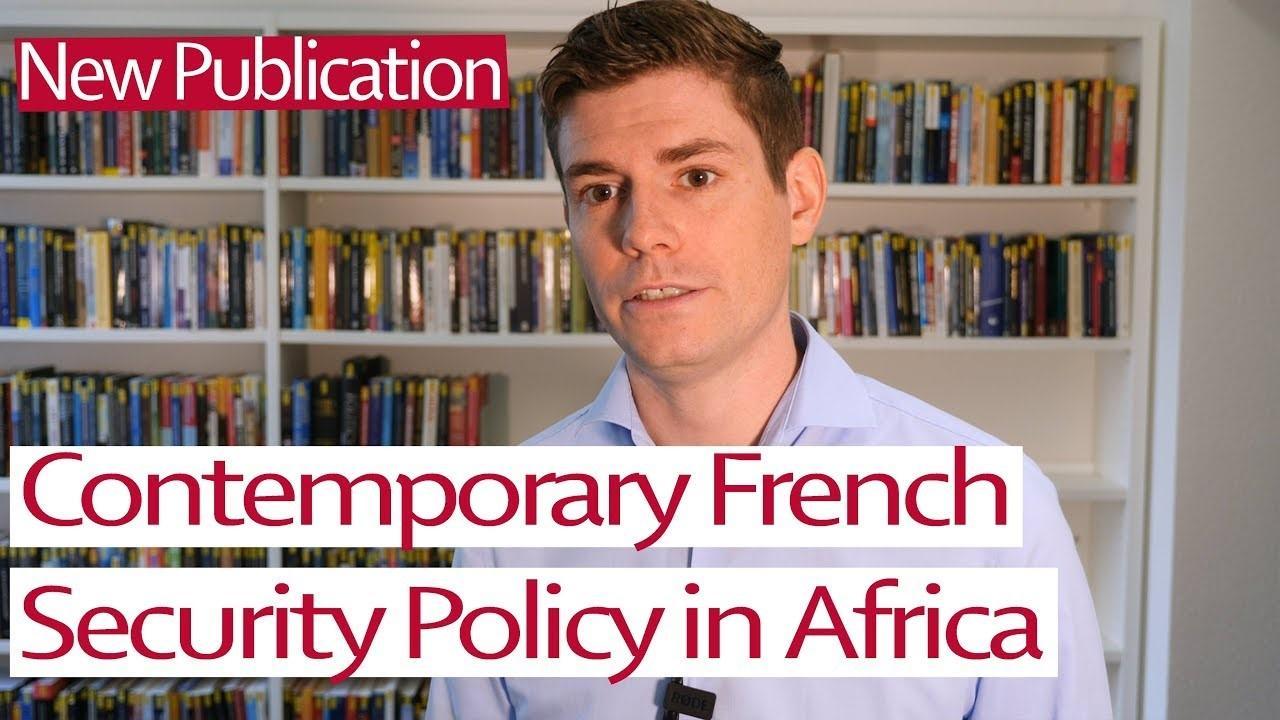
Une solution africaine à un problème africain ?
Le titre du livre, représente en soi une grave situation difficile, car il a été utilisé à plusieurs reprises pour justifier la répression et la poursuite des crises, et non pour les résoudre, comme dans l’exemple de l’Éthiopie sur le plan interne et régional, où son Premier ministre, Abi Ahmed, a pris l’initiative de porter une banderole dans la crise du barrage de la Renaissance et a rejeté « l’intervention américaine », tout en refusant, en violation des textes de l’Organisation de l’Unité Africaine et de l’Union Africaine, toute intervention de cette dernière pour régler pacifiquement la crise de la région du Tigré, malgré ses menaces et ses répercussions régionales. En outre, les mécanismes régionaux auxquels on a parfois recours pour faire face au phénomène du terrorisme restent clairement dépendants des intérêts des parties régionales elles-mêmes, comme dans les deux exemples, le Kenya et l’Éthiopie, et leurs interventions flagrantes, avec plus ou moins d’acquiescement et parfois la coordination du régime de Mogadiscio, dans les affaires somaliennes et ses dossiers internes, dont les plus importants sont les élections législatives et présidentielles prévues dans quelques semaines, les relations extérieures de la Somalie et ses performances économiques sous un couvert traditionnel : la coopération dans la lutte contre le terrorisme.
Toujours selon l’auteur, la solution africaine aux menaces terroristes et à ses dangers exige plus qu’une simple volonté politique ou une coordination des rôles des acteurs extérieurs sur le continent. Au contraire, le continent et ses États doivent considérer les conditions ou les structures qui peuvent soutenir la croissance économique et politique. , ce qui signifie qu’ils doivent parvenir à la stabilité et à la sécurité, et aller de l’avant avec les questions d’intégration économique, de stabilité financière et d’unité des positions politiques, Selon un résumé très optimiste, fourni par Abdul Karim Bangura et Billie D. Tate dans l’étude des réponses de l’Afrique au terrorisme international et à la guerre contre celui-ci (2010), avec un constat statistique, qui est la propagation du terrorisme dans les pays majoritairement musulmans, ce qui renforce les hypothèses d’efficacité des solutions de développement éliminer la croissance et l’expansion du phénomène du terrorisme.
Idée sur l’auteur
Le Dr Benedikt Erforth est chercheur principal à l’Institut allemand de développement. Avant son poste actuel, il a travaillé comme maître de conférences à Sciences Po Paris.
Benedikt est titulaire d’un doctorat en études internationales de l’Université de Trente en Italie et d’une maîtrise en politique internationale et européenne de l’Université d’Édimbourg (U.K). Il est l’auteur de l’ouvrage « Politique de sécurité française contemporaine en Afrique » et de plusieurs articles académiques et articles d’opinion.
Les domaines de travail actuels de Benedikt comprennent la politique de développement, le financement du développement, la numérisation et le développement, les relations UE-Afrique et la politique de sécurité française au Sahel.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press






