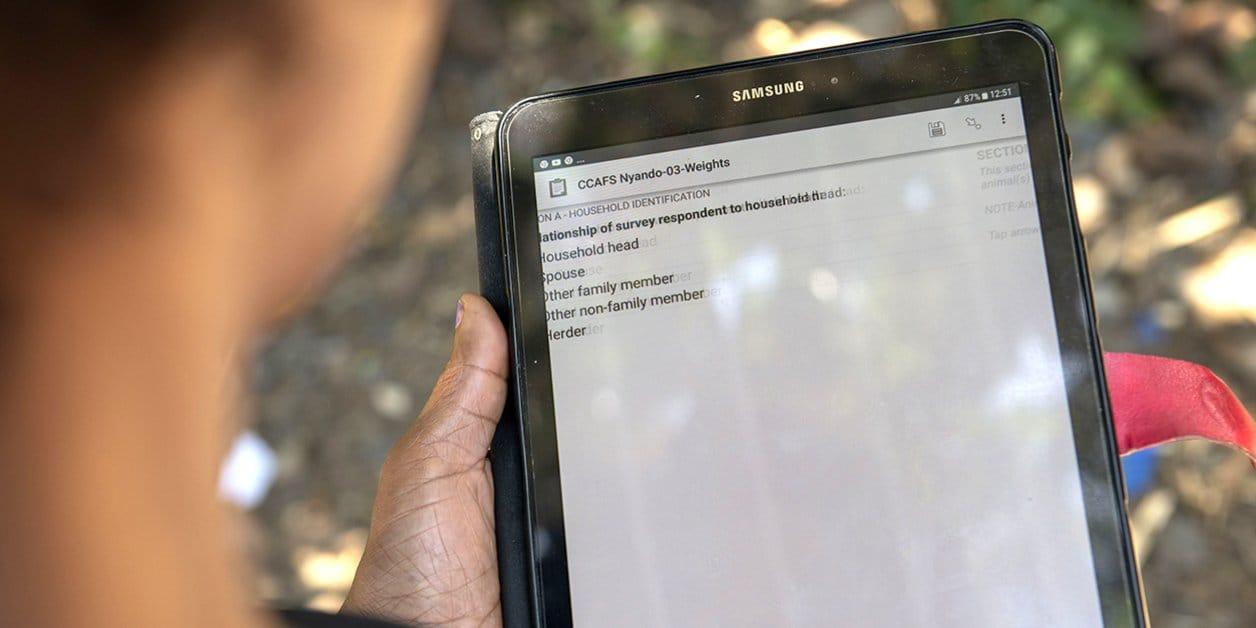Africa-Press – Niger. Si les défis liés à leur développement sont de taille, les solutions de pointe de l’agri-tech semblent offrir une solution aux enjeux de l’agriculture africaine tels que l’adaptation au changement climatique. Dans son dernier rapport, Ventures Africa a indiqué que les start-up africaines du secteur avaient bénéficié de quelque 95 millions de dollars de financement en 2021 (+58,5 % sur un an). Ce montant constitue 4,4 % du financement global que les jeunes pousses technologiques du continent ont reçu l’année dernière.
Un rapport de McKinsey souligne néanmoins qu’une large part des petits agriculteurs a toujours un besoin urgent de ces technologies. Ces mêmes petits exploitants agricoles composent plus de 60 % de la population de l’Afrique subsaharienne. À l’occasion du Forum 2022 sur la révolution verte en Afrique (AGRF), qui s’est tenu à Kigali du 5 au 9 septembre, Jeune Afrique/The Africa Report s’est entretenu avec plusieurs entreprises et institutions qui se font les championnes de l’agri-tech sur le continent. Tour d’horizon.
Les solutions existantes au défi de l’accessibilité
Responsable, au sein d’UPL OpenAg, des partenariats de durabilité en Afrique et au Moyen-Orient, Florent Clairet est aussi en charge de la solution Zeba, qui vise à réduire la consommation d’eau d’irrigation. Fabriquée à partir d’amidon de maïs, Zeba absorbe de l’eau et des nutriments jusqu’à 500 fois son propre poids, puis les libère par intermittence durant la période de culture. Le rétenteur a été déployé avec succès dans le cadre d’un essai de culture de pommes de terre mené par UPL et l’université du Cap à Pretoria, indique Clair. Plus tôt en 2020, la société et ses partenaires ont également présenté Fawligen, une application qui détecte, par le biais de photos, la chenille légionnaire d’automne. De son côté, Hello Tractor, une entreprise établie au Nigeria, met en relation les propriétaires de tracteurs avec les petits exploitants agricoles qui ont besoin de services de ces véhicules. Wefarm et M-Farm aident également la communauté des petits exploitants agricoles à obtenir des ressources variées.
Mais les conditions difficiles dans lesquelles les agriculteurs exercent leur métier en Afrique font du déploiement des technologies une tâche ardue. Des millions de petits et moyens agriculteurs du continent n’ont pas de smartphone ni même d’accès à Internet, et n’ont pas les moyens de se procurer ces technologies. « Le défi est de savoir comment les rendre accessibles, abordables et disponibles pour les agriculteurs », explique Florent Clair.
Lilian Ndungu, conseillère en technologie agricole à l’institut Tony Blair, précise quant à elle que pour porter ses fruits, la technologie doit être développée avec les acteurs concernés. « Notre recherche doit être adaptée aux demandes sur le terrain. » L’institut conseille en effet une vingtaine de pays sur la conception de politiques et de plans d’action susceptibles de créer un environnement propice au déploiement de l’agri-tech. D’après elle, les smartphones et Internet sont des conditions préalables nécessaires. Au Rwanda, l’institut Tony Blair a conseillé le gouvernement sur les partenariats qui peuvent aider à fournir des smartphones aux agriculteurs. « Nous avons collaboré avec le gouvernement rwandais pour revoir la politique en matière de haut débit, car nous sommes conscients que si la technologie doit avoir un impact sur les agriculteurs, ceux-ci doivent y avoir accès », précise-t-elle.
Technologies locales
En outre, le développement d’applications adaptées aux agriculteurs illettrés ou sans formation technologique particulière apparaît essentiel pour la diffusion de l’agri-tech, explique Nixon Gecheo, directeur de programme pour les systèmes et solutions numériques agricoles à l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (Agra). Pour y parvenir, cette dernière recrute des « conseillers villageois » et des « conseillers communautaires » sur tout le continent. « À l’Agra, les conseillers villageois ont été formés à la technologie et ce sont eux qui, à leur tour, vont à la rencontre des agriculteurs », ajoute-t-il.
« Puisque nous savons que les agriculteurs sont analphabètes en matière d’adoption de la technologie, l’idée est qu’ils deviennent l’interface, développe Nixon Gecheo. Nous pouvons traduire le contenu dans une ou plusieurs langues locales que l’agriculteur local peut comprendre. » L’Agra a recruté environ 32 600 conseillers-villageois, et chacun d’entre eux est capable d’atteindre 250 à 300 agriculteurs (soit un total d’environ 9 millions de personnes), selon le responsable.
Yemi Akinbamijo, directeur exécutif du Forum pour la recherche agricole en Afrique (Fara), basé à Accra, estime que le continent ne devrait pas importer de technologies mais plutôt investir dans des innovations locales, adaptées aux conditions réelles. « Notre recherche doit répondre aux demandes sur le terrain », affirme-t-il, ajoutant toutefois que la capacité de l’Afrique à produire des technologies locales reste faible. Pour le directeur de la Fara, les gouvernements doivent faire avancer les choses en allouant des fonds dans leurs budgets, ce qui n’est actuellement pas le cas.
En raison de ce manque de soutien, les chercheurs et les innovateurs n’ont d’autre choix que de rechercher des financements étrangers, explique Yemi Akinbamijo, et ce sont donc les étrangers qui mènent le programme de recherche et de technologie de l’Afrique. Cela peut fonctionner ou non. « Si cela correspond à nos exigences, nous applaudissons, sinon, nous ne faisons pas ce qu’ils veulent et nous passons à autre chose. »
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Niger, suivez Africa-Press