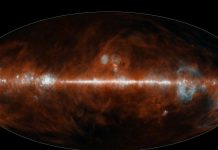Africa-Press – Tchad. suit deux Tchadiennes, Amina (Achouackh Abakar) et sa fille, Maria (Rihane Khalil Alio), qui veut pratiquer une interruption volontaire de grossesse dans un pays où la loi l’interdit et les autorités religieuses le réprouvent. Sélectionnée en compétition officielle au Festival de Cannes 2021, cette œuvre de fiction sort dans les salles françaises le 8 décembre. Avec ce neuvième long-métrage, le cinéaste franco-tchadien Mahamat-Saleh Haroun aborde un sujet tabou dans plusieurs pays d’Afrique et traduit en images « un féminisme souterrain ».
« Lingui, les liens sacrés » tire-t-il son matériau de faits réels ?
Il y a eu ces dernières années, au Tchad, des faits divers récurrents relatifs à des nouveau-nés retrouvés étouffés dans des décharges ou des latrines. Une histoire semblable qui était arrivée à Abéché, ma ville natale, m’avait beaucoup choqué quand j’étais enfant. Des décennies plus tard, quand j’ai découvert ces faits divers, je me suis dit que le désastre continuait. J’ai donc commencé une enquête et je suis allé poser des questions à des femmes, mais aussi à mon frère, qui est médecin. C’est un phénomène qui continue d’exploser à la face de la société tchadienne, je me suis donc dit qu’il fallait en parler.
Qu’est-ce que cela implique d’aborder l’avortement, sujet tabou dans la société tchadienne, en matière d’écriture et de mise en scène ?
Cela implique de redoubler de vigilance sur le plan moral : qu’est-ce qu’il faut montrer ou ne pas montrer ? Qu’est-ce qu’il faut dire ou ne pas dire ? Comment raconter l’histoire du point de vue de la fille ou du point de vue de la mère, femmes isolées toutes les deux ? Il fallait éviter d’en faire une histoire à suspense, j’ai donc préféré travailler par ellipses et donner plus de chair à cette réalité.
Comment avez-vous construit la relation entre Amina, qui est une fille-mère, et sa fille, Maria, qui refuse d’être mère à la suite d’un rapport non désiré ?
J’ai voulu que la fille soit dans une forme de rejet du destin de sa mère. D’une certaine manière, Maria veut avorter pour ne pas devenir comme Amina. Cette dernière essaie de donner à sa fille tous les moyens de devenir quelqu’un d’autre, de sortir du déterminisme. Amina fabrique des fourneaux [réchauds faits de fils de fer récupérés dans des vieux pneus], un travail très physique essentiellement effectué par des hommes au Tchad. J’ai imaginé un personnage qui tente d’occuper une double fonction : celui du père et celui de la mère. Elle réagit d’abord en tant que chef de famille. Soutenir sa fille dans un processus d’interruption volontaire de grossesse lui pose un problème face au poids du patriarcat, de la religion, du regard des autres… J’ai voulu suivre le cheminement de la mère qui prend conscience qu’il lui faut sauver sa fille, au-delà de toute question morale.
Il vous reste 36.95% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Tchad, suivez Africa-Press