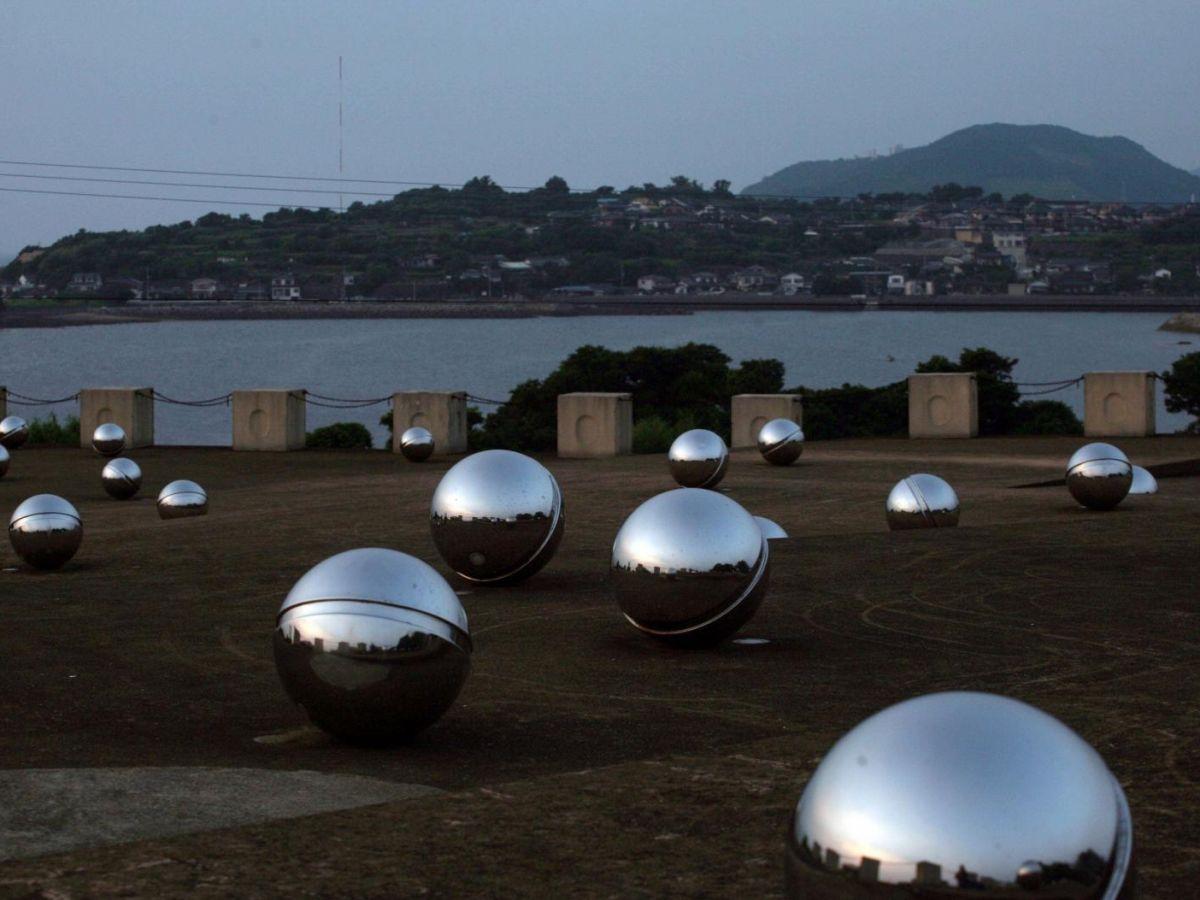Africa-Press – Tchad. Les 2265 victimes recensées du drame de la baie de Minamata ne seront pas mortes en vain. C’est en effet à la suite de cette catastrophe sanitaire provoquée par les rejets en mer d’une usine pétrochimique de cette région du Japon entre 1956 et 1968 qu’a été décidée la création d’une convention internationale mettant en œuvre la réduction de l’utilisation du mercure dans la plupart des usages industriels et de consommation. Le mercure, sous sa forme de méthyl-mercure, provoque chez l’humain des atteintes neurologiques profondes provoquant des paralysies motrices et des retards mentaux.
Adoptée au Japon le 10 octobre 2013, la convention bannit la fabrication et la vente du mercure dans les thermomètres, batteries, systèmes électriques, crèmes et lotions cosmétiques (il est interdit en France dans les produits de consommation depuis 1999). Le secteur minier doit par ailleurs réduire ses émissions ainsi que les centrales au charbon, les incinérateurs de déchets, les cimenteries, etc. Ces efforts semblent d’ores et déjà payer, affirme une équipe de l’Université de Tianjin (Chine). En 20 ans, les émissions anthropiques auraient baissé de 70%, selon l’étude publiée par l’American Chemical Society (ACS).
Une petite plante de l’Everest témoin de la pollution
La principale difficulté rencontrée pour évaluer les progrès des politiques publiques mises en œuvre est de bien distinguer les sources naturelles de celles provenant de l’activité humaine. Les sols sont en effet des émetteurs de mercure arraché par l’érosion éolienne. Pour dépasser cet obstacle, l’équipe chinoise a décidé d’utiliser un indicateur de cette pollution atmosphérique: une petite plante herbacée vivace vivant entre 3500 et 5000 mètres sur les contreforts de l’Everest. Androsace tapete a la particularité de former des sortes de petits coussins qui croissent de quelques millimètres tous les ans, fixant ainsi les composés gazeux de son environnement.

C’est en récupérant les feuilles de plantes anciennes que les chercheurs ont pu remonter jusqu’en 1982. « Notre travail de reconstruction indique que les concentrations atmosphériques de mercure ont augmenté du début des années 1980 à 2002 de 3,31 nanogrammes par m3 (ng/m3), suivi par un important déclin jusqu’en 2020 pour descendre jusqu’à 0,90 ng/m3, écrivent les auteurs. Cette tendance à la baisse est cohérente avec celles observées dans des sites de suivi de l’hémisphère nord, particulièrement dans les zones rurales chinoises ».
S’occuper de l’héritage laissé par des décennies d’usage du mercure
Pour séparer sources humaines et naturelles, les chercheurs ont ensuite utilisé un isotope du mercure qui donne l’origine du métal. Ils peuvent ainsi affirmer que les sources humaines ont bien diminué leurs rejets. En revanche, les sources naturelles ont, elles, augmenté et leur responsabilité dans la pollution atmosphérique est passée de 44 à 62%. Les chercheurs chinois plaident évidemment pour que les efforts de la communauté internationale s’intensifient et estiment qu’il faut désormais s’occuper de l’héritage laissé par des décennies d’usage du mercure sans qu’aucune précaution ne soit prise. Cette pollution ancienne déposée sur les sols est en effet remise régulièrement en suspension dans l’air.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Tchad, suivez Africa-Press