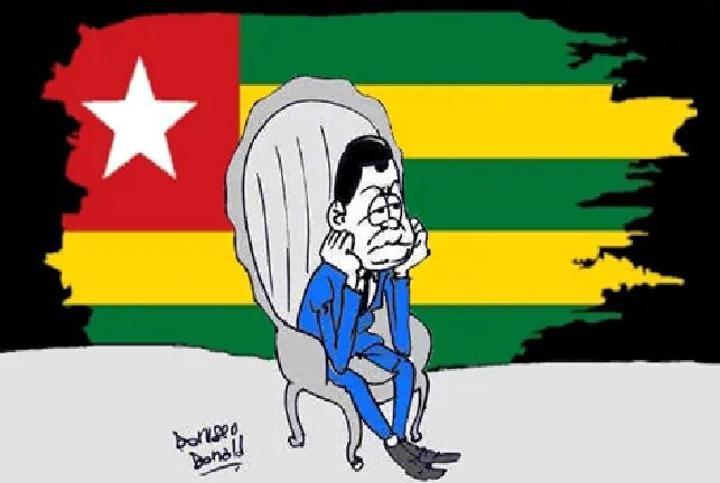Africa-Press – Togo. Depuis l’arrestation d’Affectio, et surtout celle d’Aamron, les voix s’élèvent de plus en plus pour dénoncer la faillite du régime en place et appeler à son départ. Des artistes, des influenceurs, des blogueurs ont lancé des appels à manifester les 6, 26, 27 et 28 juin derniers. Ces mobilisations ont été brutalement réprimées par les forces de sécurité, appuyées par des milices agissant en toute impunité. Le bilan est tragique: au moins sept morts, des dizaines de blessés graves et de condamnés par la justice.
Et pourtant, dans ce climat délétère, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils municipaux a été lancée le 1er juillet.
Il est essentiel de rappeler que, malgré nos divergences de stratégie, l’immense majorité des Togolais partage un objectif commun: mettre fin à ce régime. Mais à chaque élection, la même question divise: faut-il y participer ou les boycotter? Ce dilemme hante notre vie politique depuis plusieurs décennies.
Les partisans du boycott estiment que les élections sont une mascarade: cadre institutionnel taillé sur mesure, instrumentalisation de la justice et des forces de sécurité, fraudes massives, violences impunies… Pour eux, seule une mobilisation citoyenne de grande ampleur pourrait permettre de renverser l’ordre établi. Mais force est de constater que, malgré des appels répétés à la mobilisation, cette stratégie n’a pas encore permis d’atteindre l’alternance.
De leur côté, les partisans de la participation voient dans les campagnes électorales une opportunité de sensibilisation et de mobilisation populaire. Ils croient qu’il faut saisir chaque occasion pour dénoncer la mauvaise gouvernance, exposer les échecs du régime et défendre les urnes. Mais là aussi, les résultats se font attendre. Trop souvent, la stratégie électorale se limite à voter, sans réelle préparation à affronter la fraude ou défendre les résultats.
Alors, que faire?
J’ai longuement réfléchi, écouté nos compatriotes de divers horizons — jeunes, aînés, femmes et hommes de toutes régions, croyances et conditions sociales, au Togo comme dans la diaspora. J’ai aussi consulté des amis étrangers.
Oui, les manifestations de juin ont bénéficié d’un large soutien moral et un succès certain: des rues désertes, des marchés vides, des activités ralenties… Mais sur le terrain, seules quelques zones du Sud-Est de Lomé et quelques rares quartiers de l’intérieur ont réellement été actives. Si nous devons saluer le courage des jeunes qui ont bravé les forces de l’ordre les mains nues, nous devons aussi nous interroger sur le silence et l’immobilisme de la majorité.
Voulons-nous vraiment le changement? Si oui, pourquoi cette passivité? Sommes-nous convaincus que rester inactifs ou déléguer la lutte à quelques militants, artistes ou leaders politiques suffira?
Les partisans des élections, eux aussi, doivent faire leur examen de conscience. Il ne suffit pas de voter et de rentrer chez soi. La fraude se combat sur le terrain, pas dans les communiqués après coup. Or trop nombreux sont ceux qui, après le vote, se retirent en spectateurs.
Dans les deux camps, la même question s’impose: sommes-nous prêts à assumer notre part de responsabilité collective pour faire advenir le changement?
Il est donc inutile d’opposer participationnistes et non-participationnistes. Participer aux élections sans défendre les urnes n’a pas de sens. Appeler au boycott sans oser manifester activement est tout aussi vain. Les uns et les autres, nous devons dépasser les postures.
C’est pourquoi prétendre que l’on est en colère contre les participationnistes, ou les non-participationnistes n’est pas justifié. La réalité est simple: tant que nous ne sommes pas prêts à défendre nos droits, dans la rue comme dans les urnes, nous ne serons pas prêts pour l’alternance.
Je l’avais déjà dit il y a plusieurs années, et je le redis avec gravité: tant que les Togolais ne seront pas prêts à défendre les urnes, ils ne seront pas prêts pour une révolution.
Nous devons tous, chacun à son niveau, revoir nos copies.
Je tiens à rappeler qu’à partir des années 1980, plusieurs dictateurs ont été contraints de quitter le pouvoir à la suite d’« élections » contestées, combinées à des mobilisations populaires massives.
• Aux Philippines, sous la pression de la communauté internationale, Ferdinand Marcos, au pouvoir depuis 1965, organise une élection présidentielle anticipée le 7 février 1986. Bien que son gouvernement le déclare vainqueur, l’opposition dénonce des fraudes massives. Le 22 février, un soulèvement populaire débute, soutenu par deux hauts responsables militaires, Fidel Ramos et Juan Ponce Enrile. Ce mouvement culmine le 25 février avec l’investiture de Corazon Aquino et la fuite de Marcos et de sa famille en exil.
• En Serbie, une élection présidentielle se tient le 24 septembre 2000. Les institutions officielles s’apprêtent à rappeler les électeurs pour un second tour entre Slobodan Milosevic, le président sortant, et Vojislav Koštunica, mais les résultats sont contestés par l’opposition qui revendique la victoire de Vojislav Koštunica. Un soulèvement populaire massif éclate. Sous la pression, Milosevic est contraint de reconnaître sa défaite le 6 octobre 2000 et de quitter officiellement la présidence.
• À Madagascar, l’élection présidentielle du 16 décembre 2001 donne lieu à une crise: les résultats officiels n’accordent pas la victoire à Marc Ravalomanana dès le premier tour et annoncent un second tour face au président sortant, Didier Ratsiraka. Ravalomanana rejette ces résultats. Des manifestations de grande ampleur, des grèves générales et des affrontements armés s’ensuivent. Le 29 avril 2002, la Haute Cour constitutionnelle finit par reconnaître la victoire de Ravalomanana dès le premier tour. En juillet 2002, Ratsiraka quitte le pays pour la France.
Faut-il le rappeler: Marcos, Milosevic et Ratsiraka étaient des dictateurs fermement accrochés au pouvoir.
Ces exemples illustrent clairement que, dans des contextes autoritaires, la participation à des élections – même biaisées – peut devenir un levier de mobilisation populaire et contribuer à renverser un régime.
L’heure n’est donc plus aux querelles de stratégie ni aux débats stériles. Les diatribes, les insultes, la passivité physique et morale ne sauraient arriver à bout d’une dictature. L’heure est à la clarté des actes. Chacun, où qu’il soit, doit décider s’il veut rester spectateur ou devenir acteur du changement. Car le changement ne viendra ni d’un miracle, ni d’un sauveur, mais de notre engagement commun, constant et courageux. Il est temps d’arrêter de nous demander qui a raison et qui a tort. Ce qui compte, c’est ce que nous faisons maintenant. L’histoire ne retiendra pas nos discours, mais notre détermination. Soyons enfin à la hauteur de nos aspirations.
Aimé Gogue
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Togo, suivez Africa-Press