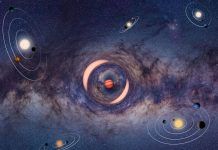Africa-Press – Togo. Dans son rapport sur les dynamiques du développement en Afrique, l’OCDE ausculte dans le détail la question du financement durable. Son auteur, Arthur Minsat, explique.
Dans un contexte économique mondial fortement contrarié, l’Afrique fait de la résistance. À en croire la Banque mondiale, le FMI ou encore l’OCDE, la croissance du PIB réel de l’Afrique devrait atteindre 3,7 % en 2023, soit un retour aux niveaux d’avant la crise du Covid-19. Des perspectives économiques positives, mais toujours insuffisantes pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’ONU pour le continent africain. Le récent sommet pour un « nouveau pacte financier », tenu à Paris en juin dernier, a démontré l’intensité des débats autour des défis économiques et climatiques qui préoccupent le continent africain.
Dans ce contexte, la dernière édition du rapport de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en partenariat avec la Commission de l’Union africaine, consacré aux Dynamiques du développement en Afrique, apporte un nouvel éclairage intéressant à décrypter. Sur la base d’une évaluation complète des sources de financement de l’Afrique, le document, riche de sept chapitres extrêmement fouillés, propose plusieurs pistes de réflexion et surtout des solutions pour les gouvernements africains et leurs partenaires pour améliorer la confiance des investisseurs et accélérer les investissements durables sur le continent. Principal auteur de cette étude, Arthur Minsat, chef de l’unité Europe, Moyen-Orient et Afrique au centre de développement de l’OCDE, a accepté de répondre aux questions du Point Afrique.
Le Point Afrique : Il a beaucoup été question de financement durable ces dernières années. De quoi s’agit-il ? Et quels en sont les enjeux pour l’Afrique ?
Arthur Minsat : Un investissement est dit « durable » lorsque la somme de ses bénéfices escomptés sur le plan économique, social et environnemental est supérieure à son coût global. Or, pour l’Afrique, on constate un déficit de financement des Objectifs de développement durable. Pour vous donner des chiffres concrets, je dirai que l’Afrique a besoin de 1,6 billion de dollars supplémentaires d’ici à 2030 – soit 194 milliards de dollars par an – pour atteindre ses ODD, soit environ 7 % du PIB. Ce qui est, en réalité, minime en comparaison des ressources financières disponibles à l’échelle du continent et du monde. Cela équivaut à moins de 0,2 % du stock mondial et à 10,5 % du stock africain d’actifs sous gestion. Le déficit pourrait donc être comblé si seulement 2,3 % des actifs financiers mondiaux étaient alloués à l’Afrique d’ici à 2030, soit moins que la part du continent dans le PIB mondial.
L’argent n’est donc pas le problème. Pour les pays africains, le principal enjeu est de combler ce déficit en attirant plus d’investissements, et de meilleure qualité. Les États peuvent mobiliser en interne l’épargne, les fonds de pension africains, et en externe les flux d’investissement étrangers, l’aide au développement, les transferts de la diaspora, les investissements de portefeuille, etc.
Dans tous les cas, la croissance est en Afrique. C’est la deuxième plus forte croissance au monde. On est à 3,7 % de croissance du PIB, juste derrière les pays d’Asie, avant les pays de l’OCDE, et avant les pays d’Amérique latine. Mais ce n’est pas suffisant pour atteindre les objectifs du développement.
Le continent peut réussir à inverser la donne, car il dispose d’atouts humains et naturels uniques pour attirer les investisseurs. Sa population est en forte croissance et elle est jeune. La moitié de la population africaine est âgée de 19 ans ou moins. En ce qui concerne le potentiel naturel, il offre des possibilités considérables d’investissement dans le développement durable, par exemple, le bassin du Congo est devenu le plus grand puits de carbone au monde devant la forêt d’Amazonie. Le continent dispose de 60 % des ressources solaires mondiales, mais elles ne sont pas suffisamment exploitées pour répondre à des problématiques de base comme l’accès à l’électricité, or l’accès à l’énergie est une contrainte majeure pour l’investissement.
Quelles sont les principales contraintes que rencontrent les États africains pour attirer plus d’investissements durables ?
La question de l’accès aux financements est un défi, tout comme la mauvaise perception du risque africain. Elle est liée à plusieurs facteurs, et entraîne un coût du capital qui est bien plus élevé que dans d’autres régions du monde. Ce qui est un frein majeur à l’impératif d’investir dans les économies africaines.
Pourquoi la perception du risque assignée à la région n’évolue pas malgré l’amélioration des fondamentaux macroéconomiques ou de la conjoncture économique mondiale ?
La conjoncture mondiale actuelle n’est pas propice, car les investisseurs essaient de se protéger contre le risque. Et le manque d’informations et de données, dans les pays africains, les pénalise fortement. Dans une majorité d’États, les systèmes statistiques sont défaillants, le coût d’accès aux informations freine les investissements et retarde les décisions.
Dans notre enquête, les investisseurs pointent surtout les risques macroéconomiques, ensuite les risques politiques, les risques techniques et régulatoires liés au changement des lois, et enfin les risques liés à la volatilité des monnaies, une problématique qui touche principalement les grandes économies africaines qui ont leur propre monnaie et qui font face à une grande volatilité, notamment depuis la crise Covid. Les risques opérationnels, les risques légaux et les risques de perception constituent d’autres barrières.
Pourquoi, malgré le fait que l’Afrique ait résisté aux vents contraires mondiaux, elle semble ne disposer d’aucun espace de respiration budgétaire ?
Parce que les risques macro-économiques persistent malgré les réformes très importantes engagées par de nombreux pays africains. Les initiatives internationales ne manquent pas non plus, comme le programme Compact Africa du G20 qui apporte un fort soutien à une dizaine d’États africains pilotes ou modèles qui mènent des réformes pour améliorer leur politique d’investissements.
Or, nous constatons que les crises mondiales ont eu un impact plus négatif sur les investissements en Afrique que dans le reste du monde. Ainsi, la part de l’Afrique dans les investissements directs étrangers est tombée à 6 % en 2020-2021, tandis que celle des pays avancés de l’OCDE atteint 61 %. Le coût du capital en Afrique a également augmenté plus que dans d’autres parties du monde, ce qui exclut certains gouvernements africains des marchés obligataires et empêche les investissements dans les secteurs d’avenir comme les énergies renouvelables. Alors même que la population africaine est beaucoup plus importante et en croissance, elle passera de 1,4 milliard d’habitants aujourd’hui à 2 milliards bientôt.
Donc, nous avons affaire à de véritables enjeux mondiaux et où la conjoncture macroéconomique n’est pas près de changer.
Quels sont donc les leviers d’action que vous avez identifiés pour améliorer ou changer cette mauvaise perception du risque africain ?
Nous avons identifié trois principaux leviers d’action pour améliorer la confiance des investisseurs et accélérer les investissements durables sur le continent. Le premier, c’est l’accès à de meilleures données et informations. C’est crucial, parce que la mauvaise perception du risque dans les pays africains persiste, notamment à cause du manque de données.
Si un investisseur n’a pas de données ou la bonne information, au bon moment et à un coût raisonnable, il ne va pas investir. Dans de nombreux pays africains, les simples données de projection de la croissance du PIB ne sont pas disponibles ou pas suffisamment comparables avec des données historiques, cela concerne, particulièrement, les recensements de la population ou des entreprises, en raison de la prépondérance du secteur informel.
On a aussi des manques importants au niveau sectoriel. Par exemple, si un investisseur veut investir dans le secteur automobile au Ghana, il doit avoir accès aux données sur les composants nécessaires pour participer à la chaîne de valeur automobile dans le pays, savoir ce que produit le Ghana, quels sont les composants qui peuvent être produits localement, etc. Or, ces données ne sont, la plupart du temps, soit pas suffisamment renseignées soit indisponibles.
Même constat au niveau opérationnel, lorsque les investisseurs doivent conduire des opérations de due diligence pour s’assurer que, par exemple, les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance pour les investisseurs de l’OCDE sont bien appliqués, nous avons constaté que l’accès à ces informations est plus difficile, prend plus de temps et est plus coûteux, ce qui entraîne automatiquement une augmentation du coût du capital en Afrique.
Quels sont les éléments qui vous ont interpellé par rapport aux profils des investisseurs ? Ont-ils tous les mêmes attentes ?
Pendant la crise Covid, on a comparé les investissements directs étrangers venant d’entreprises africaines vers d’autres pays d’Afrique, avec les investissements directs étrangers venant de compagnies non-africaines qui n’étaient pas localisées en Afrique et on a pu constater que pendant la crise Covid, où il y a eu un retrait énorme des investissements de par le monde, les investisseurs africains étaient plus confiants et stables, puisque le retrait des investissements a été trois fois moins important par des investisseurs africains que par des investisseurs non-africains.
Parce qu’ils connaissent mieux les réalités du terrain, ils vont pouvoir recouper plus facilement les informations qu’ils ont de par leur expérience dans d’autres pays ou bien par des réseaux d’investisseurs africains.
Cette différence d’attitude s’explique aussi par la nature des projets, dans la mesure où les gros investisseurs non-africains vont avoir tendance à investir dans des projets intensifs en capital en amont, telles les infrastructures, l’extraction de ressources naturelles.
Les États et leurs partenaires peuvent agir à de multiples niveaux. Les gouvernements doivent se doter d’institutions statistiques nationales. Ils peuvent aussi s’appuyer sur le sectoriel avec des partenariats publics privés. Ils doivent aussi penser leurs réformes en ayant à l’esprit les critères des agences de crédit, parce que l’absence d’information a un impact sur la notation sur le crédit d’un État et donc aussi sur la capacité des pays africains à mobiliser de la dette.
À quel niveau la communauté internationale peut-elle participer à la levée des obstacles ?
La communauté internationale devrait consacrer davantage de ressources à l’augmentation de la capitalisation des 102 institutions africaines de financement du développement qui existent sur le continent, afin de renforcer leur rôle d’intermédiaires entre financeurs internationaux et projets locaux, en particulier pour l’adaptation au changement climatique.
Ces institutions financières africaines connaissent mieux le continent que les investisseurs non-africains. Elles pourront mieux flécher leurs dotations dans le vivier des économies africaines, notamment celles des investisseurs africains, à travers les fonds de pension qui ont des actifs importants, qui atterrissent encore trop souvent en dehors des économies africaines, parce qu’eux aussi veulent se protéger contre le risque.
Pour vous donner un exemple concret, l’Égypte et le Maroc ont émis des bons du Trésor verts qui, entre 2016 et 2021, ont pu mobiliser 1,1 milliard de dollars pour ces deux seuls pays. C’est très bien. Par contre, lorsqu’on compare avec le reste du continent, ces deux pays captent 25 % des émissions de bons verts de l’ensemble du continent. C’est pourquoi il faut renforcer ces mécanismes de financement qui existent. Il y a un travail très important à mener par les gouvernements du point de vue régulatoire, sur le plan technique, et aussi de la communication.
Un autre levier d’action que nous identifions, c’est l’accélération de la mise en œuvre des initiatives autour de la zone de libre-échange continentale africaine.
Dans quelle mesure la Zlecaf peut-elle représenter un avantage pour financer le développement durable ? Ce n’est pas son objectif premier ?
Un protocole d’investissement de la Zlecaf a été décidé lors du sommet de l’Union africaine en février dernier, qui fixe un cadre intéressant pour le financement durable. Les discussions ont bien avancé sur le volet du marché digital africain, qui est en pleine croissance. Il y a eu également des avancées au sujet des corridors de développement pour améliorer l’accès à l’énergie. L’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest sont avancés sur ces corridors. En Afrique de l’Est, l’objectif est de connecter l’Afrique de l’Est et australe, ce qui pourrait multiplier par 2,5 la fourniture d’énergie. C’est un projet vraiment très important, aussi bien pour les pays pauvres que les pays riches comme l’Afrique du Sud, où on a des problématiques urgentes d’accès à l’électricité. En tout cas, on estime que ce corridor peut répondre à environ la moitié des besoins d’électricité dans ces deux régions d’ici à 2030. Et comme cette énergie est verte, cela permettrait aux deux régions de poursuivre sur une trajectoire de développement avec une faible émission de carbone.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays européens ont montré un intérêt renouvelé pour la question de la sécurité énergétique, avec à la clé un changement de pied quant à l’utilisation des combustibles fossiles. Que préconise l’OCDE aux États africains ?
Les problèmes et les réponses se situent à différents niveaux. Tout d’abord, il faut rappeler le contexte dans lequel ces débats ont émergé. Tout a commencé lorsque, sous les feux des critiques, les grandes institutions de financement mondiales, en particulier la Banque mondiale, ont décidé de ne plus financer ou d’accorder des prêts et des garanties sur des prêts pour l’extraction, notamment d’hydrocarbures. Malheureusement, avec la guerre en Ukraine, les pays occidentaux ont eux-mêmes redémarré leurs extractions ou la production de carbone, ce qui a été à juste titre décrié comme une injustice par les acteurs africains, en particulier par le président du Sénégal, Macky Sall, lorsqu’il tenait la présidence de l’Union africaine.
Il y avait aussi tout le débat sur les droits des tirages spéciaux et la part revenant à l’Afrique. La gouvernance mondiale était aussi questionnée, puisque les pays africains sont insuffisamment représentés dans les institutions de gouvernance mondiale, et l’Union africaine a demandé son siège au G20, ce sont vraiment des enjeux globaux qui dépassent un peu la question, mais qui sont très importants parce qu’ils cadrent la réponse.
Concrètement, on n’utilise pas suffisamment les ressources existantes, notamment celles qui sont propres. Lorsqu’on compare le coût du capital dans les projets, énergétique, en particulier propre et solaire, le coût du capital en Afrique est sept fois plus élevé qu’en Europe ou bien en Amérique du Nord, alors que le continent africain dispose de 60 % des ressources solaires mondiales.
Ce coût élevé impacte fortement les trajectoires de développement des pays. Si rien est fait, ils vont continuer à privilégier des solutions polluantes, alors que des solutions propres sont disponibles à foison sur le continent. Donc, il y a aussi des enjeux très concrets sur le cadre de l’investissement et qui ne sont pas du tout liés à la gouvernance mondiale. On peut vraiment faire une différence en travaillant sur ces thématiques financières, mais aussi au niveau des projets. Je souligne que certains projets pharaoniques, très importants, par exemple Noor au Maroc, qui ont été des grands succès, démontrent que ça peut vraiment fonctionner, si on apporte des réponses opérationnelles.
Je ne nie pas qu’il y ait un problème au niveau de la gouvernance, qui est politique et qui est évidemment l’objet d’un débat qu’on ne peut pas passer sous le tapis. Mais en même temps, des solutions opérationnelles existent, elles peuvent être immédiates, faire une différence sur le terrain, sur le bien-être des populations. Car la situation en Afrique est paradoxale, puisqu’on a une pollution de l’air croissante liée au fait que l’énergie propre n’est pas disponible. Ce qui est un enjeu concret pour les femmes en particulier, qui vont devoir couper du bois pour pouvoir cuisiner, se chauffer, etc.
On parle souvent de transition bas carbone, mais cette expression obère le fait que l’Afrique est déjà dans une trajectoire de développement bas carbone. Puisque, en rapport à la population, ils n’émettent que 4 % des émissions de CO2 au monde et dont la moitié produite par l’Afrique du Sud. Donc la trajectoire de développement bas carbone existe déjà. Maintenant, il s’agit de trouver des solutions pour que les modes de développement actuels ne reproduisent pas les erreurs du passé.
En portant les culpabilités les uns sur les autres, nous risquons d’oublier des enjeux réels qui sont très importants et qui ont un impact direct sur la population africaine aujourd’hui.
Source: lepoint
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Togo, suivez Africa-Press