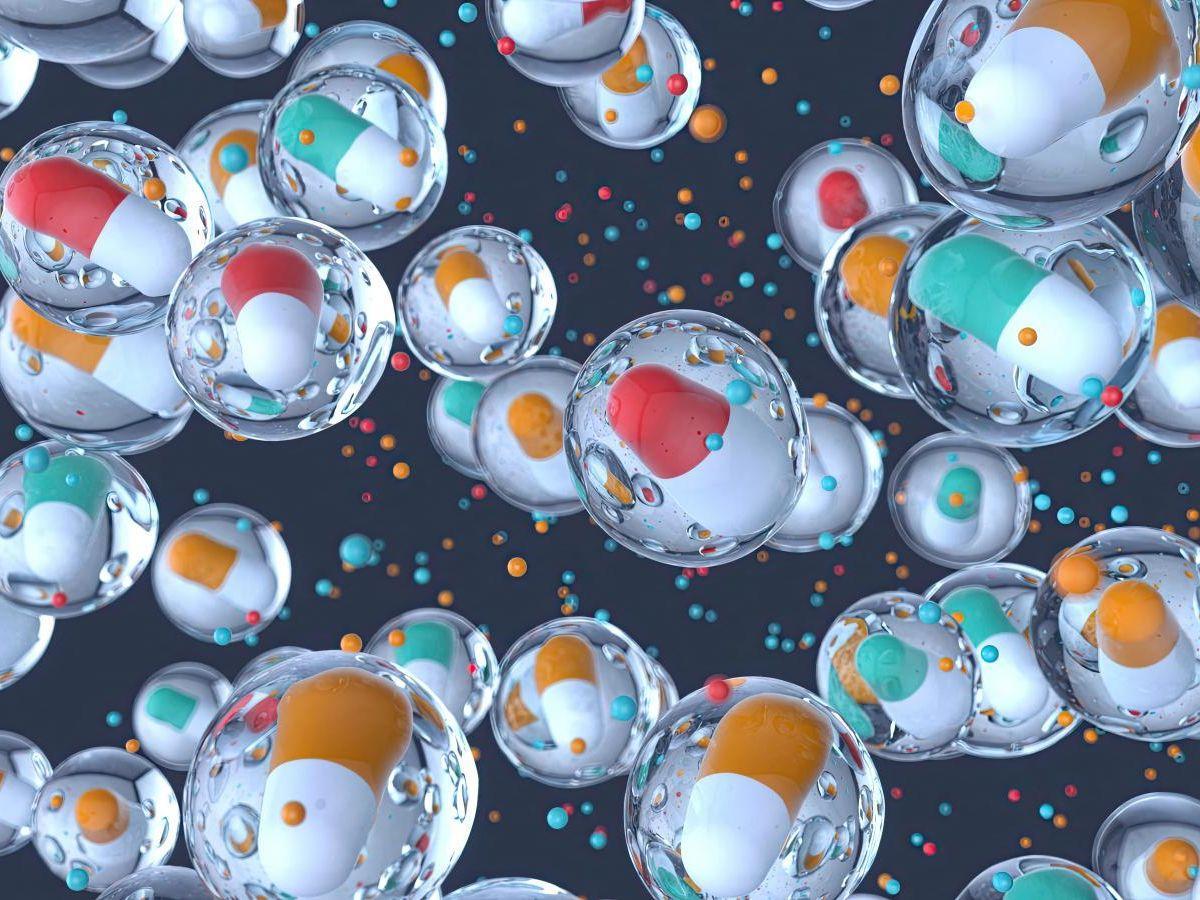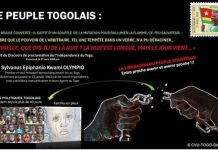Africa-Press – Togo. C’est un événement très attendu par la communauté des chimistes chaque année: les Rencontres Internationales De Chimie Thérapeutique (abrégé « RICT » – en anglais « International Conference on Medicinal Chemistry »). Organisées par la Société de Chimie Thérapeutique (une société savante indépendante, à but non lucratif), elles rassemblent 400 à 600 participants, nationaux et internationaux, sur trois jours au début du mois de juillet.
L’objectif ? Un état des lieux de la recherche mondiale en chimie thérapeutique et un tour d’horizon des « médicaments du futur », ceux qui sont destinés à mieux traiter demain les cancers, les maladies du système immunitaire ou encore les maladies neurodégénératives.
En 2024, pour la 58e édition, chercheurs, industriels, doctorants ou étudiants issus du monde académique, pharmaceutique et des biotechnologies, auront rendez-vous à Bordeaux les 3, 4 et 5 juillet.
Table-ronde sur les médicaments du futur
Lors de la 57e édition des RICT, qui s’est tenue à Lille du 5 au 7 juillet 2023, Sciences et Avenir a animé une table-ronde faisant le bilan de ces trois journées intensives de congrès, marquées par la présentation de nombreuses percées thérapeutiques, pour des pathologies aussi variées que le diabète de type 1, la maladie d’Alzheimer, la tuberculose ou encore la trisomie 21.
Six intervenants ont participé à cette table-ronde:
Rebecca Deprez, chercheuse et professeur de chimie à l’Université de Lille, spécialistes en immunologie et oncologie
Patricia Melnyk, professeur de chimie à la faculté de pharmacie de l’Université de Lille et co-fondatrice d’Alzprotect, une entreprise de biotechnologie axée sur le développement de traitements pour les maladies neurodégénératives comme Alzheimer
Olivier Defert, chimiste à Alzprotect en tant que directeur des opérations
Guillaume Laconde, chef de projet chez Oxeltis, une société spécialisée dans la synthèse de composés chimiques (comme des antiviraux) utiles pour la recherche et les essais cliniques
Nicolas Willand, professeur de chimie organique à l’université de Lille, spécialisé dans la recherche d’antibiotiques contre des maladies comme la tuberculose
Benoit Deprez, professeur de pharmacie à l’université de Lille et directeur scientifique de l’Institut Pasteur de Lille (IPL)
Après avoir évoqué les innovations thérapeutiques présentées lors du RISC 2023 et qui les ont le plus marquées, les six intervenants ont abordé trois autres sujets: les « petites molécules », la formation des chimistes et l’innovation thérapeutique en France. L’intégralité de la table-ronde est accessible en replay ci-dessous. Elle se termine avec les questions du public dans la salle et de la communauté Facebook de Sciences et Avenir.
Les « petites molécules », celles qui soignent quotidiennement
Certaines molécules, à l’origine de percées thérapeutiques présentées lors du RICT 2023, sont encore dans les boîtes de Pétri des chercheurs, quand d’autres font déjà l’objet d’essais cliniques. Elles sont toutefois nombreuses à faire partie de ce que les chimistes appellent les « petites molécules », celles dont on ne parle que trop rarement dans les médias (contrairement à des thérapies jugées plus innovantes, comme la thérapie génique) mais qui soignent tant de personnes tous les jours.
« Ces petites molécules sont très nombreuses dans la nature et les organismes se défendent contre leurs prédateurs avec, comme les plantes qui produisent des molécules amères ou qui rendent malades les animaux qui veulent les manger, explique Benoit Deprez. Pourquoi les animaux sont-ils malades ? Parce que cette petite molécule a des propriétés très particulières: elle peut aller à l’intérieur de nos cellules, passer la barrière de l’intestin et arriver dans le sang, et nous rendre potentiellement malades. Mais nous (chimistes, ndlr) nous retournons la situation, et nous allons utiliser des petites molécules qui rentrent dans l’organisme pour toucher un constituant en particulier et soigner une maladie. »
Chimiste, un métier de « passionné » plus accessible qu’on ne le pense
Pour devenir chimiste et participer à l’élaboration des médicaments de demain, il n’est pas forcément nécessaire de valider un doctorat. « Il y a une grande variété de formations dans nos équipes académiques et de l’industrie: des études de pharmacie, universitaires, ou un diplôme d’ingénieur chimiste, toujours en discussion et en interaction avec tous les autres domaines indispensables à notre métier, comme la biologie, la physique, les mathématiques – l’on parle beaucoup d’IA qui arrive de manière très importante aussi dans notre domaine – donc théoriquement, il y a plein de formations possibles. Des BAC+8, mais aussi des techniciens, des assistants ingénieurs et des ingénieurs qui font des études moins longues, mais qui ont un rôle tout aussi important », décrit Patricia Melnyk.
Rebecca Deprez conseille ainsi de « profiter de l’ouverture des laboratoires aux jeunes, collégiens et lycéens ». « Et parfois l’on arrive à semer la petite graine qui fait que des années plus tard, on les reverra dans nos cours. Il faut qu’ils viennent toquer aux portes, on est prêt à ouvrir », ajoute-t-elle.
« Moi les études ce n’était pas trop mon truc, témoigne Guillaume Laconde. J’ai fait un IUT pour devenir technicien de laboratoire, puis je suis allé à l’université et j’ai fini avec une thèse. Il y a toujours une évolution possible dans ce métier en fonction de ce que l’on veut faire et de la passion qu’on met aussi pour le découvrir ».
Quelles qualités vaut-il mieux avoir pour se lancer dans cette voie ? Pour Nicolas Willand, de la créativité. « L’important étant la passion », ajoute-t-il. Mais aussi de l’empathie, envers les patients et les collaborateurs, tout en se rappelant que « l’échec fait partie intégrante du métier », affirment les intervenants. L’échec et la patience sûrement. Car il faut compter « une bonne quinzaine d’années (…) pour probablement plusieurs centaines de millions d’euros pour rendre un médicament disponible dans la pharmacie de l’hôpital ou de sa salle de bain », admet Olivier Defert.
« Les innovations naissent aussi en France »
« Par rapport à d’autres pays, comme la Belgique, il n’y a pas assez d’investissements dans la recherche en médicaments en France », affirme le directeur des opérations d’Alzprotect.
Les intervenants sont unanimes: le point faible de l’Hexagone est son déficit de liens entre les différents acteurs du secteur. « On manque de contacts réels et fréquents entre le milieu académique et le milieu des biotechs, et entre les biotechs et la grosse industrie qui peut investir beaucoup d’argent, résume Benoit Deprez. Il faut que la société entière prenne connaissance de cette chaine du médicament. » Une chaine qui commence donc très en amont, sur les paillasses des chimistes et des biologistes, là où l’innovation nait.
« Les innovations naissent aussi en France (…) on a la capacité d’inventer et il faut la mettre en œuvre, que le monde politique parle au monde académique et qu’ils parlent au monde industriel, conclut le professeur de pharmacie à l’université de Lille. Un retard que la France a pris sur son voisin la Belgique, mais aussi sur les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, et que « des politiques menées sur le long terme » – selon Patricia Melnyk – pourraient combler.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Togo, suivez Africa-Press