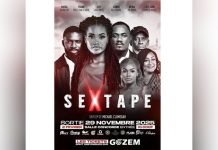Africa-Press – Togo. « C’est vraiment comme quand les gens disent qu’ils sont sous l’emprise de la drogue et que, vous savez, ils volent, ils font n’importe quoi. Je comprends tout à fait. J’ai l’impression que je suis prête à tout pour l’obtenir. Comme pour la drogue, en quelque sorte. » L’addiction dont souffre la jeune Eva (le prénom a été modifié) n’est pas à une substance, mais à un homme dont elle a pourtant subi la violence. « L’attachement mis en place par l’auteur des violences conjugales devient le principal mécanisme de contrôle, au lieu des menaces, de la force ou de l’enfermement », affirme auprès de Sciences et Avenir la criminologue Mags Lesiak, spécialiste des violences conjugales et des addictions à l’Université de Cambridge (Royaume-Uni). Avec sa consœur Loraine Gelsthorpe, elle a interrogé 18 victimes financièrement et géographiquement indépendantes de leurs bourreaux, comme Eva, et pourtant engluées dans la relation, comme aux prises avec une addiction, concluent-elles dans la revue Violence Against Women.
271.000 femmes en 2023 ont été enregistrées par les services de sécurité comme victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une augmentation de 10% par rapport à 2022, rapporte le ministère de l’Intérieur. 64% étaient des violences physiques, 31% des violences verbales ou psychologiques et 4% des violences sexuelles.
La recherche d’intensité
« Charmant. Charmant, charmant. C’est le premier mot qui me vient à l’esprit… Très charmant. Très séduisant. Toujours aimable. Toujours prêt à offrir un verre, d’une générosité apparente. Toujours très flatteur », se rappelle « Lily », une autre victime interrogée par les chercheuses. « Cette première phase est celle de l’appropriation de l’autre », commente pour Sciences et Avenir la psychologue clinicienne Julie Dufrou, spécialiste du traitement des violences conjugales du côté des victimes comme des perpétrateurs. « Les auteurs de violences utilisent le « love bombing » (littéralement « bombardement d’amour » en français, soit des démonstrations d’amour très intenses, ndlr), une période de séduction et de charme excessifs créant un attachement démesuré. » S’ajoutent à cela le « trauma-sharing », c’est-à-dire le partage par l’agresseur de ses propres traumatismes, renforçant l’empathie et l’attachement de la victime par la création d’un lien (le « trauma-bonding », l’attachement par le trauma partagé).
Cette période de manipulation émotionnelle « permet à la victime de se sentir comprise de manière unique et en sécurité sur le plan émotionnel », précise Mags Lesiak. C’est ce lien formé avant le début des abus qui constituera le principal mécanisme de contrôle et d’attachement entre victimes et auteurs de violences, sans avoir besoin de les contraindre physiquement ou matériellement. Pour elle, c’est un lien minutieusement et délibérément construit par l’abuseur. « La plupart des théories antérieures, telles que l’impuissance acquise, le masochisme ou la codépendance considèrent l’attachement de la victime comme une faiblesse personnelle ou psychologique. Elles expliquent cet attachement prolongé par des déficits internes plutôt que par les actions de l’agresseur », expose la criminologue.
Des hommes violents à dessein ou victimes de leurs propres traumatismes?
En maison d’arrêt, Julie Dufrou a rencontré nombre d’auteurs de violences conjugales. « En dehors de certains profils psychopathes ou narcissiques, tous ne sont pas conscients de ce qu’ils font », nuance-t-elle. « Pour certains profils comprenant par exemple des troubles de la personnalité borderline, les violences ne sont pas des actes calculés, mais plutôt guidés par une telle faiblesse de l’égo et de l’estime de soi qu’il leur est impossible de se remettre en question. Certains croient réellement que tout est de la faute de la victime. » La bascule vers les comportements violents peut ainsi résulter non pas de l’objectif avoué de détruire la victime mais d’un besoin d’intensité et de conflit chez des hommes ayant grandi dans un contexte violent et chaotique.
« La nature cyclique et répétitive de la manipulation, dans laquelle les auteurs anticipent et exploitent les réactions des victimes, suggère un certain degré de conscience instrumentale, même lorsqu’elle est déguisée en besoin émotionnel ou en auto-justification », réagit Mags Lesiak. De son point de vue, les auteurs de violence ne se pensent pas tant être victimes qu’ils ne se présentent en tant que telles. « Ce renversement courant n’est pas un malentendu, mais une tactique de contrôle qui leur permet de continuer à avoir accès à des ressources émotionnelles, sexuelles ou matérielles », analyse-t-elle. Julie Dufrou est plus nuancée. Pour elle, la posture de certains de ces auteurs de violences n’est pas systématiquement consciente, et peut donc changer au cours d’un travail thérapeutique. « Certains auteurs de violences, au décours d’un travail thérapeutique, prennent conscience que leurs comportements étaient en réalité manipulatoires. »
Deux traumas qui se répondent
« Des similarités peuvent être trouvées entre le vécu traumatique ou le parcours de vie des victimes et celui des auteurs, notamment dans l’enfance », note Julie Dufrou. Bien qu’il ne faille pas généraliser, les rôles genrés dans notre société patriarcale rendent plus susceptibles les garçons victimes de violences de devenir eux-mêmes auteurs de violences, là où les filles auront plus tendance à en devenir victimes. « C’est l’aspect commun de ces traumatismes respectifs qui contribue à la création de ce lien, une résonance entre deux attachements insécures », précise la psychologue. Développé dans les années 1970, l’attachement insécure est un concept qui s’applique aux personnes ayant été négligées ou maltraitées par leurs parents ou adultes ayant leur charge.
Pointer le trauma à la source des violences n’absout évidemment pas les auteurs de la responsabilité de leurs actes. « Le traumatisme ne cause pas la maltraitance: la plupart des personnes qui subissent un traumatisme ne font pas de mal à autrui. Le traumatisme peut influencer la manière dont les personnes régulent leurs émotions ou interprètent certaines situations, mais il ne supprime pas leur capacité à agir moralement », précise Mags Lesiak. D’après ses travaux, la cause de l’établissement de l’emprise par l’auteur des violences n’est pas tant la fragilité psychologique attribuée à la victime que la stratégie de manipulation mise en place.
Toutes les victimes n’ont pas de fragilité ancienne
« Les abus ne se limitent pas à un ‘type’ particulier de femmes, ils se produisent parce que quelqu’un choisit d’abuser, et non parce que la victime est particulièrement vulnérable », appuie Mags Lesiak. « Des facteurs situationnels et structurels — tels que l’isolement, la pauvreté, le patriarcat ou une délocalisation la coupant de son cercle social — jouent souvent un rôle tout aussi important ». Des facteurs de vulnérabilité externes que Julie Dufrou retrouve également dans sa pratique et qui peuvent donner prise à la stratégie des auteurs de violence en dehors de tout traumatisme interne ancien.
« Il est essentiel de mettre en évidence l’impact des stratégies mises en place par l’auteur pour créer ce lien », abonde la psychologue. « Si tout le monde peut en être victime, certaines personnes y sont plus vulnérables que d’autres en fonction de la qualité de leur estime d’elle-même et de leurs liens d’attachement. Ainsi, une personne qui a été dans une quête d’amour et de respect de ses parents aura tendance à reproduire ces difficultés au sein de ses relations. Mais la vulnérabilité de la victime ne suffit pas, il faut qu’il y ait une vraie stratégie de l’auteur pour créer l’emprise », conclut Julie Dufrou, par ailleurs co-autrice d’une publication détaillant ces stratégies de manipulation dans le cadre des violences conjugales.
Cette stratégie suit en effet un schéma très conservé, analysent Mags Lesiak et Loraine Gelsthorpe dans leur publication, incluant intensité émotionnelle, confidences partagées, alternance entre chaud et froid. « Je dis parfois qu’il est un peu comme Jekyll et Hyde », raconte d’ailleurs « Sophia » à propos de son propre ex-partenaire abusif. C’est cette alternance de périodes intensément positives et de violences qui crée une dépendance. « Les agresseurs créent souvent de puissants cycles d’affection et d’abus, appelés renforcement intermittent, qui sont neurologiquement puissants. Ces hauts et ces bas émotionnels activent les mêmes systèmes dopaminergiques impliqués dans l’addiction comportementale – la recherche compulsive d’expériences gratifiantes, telles que les jeux d’argent, les jeux vidéo ou les réseaux sociaux, malgré leurs conséquences néfastes », résume Mags Lesiak. « Nous utilisons effectivement cette métaphore de l’addiction avec les victimes: recontacter son ex-partenaire abusif s’apparente à un alcoolique prenant un verre de vin », abonde Julie Dufrou.
Comme une addiction
Le traitement des victimes de violences conjugales pourrait-il donc passer par des étapes communes à celui des addictions comportementales? « Ce parallèle avec les addictions me parait tout à fait pertinent, d’autant que la prise en charge des addictions aux substances implique également, en général, un travail de fond sur des facteurs de vulnérabilité internes comme l’estime de soi, le style d’attachement et la régulation émotionnelle », réagit Julie Dufrou. Pour Mags Lesiak, l’addiction créée en réponse à cette stratégie conservée entre les auteurs de violences conjugales implique que l’attachement excessif des victimes ne doit plus être traité « comme une pathologie », mais comme « une preuve de coercition ». « Pathologiser les victimes revient à transformer la violence structurelle en défaut personnel. Les cliniciens devraient plutôt s’attacher à identifier les stratégies utilisées par l’agresseur (manipulation, cycles de renforcement et conditionnement émotionnel) et recourir à des approches tenant compte des traumatismes et non culpabilisantes, qui rétablissent l’autonomie, plutôt que de diagnostiquer un dysfonctionnement », recommande-t-elle.
Rétablir l’autonomie des victimes, c’est aussi le cheval de bataille de Julie Dufrou sur le versant clinique. « Lorsque ces fragilités personnelles existent chez la victime, il est important de ne pas passer à côté dans la prise en charge, d’autant plus en cas d’identification d’un schéma de répétition », c’est-à-dire lorsque la même personne a été victime de plusieurs partenaires abusifs. « Dans ce cadre, l’identification de ses propres vulnérabilités et le travail en thérapie peuvent représenter une réappropriation de soi et de son pouvoir », ajoute la psychologue. Une étape essentielle après avoir vécu une relation abusive dans laquelle la victime a bien souvent perdu la trace de sa propre identité.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Togo, suivez Africa-Press