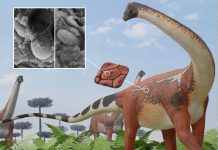Africa-Press – CentrAfricaine. Par ses mémoires, Le Choix de l’Afrique, Catherine Coquery-Vidrovitch ouvre un pan de sa vie de pionnière influente et d’historienne reconnue du continent.
Dans une maisonnette de la banlieue sud-parisienne, au sommet d’un petit escalier pentu, un bureau où trônent pêle-mêle livres, revues et catalogues d’exposition sur l’Afrique : chez Catherine Coquery-Vidrovitch, 85 ans, la parole vient facilement pour témoigner d’un parcours atypique dédié au continent africain. Pourtant, rien ne la prédestinait à le suivre : petite fille longtemps restée mutique, l’historienne grandit sous l’Occupation, à Beauvais puis Paris, dans une famille juive non pratiquante.
Très jeune, elle perd son père, blessé à mort au combat, et évolue dans le sillage d’une mère « très vivante et très aimée », propulsée malgré elle cheffe de famille. « Mes souvenirs d’enfance m’ont beaucoup marquée et j’avais envie de les communiquer », explique la professeure émérite dans son phrasé vigoureux. Ces souvenirs, « très cuisants » dit-elle, enrichis par les lettres envoyées à son époux lorsqu’elle séjourne en Afrique, constituent la matière première à l’origine de l’écriture du Choix de l’Afrique, tout juste paru aux Éditions La Découverte.
Mais quand donc l’Afrique s’immisce-t-elle dans cette histoire personnelle ? « Je n’avais absolument aucun lien avec le continent africain… aucun ancêtre qui y serait allé… Si, il y avait tout de même quelque chose, la guerre d’Algérie. J’avais un peu plus de vingt ans et tout cela m’a beaucoup touchée. Comme les jeunes de l’époque, j’étais contre la colonisation… », se souvient-elle. Cet événement marque le début de l’engagement d’une vie en faveur de l’histoire du continent – sa partie subsaharienne en premier lieu.
À LIRE AUSSIHistoire africaine : pourquoi il est important de s’y replonger
À LIRE AUSSIHistoire africaine : pourquoi il est important de s’y replonger
Avec ce rapport à l’Histoire immédiate – grandir juive sous l’Occupation –, Catherine Coquery-Vidrovitch se forge une détermination inébranlable. « Mon milieu familial était la seule chose qui existait. Tout le reste, c’étaient des ennemis. Puisqu’on était clandestins, toute personne rencontrée était susceptible de nous dénoncer. Ça, c’est quelque chose de très difficile à faire comprendre aux étudiants », insiste l’enseignante. À cela se double un sens aigu de la responsabilité : « Si tu fais quelque chose de bien, tu le sais ; si tu fais quelque chose de mal, tu le sais. Mais il n’y a que toi qui peux juger si tu le fais bien ou mal, parce que ce n’est pas Pétain qui va le dire pour toi », précise-t-elle à propos des préceptes de son environnement familial.
Ces valeurs ancrées en elle dès le plus jeune âge, Catherine Coquery-Vidrovitch mène un parcours scolaire d’excellence (classes préparatoires au lycée Fénelon à Paris, intégration de l’École normale supérieure de Sèvres, agrégation d’Histoire), quoique toujours en décalage avec les attentes du milieu institutionnel – il l’aurait bien vue conduire des recherches sur Paris au XVe siècle. « Mais rien ne m’aurait fait céder, j’avais une volonté farouche », dit-elle. Un caractère bien trempé, donc.
Puis, au début des années 1960, une rencontre déterminante, celle de l’historien de l’Allemagne Henri Brunschwig. Recruté par Fernand Braudel, chef de file après-guerre de l’école des Annales, avec lequel il s’était lié d’amitié dans les camps, Brunschwig prend la tête du tout nouveau Centre d’études africaines de la VIe section de l’École pratique des hautes études. La jeune enseignante rédige un article « test » sur le Dahomey au XIXe siècle, qui sera validé par le directeur. Elle se voit offrir un poste d’assistante. Dès lors, la voici engagée sur la piste subsaharienne : « Là je me suis dit, c’est l’Afrique. C’est vraiment anecdotique, je ne connaissais vraiment rien du tout ; je n’y étais jamais allée. Mais je n’étais pas raisonnable du tout. Il fallait que j’y aille. »
Le choix des sujets de thèse encadre cette décision : une recherche sur l’une des missions de Savorgnan de Brazza au Congo (1880-1883) puis une thèse d’État consacrée à l’histoire des grandes compagnies concessionnaires en Afrique équatoriale française. Des enjeux qui rejoignent ses « convictions issues d’une conscience politique empirique, marxiste et anticoloniale », comme elle l’écrit sans ambages dans ses mémoires – tout en mettant à distance la tentation d’un militantisme actif.
À LIRE AUSSIUn documentaire part sur les routes de l’esclavage
À LIRE AUSSIUn documentaire part sur les routes de l’esclavage
Août-novembre 1965, Catherine Coquery-Vidrovitch se rend pour la première fois sur son terrain de recherche en Afrique équatoriale : « Ce n’était pas facile à l’époque parce que les historiens travaillaient essentiellement sur les archives écrites… ». Difficile donc de justifier un séjour sur place alors que les documents restent conservés en France. Toutefois, à force d’entregent et de détermination, l’historienne de 29 ans parvient à forcer des portes qui semblent fermées. Et pour cause : « Quand je voulais quelque chose, je savais qu’il fallait que je fasse quelque chose. » Rompue au fonctionnement des institutions, sa force de caractère l’accompagnera toute sa vie, notamment dans la mise sur pied en 1974 du laboratoire « Connaissance du tiers-monde » adossé à Paris-7 puis associé au CNRS.
Munie des recommandations nécessaires pour se frayer un chemin dans cet univers peu balisé, Catherine Coquery-Vidrovitch découvre avec une surprise teintée d’effroi une société postcoloniale profondément raciste. À l’instar de ces sociétés forestières qui occupaient ses recherches : « C’était extraordinaire à l’époque : 200 bûcherons rassemblés entre 18 mois et 3 ans dans un coin de forêt presque inaccessible, à plusieurs heures, sinon plusieurs jours de marche. Et la gloire du directeur blanc : se faire construire de belles maisons de bois par les bûcherons au milieu de la forêt. C’était… comme dans un film. » Pour autant, la chercheuse reconnaît ses propres conditions privilégiées : « À l’époque, paradoxalement, être une femme seule était un atout. Pour les Français, une jeune femme seule, il faut l’aider. Et pour les Africains, j’étais une espèce d’ovni bizarre, donc ils étaient aussi extrêmement aimables. »
L’histoire se déroule : des années 1970 jusqu’en 1990, la professeure s’investit auprès de la nouvelle génération d’historiens sénégalais, avec lesquels elle coconstruit l’« École de Dakar ». En parallèle, insatiable observatrice, Catherine Coquery-Vidrovitch mène des incursions dans les anciennes colonies britanniques ainsi qu’au Mozambique lusophone. « J’avais envie de connaître le plus d’États africains possible. » En parallèle, l’universitaire prend du galon : elle assure désormais la direction de thèses, une cinquantaine durant l’ensemble de sa carrière, avec des étudiants parfois devenus des personnalités publiques, dont Achille Mbembe, pour ne citer que lui, l’intellectuel missionné par Emmanuel Macron pour préparer le Sommet Afrique-France qui vient de se tenir à Montpellier.
À LIRE AUSSIGaëlle Beaujean : « Le continent africain n’était pas replié sur lui-même »
À LIRE AUSSIGaëlle Beaujean : « Le continent africain n’était pas replié sur lui-même »
En parallèle, la chercheuse se frotte dès le début des années 1980 et jusqu’en 2005 au monde universitaire américain, dont l’approche parfois militante de son objet d’études la surprend. Ainsi écrit-elle à propos des années 1990 : « [Les départements d’histoire, de sociologie et de littérature] affichaient du coup [en recrutant des spécialistes africains] une certaine tendance à devenir des nids d’“afrocentristes” plus militants que scientifiques, revendiquant le monopole de traiter de l’Afrique en raison de leur couleur. »
De retour en France, retraitée émérite de l’université, elle s’engage dans différents projets : commissariat associé de l’exposition « L’Afrique des routes » au musée du quai Branly en 2017, conseil historique de la série documentaire Les Routes de l’esclavage diffusée par Arte en 2018… Pour n’en retenir qu’un, le plus récent, patronné par l’Unesco et disponible en ligne d’ici la fin de l’année : la révision de l’Histoire générale de l’Afrique, entreprise initialement sous l’égide de l’Organisation de l’Unité africaine en 1964 sur une période de trente ans.
Un projet délicat compte tenu de la diversité des membres du conseil scientifique auquel elle se joint : « Pendant une bonne année, sinon deux années, il a fallu apprendre à dialoguer : pas tellement avec les historiens africains, parce que ça fait soixante ans que je les fréquente, mais avec les Caribéens et surtout les African Americans. On a mis deux ans à se débarrasser d’arrière-pensées qui n’avaient rien à voir là mais qui étaient très présentes. » Et de compléter franchement : « Le sectarisme qu’on a eu très fort au début… c’est un manque de connaissances. Ça me confortait dans l’idée qu’il fallait absolument écrire une histoire de tout ça. » Une nécessité qu’elle pointe aussi côté français : « L’histoire africaine est très peu enseignée. Elle commence avec la colonisation ou avec les indépendances… Cela change depuis une petite dizaine d’années parce qu’on se donne du mal. Est-ce si étrange de penser que l’Afrique subsaharienne a fourni l’or du monde entre le XIIe et le XVe siècle ? »
Et de conclure, confiante dans un savoir accumulé avec passion sur plusieurs décennies : « Le seul remède, c’est d’enseigner que toutes ces connaissances existent. »
* Catherine Coquery-Vidrovitch, « Le Choix de l’Afrique. Combats d’une pionnière de l’histoire africaine », Éditions La Découverte, parution le 14 octobre 2021, 304 pages, 22 €.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la CentrAfricaine, suivez Africa-Press