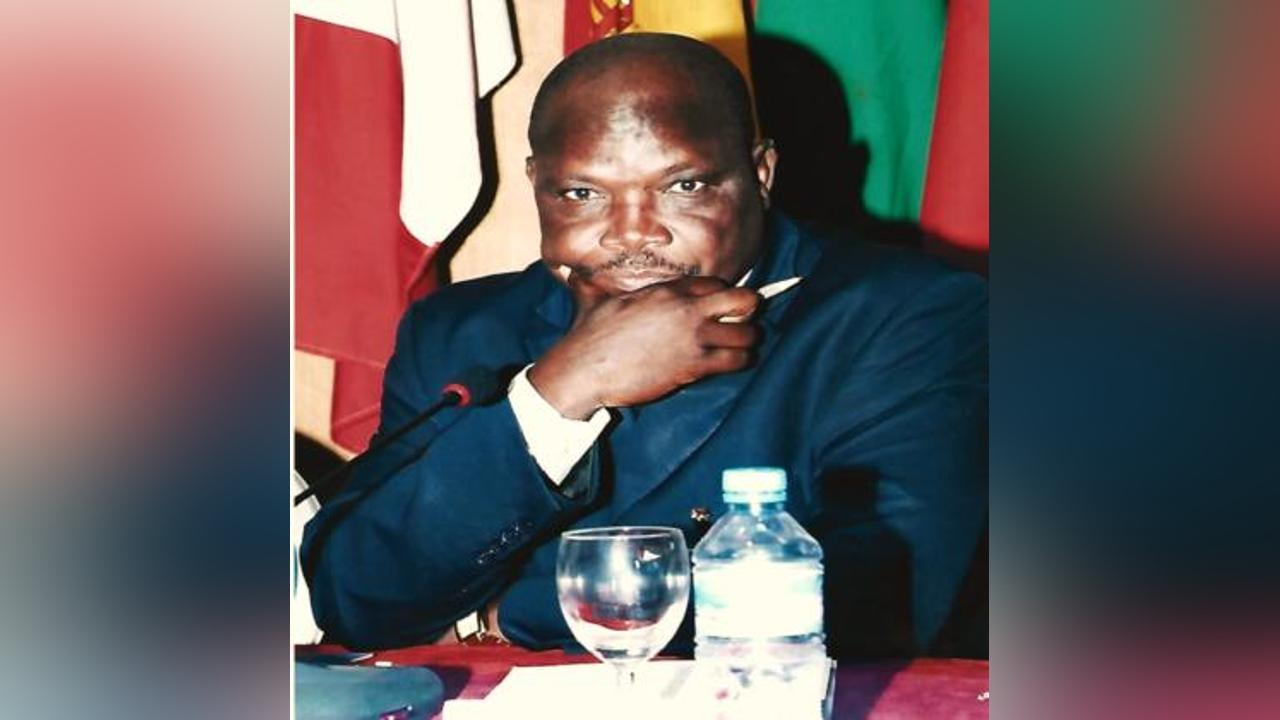Africa-Press – CentrAfricaine. Dans un monde où les nations se construisent sur les rêves d’unité et de progrès, la République centrafricaine (RCA) semble s’enliser dans un paradoxe tragique: celui d’un pays riche de promesses mais fragilisé par des fractures internes qui menacent son identité même.
Autrefois perçue comme un havre de paix au cœur de l’Afrique, la RCA traverse aujourd’hui une crise qui dépasse les simples conflits armés pour toucher l’essence de ce qui fait une nation. Dans son ouvrage incisif, Quand la politique des mains tendues du président Touadéra soulève des interrogations et réflexions, Elie Oueifio met en garde contre ce danger imminent: « Vouloir aujourd’hui pour des intérêts égoïstes et personnels substituer l’État nation par l’État tribal, c’est rouvrir les cicatrices de la servitude en conduisant le peuple dans une nouvelle colonisation ». Cette alerte, ancrée dans une analyse profonde des dynamiques politiques et sociales, invite à réfléchir sur un glissement insidieux: celui qui pourrait transformer une mosaïque harmonieuse de tribus en un champ de bataille ethnique.
Les fondations d’un État nation: une unité forgée dans la douleur
L’histoire de la RCA est celle d’une nation née d’un effort collectif pour transcender les particularismes tribaux. Sous l’impulsion de figures comme Barthélemy Boganda, l’idée d’un État nation a émergé comme un rempart contre la division et la servitude coloniale. Boganda, père de l’indépendance, avait compris que l’unité ne se décrète pas: elle se construit par le dialogue et le dépassement des intérêts locaux au profit d’un projet commun. Cette vision a porté ses fruits dans les premières décennies post-indépendance, où la RCA était perçue comme un modèle de coexistence pacifique entre ses nombreuses ethnies – Gbaya, Taley, Banda, Yakoma, Sara, Nzakara et bien d’autres.
Pourtant, cette unité n’a jamais été exempte de fragilités. Dès les années 1980, les crises politiques ont révélé des tensions latentes, souvent exacerbées par des leaders prêts à instrumentaliser l’appartenance ethnique pour asseoir leur pouvoir. Elie Oueifio souligne dans son livre que cette dérive n’est pas nouvelle: elle s’inscrit dans une logique où « les plaisirs et les intérêts personnels » des dirigeants prennent le pas sur la volonté populaire. L’État nation, censé incarner une souveraineté partagée, s’est progressivement fissuré sous le poids de ces ambitions égoïstes, laissant place à une gouvernance où les appartenances tribales deviennent des outils de mobilisation politique.
Les manifestations du glissement: quand le tribalisme devient une arme
Le passage de l’État nation à l’État tribal ne s’est pas fait en un jour. Il s’est opéré à travers des signes visibles, que l’auteur décrypte avec une lucidité implacable. L’un des exemples les plus frappants est la montée en puissance des discours ethniques dans les arènes politiques. Oueifio cite les résolutions du MCU (Mouvement Cœurs Unis), parti au pouvoir, qui envisagent de « dissoudre les partis politiques KNK et URCA et neutraliser tous les cadres KNK et Gbaya à l’exception de ceux qui feront allégeance au MCU ». Cette stratégie, visant à marginaliser une ethnie entière – les Gbaya, associés à l’ancien président François Bozizé – illustre comment le tribalisme est devenu une arme pour consolider le pouvoir.
Un autre symptôme de ce glissement est l’érosion des institutions nationales au profit de réseaux clientélistes basés sur des loyautés ethniques. Les ministères, censés servir l’ensemble du peuple, sont souvent perçus comme des fiefs réservés à certaines tribus, tandis que les forces armées elles-mêmes se fragmentent en factions liées à des affiliations régionales. Cette tribalisation de l’État s’accompagne d’une perte de légitimité: les citoyens ne se reconnaissent plus dans un gouvernement qui semble privilégier les siens au détriment des autres.
Enfin, les conflits armés récurrents, de la rébellion Séléka aux affrontements avec les Anti-Balaka, ont amplifié cette dynamique. Ces groupes, bien que motivés par des revendications politiques ou économiques, s’appuient souvent sur des bases ethniques pour recruter et mobiliser. Comme l’écrit Oueifio, « les sirènes ou les manipulateurs et mafieux ne cherchent que leurs intérêts », utilisant les divisions tribales pour maintenir un chaos profitable. Ce faisant, ils sapent l’idée même d’une nation unifiée, remplaçant le drapeau national par des étendards locaux.
Les conséquences: un danger existentiel pour la Centrafrique
Ce glissement vers un État tribal n’est pas une simple dérive politique: il représente une menace existentielle pour la RCA. En premier lieu, il fragmente la cohésion sociale, transformant des voisins en ennemis potentiels. Là où Boganda voyait une « mosaïque de tribus » comme une richesse, le tribalisme moderne en fait une source de discorde. Les violences intercommunautaires, comme celles qui ont opposé des groupes peuls à des populations locales dans l’Ouest, en sont une illustration tragique.
Sur le plan politique, ce phénomène paralyse toute tentative de gouvernance efficace. Un État tribal ne peut prétendre à une légitimité universelle: il devient une arène où chaque groupe lutte pour sa part du pouvoir, au détriment de l’intérêt général. Oueifio met en garde: « La structure politique se détériore lorsqu’elle est assujettie aux considérations de la structure sociale, tribale, familiale ou confessionnelle », reprenant ici les mots prophétiques de Mouammar Kadhafi. Cette instabilité chronique ouvre la voie à une dépendance accrue vis-à-vis des puissances étrangères, qui exploitent ces divisions pour leurs propres intérêts économiques ou stratégiques.
Enfin, le risque ultime est celui d’une « nouvelle colonisation », comme le prédit l’auteur. En perdant son unité, la RCA s’expose à devenir un terrain de jeu pour des forces extérieures – qu’il s’agisse de mercenaires, de multinationales ou d’États voisins. L’État nation, déjà affaibli, pourrait alors céder la place à un État fantoche, incapable de protéger sa souveraineté ou de répondre aux besoins de son peuple.
Vers une renaissance nationale: des solutions inspirées par la vérité et l’unité
Face à ce glissement fatal, des solutions existent, et Elie Oueifio en propose plusieurs, puisant dans une sagesse à la fois spirituelle et pratique. La première étape est une prise de conscience collective: « L’identification, la dénonciation et la mise en cause des vrais auteurs des crises centrafricaines » doivent devenir une priorité. Cela implique de briser le silence autour des manipulateurs qui exploitent le tribalisme, qu’ils soient au sein du pouvoir ou dans l’opposition.
Ensuite, l’auteur appelle à un retour aux principes fondateurs de l’État nation, à travers le « pardon et la réconciliation ». Ces vertus, qu’il qualifie de « seuls remèdes efficaces prescrits par Dieu », ont prouvé leur efficacité ailleurs – au Rwanda, par exemple, où Hutus et Tutsis ont surmonté un génocide pour rebâtir une nation unie. En RCA, cela passerait par un dialogue politique inclusif, réunissant toutes les composantes de la société, y compris les anciens dirigeants, pour reconstruire un contrat social basé sur l’équité et la justice.
Enfin, la refondation des institutions est cruciale. Oueifio insiste sur le rôle de l’Inspection générale d’État et du ministère de la Justice pour déverrouiller les obstacles et garantir une gouvernance impartiale. Un pouvoir législatif « vertueux » et un exécutif débarrassé des « chants des sirènes » pourraient restaurer la confiance dans l’État, faisant de celui-ci un reflet de la nation entière rather than d’une tribu dominante.
Il y’a lieu de noter que la Centrafrique se tient à un carrefour décisif. Le glissement de l’État nation vers un État tribal, s’il se confirme, risque de signer la fin d’un rêve porté par des générations de patriotes. Mais ce destin n’est pas inéluctable. Comme le souligne Elie Oueifio, « l’unité du peuple Centrafricain constitué à partir d’une mosaïque de tribus est une œuvre de longue haleine dont le prix à payer est, reste et demeure le sang de nos ancêtres communs ». Refuser cette dérive, c’est honorer ce sacrifice en choisissant la vérité, la réconciliation et la justice comme fondements d’une renaissance nationale. La question reste posée: les Centrafricains sauront-ils saisir cette chance avant qu’il ne soit trop tard?
Source: corbeaunews
Pour plus d’informations et d’analyses sur la CentrAfricaine, suivez Africa-Press