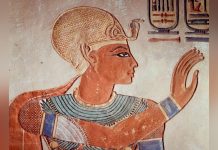Africa-Press – Comores. 1. Comment repenser ses déplacements ?
À l’heure de la numérisation de la société, un déplacement ne se subit plus, il s’optimise. La multimodalité s’est ancrée dans les habitudes, en particulier dans les zones urbaines. Les outils numériques permettent de combiner les mobilités “douces”, (marche, trottinette électrique, vélo électrique), les transports en commun et la voiture (personnelle, en libre-service, taxi ou VTC) pour se déplacer de façon plus efficace et flexible. Le trajet retour, par exemple, n’est plus conditionné par celui de l’aller.
Selon une enquête réalisée pour les mutuelles MMA par Opinionway, 75 % des Français utilisent déjà au moins deux modes de transport dans leurs déplacements réguliers, 29 % au moins trois. Pour les trajets plus longs, extra-urbains ou de banlieue à banlieue, le recours à la voiture reste largement dominant. Mais là encore, grâce aux outils numériques, de nouveaux usages se sont développés. C’est le cas du covoiturage qui a été multiplié par 3,5 entre février 2022 et 2023 (815.000 déplacements). Des pratiques encouragées par la hausse du prix des carburants.
2. Quelle mobilité douce de proximité choisir ?
L’essor récent des “engins de déplacement personnel motorisés” (EDPM) a rebattu les cartes des déplacements de proximité. Les EDPM ont remis au goût du jour la trottinette et le vélo, en exonérant leurs utilisateurs de l’effort physique qui leur était jusqu’ici associé. Le développement de la location (services proposés par les municipalités ou des sociétés privées comme Lime, Tier, Dott…) résout les problèmes liés à la possession (coût, stationnement, vol…). L’usage du vélo a ainsi augmenté de 28 % entre 2019 et 2021, selon l’association Vélo & Territoires. L’aménagement des pistes cyclables dans les grandes villes (1094 km à Paris, 540 km à Lyon) rassure et encourage de plus en plus d’usagers à opter pour ce moyen de transport, même s’il existe encore d’importantes disparités entre les villes. Les aides financières de l’État et des municipalités jouent aussi leur rôle de soutien. Mais il reste des freins comme la question de la sécurité (le port du casque n’est obligatoire qu’avant 12 ans), du vol (identification des cycles et stationnement sécurisés) et le manque de possibilités d’intermodalité train/vélo ou car/vélo.
3. La voiture réussira-t-elle le défi de l’électrique ?
Selon l’Insee, la part kilométrique de la voiture dans les déplacements est de 83 %. Il est donc impératif de réduire l’impact sur l’environnement de ce mode de déplacement. L’électrique permet tout d’abord de supprimer les émissions au moment de l’usage, ce qui, dans les agglomérations fortement touchées par la pollution, a un effet bénéfique immédiat. Cette énergie est de surcroît adaptée à la conduite urbaine, qu’il s’agisse de l’agrément (progressivité et absence de bruit) ou de l’autonomie (faible vitesse, nombreux freinages qui rechargent les batteries). La charge reste un problème. Fin 2022, la France comptait 82.000 bornes accessibles au public, pour un objectif de 100.000 en… 2021. Renault (avec l’application Plug Inn) et diverses start-up tentent de rendre accessibles les points de charge privés au nombre de 688.000 selon Enedis, mais souvent limités en puissance. Le frein le plus important reste le surcoût de cette technologie (20 %) sur une citadine, en raison de la cherté des batteries. L’achat est certes facilité par les aides (bonus de 5000 euros), mais la rentabilisation n’est encore envisageable que sur le très long terme.
4. Les transports en commun peuvent-ils séduire plus largement ?
Les transports en commun ne représentent que 11 % de la part kilométrique des déplacements, selon l’Insee. Deux critères peuvent permettre d’augmenter leur attractivité. Le premier est le prix, la fréquentation étant étroitement liée aux tarifs pratiqués. Mais en période d’inflation, de crises énergétiques et de verdissement des motorisations, se pose la question du financement. Le second critère est la qualité du service proposé. En matière de temps de transport (la marge d’acceptation est de 50 % en plus du temps en voiture), de confort (un voyage debout réduit l’acceptation du temps supplémentaire) et de fréquence. Enfin, un transport en commun n’est pas un transport commun : chaque territoire a ses spécificités, avec ses réponses adaptées.
5. L’avion sera-t-il le grand perdant des nouvelles mobilités ?
La pandémie a stoppé net le secteur aérien qui aurait pu ne jamais s’en relever. Mais la sortie de la crise sanitaire s’est accompagnée d’un besoin de voyage qui a relancé l’activité. En 2022, le trafic aérien a ainsi atteint 68,5 % de son niveau d’avant la crise, selon les chiffres de l’Iata (Association du transport aérien international, qui attend le retour à l’étiage pour cette année). Ce, malgré le contexte géopolitique et la crise de l’énergie, qui ont fait augmenter le prix des billets de 22 % (long-courriers) selon le ministère de la Transition écologique. Les compagnies aériennes se soucient aujourd’hui davantage de la pénurie de pilotes (entre 34.000 et 50.000 en 2025, selon le cabinet Wyman) que de l’absence de passagers. Si le mouvement flyskam – ou la honte de prendre l’avion -, né en Suède en 2018, a fait parler de lui, il ne se traduit pas dans les chiffres de fréquentation des avions. Il a en revanche mis la pression sur les avionneurs pour accélérer leur verdissement. Airbus avec le projet ZEROe et Boeing avec l’Ecodemonstrator sont engagés dans un processus de décarbonation de leurs appareils, grâce respectivement à l’hydrogène et aux carburants de synthèse.
“L’IA offre un fort levier d’optimisation”
Questions à Yann Briand, responsable mobilités du futur à l’IRT SystemX.
Comment définir l’intelligence artificielle (IA) appliquée à la mobilité ?
C’est la capacité à agréger et à traiter des données massives. L’objectif est d’extraire de la valeur de ces jeux de données qui sont hétérogènes, disparates et déconnectés. Un autre enjeu consiste à connecter différents domaines, par exemple la demande de transports et les besoins en énergie qui en découlent ou les problématiques de maintenance liées. Cela doit permettre d’anticiper les situations, une des grandes attentes liées à l’IA. Elle doit aussi permettre de repérer des signaux faibles dans l’évolution des déplacements, qui, sinon, ne pourraient pas être identifiés.
Quels sont les gains attendus ?
Les transports font aujourd’hui partie des environnements déjà fortement numérisés. L’optimisation du traitement de ces données grâce à l’IA offre des leviers d’amélioration de la performance. Les modèles qui en sortent ouvrent des perspectives d’un meilleur rendement sur le plan économique mais aussi, par extension, écologique et en matière d’efficacité d’usage. L’IA donne la possibilité de proposer un bouquet d’offres de mobilités adapté et dynamique dans un marché lui-même en pleine révolution.
Y a-t-il des freins au développement de l’IA dans la mobilité ?
Comme dans beaucoup de domaines, il y a de gros enjeux de souveraineté des données. Il faut pouvoir garantir un environnement de confiance et en assurer l’intégrité aux citoyens comme aux entreprises.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Comores, suivez Africa-Press