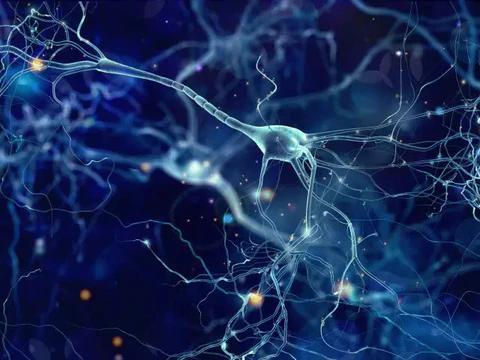Africa-Press – Côte d’Ivoire. 10% de la population souffre de migraines dans le monde. Et pourtant, le mécanisme de la douleur qui se cache derrière était encore très mal compris. Quel lien entre l’aura visuelle perçue par certains et l’apparition, plus tard, du mal de crâne ?
Pour la première fois, une équipe vient de découvrir un mécanisme inédit qui explique pourquoi la douleur est perçue avec un délai et pourquoi elle se concentre souvent d’un seul côté du crâne. Ces résultats, publiés dans la revue Science, laissent espérer de nouveaux traitements pour les malades.
Les auras, des flashs lumineux dans la vision
Environ 1 personne sur 10 souffre de migraines et un quart d’entre elles font l’expérience d’auras. Ce phénomène se caractérise par des flashs lumineux dans la vision, des zones où la vision se brouille, une vision parfois doublée, des sensations de picotement ou des pertes de sensations dans les membres. Cette aura est due à un mécanisme appelé la « dépression corticale envahissante ». Concrètement, une vague de glutamate et de potassium irradie le cerveau au point que les neurones se dépolarisent de leurs charges électriques.
La circulation sanguine est altérée et les niveaux d’oxygène se réduisent dans l’organe. En règle générale, la dépolarisation a lieu dans l’aire visuelle, d’où les symptômes liés à la vue apparaissant avant le mal de crâne.
Une barrière hémato-encéphalique pas si étanche que ça
Le cerveau, pourtant, est un organe qui ne ressent pas la douleur. Comment ces signaux arrivent-ils alors jusqu’au système nerveux central ? Car c’est bien ce réseau de communication qui transmet l’information entre le cerveau et le reste du corps via les mêmes nerfs sensibles qui détectent aussi le toucher et la douleur venue d’une source extérieure. Or en observant le phénomène de migraine chez la souris, il apparaît que les protéines relâchées pendant l’aura sont transportées dans le liquide céphalo-rachidien. Et qu’elles prennent un chemin que la recherche n’avait jusque-là jamais soupçonné.
En temps normal, la barrière hémato-encéphalique protège le cerveau des agents pathogènes, des toxines et des hormones circulant dans le sang. C’est à travers ce filtre très sélectif que les nutriments nécessaires au cerveau sont transmis et les déchets sont éliminés. « Les nerfs périphériques ont en général une barrière externe composée de tissus conjonctifs très serrés. Ils empêchent des solutés externes dans l’espace extracellulaire nerveux », explique Martin Kaag Rasmussen, chercheur à l’Université de Copenhague (Danemark) et premier auteur de l’article.
On pensait donc jusque-là que le ganglion trigéminal, comme le reste du système nerveux périphérique, était totalement extérieur à la barrière hémato-encéphalique. Mais en observant les échanges cérébraux de plus près, son équipe s’est aperçue que dans le cadre des migraines, la barrière hémato-encéphalique n’était pas si étanche que cela. Il existe un endroit où la frontière est poreuse: le ganglion trigéminal, situé juste sous le cerveau. « A cet endroit-là, la barrière est beaucoup moins épaisse, environ un tiers est normal. Le ganglion est donc en contact direct avec le liquide céphalo-rachidien et les fluides peuvent affluer librement dans le ganglion », précise le chercheur.
Le délai et la localisation de la douleur enfin décryptés
Les protéines pro-inflammatoires libérées dans le cerveau lors de l’aura sont en fait transportées dans le liquide céphalo-rachidien avant d’arriver au ganglion trigéminal. Or justement, ce dernier est un centre nerveux clé du corps humain et est responsable des douleurs perçues sur la face et la tête. Une fois passées de l’autre côté de la barrière, les protéines relâchées par l’aura viennent activer les neurones sensoriels du ganglion. Et c’est là que la douleur apparaît.
Entre le moment où la réaction se passe dans le cerveau et celui où elle est réellement perçue par le malade, il y a donc bien un délai. Cette douleur à retardement est due au temps que les protéines prennent pour faire leur chemin dans le cerveau. « Nos résultats montrent qu’il faut environ 30 minutes aux protéines pour voyager du cortex visuel au ganglion trigéminal. Cela correspond au délai de 5 à 60 minutes que les patients ressentent entre le début des auras et l’arrivée de la douleur », poursuit Martin Kaag Rasmussen. Ces travaux lèvent aussi le voile sur la localisation de la douleur, qui se concentre parfois seulement d’un côté de la tête. « Nous avons aussi démontré que les liquides présents d’un côté du cerveau s’écoulent ensuite dans les ganglions trigéminaux du même côté et non du côté opposé. Ce trajet pourrait expliquer pourquoi la migraine ne se traduit par des maux de tête que d’un seul côté. »
En tout, 12 protéines qui s’arriment au ganglion et déclenchent la douleur ont pu être identifiées. L’une d’entre elles, appelée CGRP, représente déjà une cible dans le cadre de traitements contre la migraine. Mais de nouveaux inhibiteurs pourraient être créés grâce à cette nouvelle découverte, dans l’objectif de supprimer la sensation de douleur chez les patients. Un espoir pour les personnes qui ne répondent pas aux traitements actuels d’être soulagés grâce à de nouvelles thérapies.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press