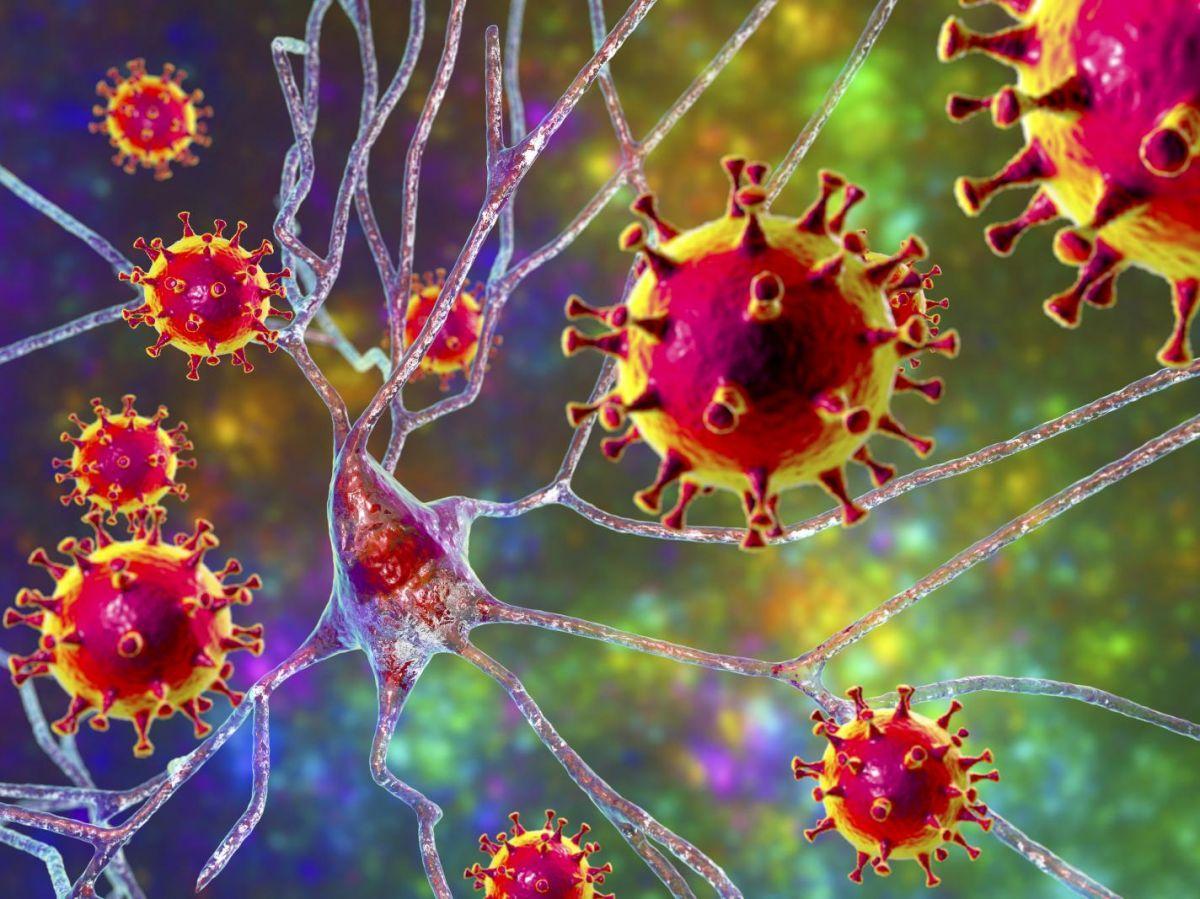Africa-Press – Côte d’Ivoire. Encéphalite, méningite, méningo-encéphalite, neurotoxoplasmose, myélite… Les infections du système nerveux central (SNC) peuvent être très graves voire mortelles. Généralement elles évoluent rapidement en dégradant l’état du patient, et elles sont souvent difficiles à diagnostiquer en raison du chevauchement des symptômes cliniques. Ces infections nécessitent donc un diagnostic et une prise en charge aussi rapides que précis.
Le diagnostic de ces maladies se base généralement sur le cumul de plusieurs tests: sérologiques, de culture, d’amplification ciblée des acides nucléiques (lire l’encadré ci-dessous pour plus de détails)… Il reste à ce jour coûteux, chronophage et d’une relative efficacité (exemple: 50% d’échec pour le diagnostic de la méningo-encéphalite). De plus, il se heurte à la limitation des échantillons, en particulier ceux issus de liquide céphalo-rachidien (LCR), ou de tissu cérébral, pour pratiquer les différents tests.
Une révolution est en marche
Pour tenter de remédier à cette situation, une équipe de chercheurs de l’université de Californie à San Francisco (UCSF), aux Etats-Unis, a mis au point un nouveau type de test métagénomique qui a fait l’objet d’une publication le 12 novembre 2024 dans la revue Nature medicine. L’article expose les résultats performants que le test a démontrés tout au long de ses sept années d’expérimentations cliniques sur des milliers d’échantillons provenant de patients de l’UCSF et de nombreux autres hôpitaux américains.
Il s’agit d’un test métagénomique par séquençage de nouvelle génération (ou mNGS pour « metagenomic next-generation sequencing »). Selon les chercheurs, ce test permet de diagnostiquer indifféremment toutes les infections du SNC, tous types d’agents pathogènes compris (virus, bactéries, champignons, parasites).
Panorama des tests actuels de diagnostic des maladies infectieuses
Ces méthodes traditionnelles restent largement employées malgré leurs limites:
– Le test de culture microbiologique qui consiste à cultiver les microorganismes à partir d’échantillons, mais peut prendre plusieurs jours à plusieurs semaines, et n’inclut pas les pathogènes difficiles à cultiver comme les virus.
– Le test de microscopie qui consiste à observer directement les agents pathogènes dans les échantillons grâce à des colorations spécifiques, mais est peu sensible à de nombreux pathogènes et dépend de l’expertise du technicien.
– Le test immunologique, sérologique ou antigénique qui consiste à détecter les anticorps ou antigènes spécifiques à l’infection, mais est moins sensible pour certaines infections et dépend du moment de l’infection.
D’autres méthodes, basées notamment sur les technologies moléculaires comme les tests PCR (Polymerase Chain Reaction) ou le séquençage de nouvelle génération (NGS, qui fait l’objet du présent article) sont actuellement développées mais présentent des limites principalement liées au coût et à l’expertise technologique.
Des méthodes alternatives, comme les tests de diagnostics rapides ou les biosenseurs connectés aux smartphones, émergent également pour répondre aux besoins des environnements à faibles ressources, malgré leur relatif manque de précision.
Un espoir pour les infections cérébrales graves et difficiles à diagnostiquer
Les chercheurs Charles Chiu, Joe DeRisi, Michael Wilson et Steve Miller de l’UCSF avaient commencé à développer le test mNGS dès le début des années 2010, dans le but d’analyser le liquide céphalo-rachidien à la recherche d’infections du SNC graves et difficiles à diagnostiquer. Le test a par la suite été réalisé sur des milliers de patients présentant des symptômes neurologiques sérieux et inexpliqués dans divers hôpitaux américains, dont celui de l’université de Californie.
Ainsi, entre juin 2016 et avril 2023, 4828 échantillons de LCR ont été soumis au test mNGS qui a montré un taux de sensibilité de 86%, et qui a permis de révéler que 14,4% des échantillons présentaient une infection du SNC, en identifiant avec précision l’agent pathogène, qu’il soit virus (71,9%), bactérie (16,6%), champignon (8,5%) ou parasite (2,9%).
Dès ses débuts, le test mNGS avait déjà marqué les esprits aux Etats-Unis, en faisant les premiers titres en 2014 suite au diagnostic en moins de 48 heures de la mystérieuse infection d’un jeune garçon du Wisconsin, gravement malade et admis aux soins intensifs depuis des semaines, sans que les médecins puissent aboutir à un diagnostic. Il a ainsi été sauvé in extremis en découvrant qu’il était atteint d’une forme grave de la leptospirose, une maladie inflammatoire d’origine bactérienne pouvant atteindre le cerveau et provoquer une encéphalite dans ses formes les plus graves. Les médecins avaient ainsi pu sauver le jeune garçon en lui administrant en urgence un traitement à base de pénicilline.
Un test métagénomique qui ratisse large
Pour aboutir à des résultats aussi performants, le test mNGS utilise une technique de séquençage génomique qui, au lieu de chercher un seul pathogène à la fois, permet d’analyser tous les acides nucléiques, ARN et ADN, présents dans un échantillon. Ainsi, après le prélèvement et la préparation de l’échantillon, l’ensemble du matériel génétique qui s’y trouve (qu’il soit humain ou microbien) est extrait. Le séquençage de nouvelle génération (NGS) permet alors de lire toutes les séquences génétiques présentes. Ensuite, des algorithmes bio-informatiques permettent de séparer les séquences humaines des autres et comparent ces dernières à des bases de données de millions de séquences d’agents pathogènes connus.
Cette technique de séquençage permet ainsi de diagnostiquer rapidement et précisément des infections complexes sans hypothèse préalable, mais aussi de détecter des pathogènes rares ou émergents. Son utilisation semble déjà de plus en plus pertinente, en particulier pour les infections du système nerveux central, mais aussi les infections pulmonaires à plus grand risque épidémique. Cela d’autant plus que les échantillons à analyser pour ces infections, n’étant pas des tissus (LCR et liquide pulmonaire), sont connus pour être difficiles à exploiter en raison du nombre limité de cellules et donc de matériel génétique qu’ils contiennent.
« Les travaux du professeur Chiu et ses collègues sont intéressants à bien des égards et serviront certainement de référence pour la mise en application et l’optimisation des performances des tests par séquençage de nouvelle génération (NGS) à travers le monde, explique Nolwenn Dheilly, directrice de recherche responsable du laboratoire de découverte de pathogènes à l’Institut Pasteur. En effet, ces chercheurs ont développé une méthodologie optimisée qui s’avère très efficace, en particulier sur des échantillons difficiles à exploiter. Ils ont validé leur méthodologie via une analyse étendue sur des milliers d’échantillons issus de divers hôpitaux à travers tout le territoire des Etats-Unis, ce qui confirme l’intérêt de la métagénomique clinique dans le domaine de la santé publique. Et ils ont pris le soin de valider les tests développés par comparaison à des tests de référence. »
Une technologie déjà en développement en France
L’approche métagénomique clinique basée sur le séquençage de nouvelle génération (NGS) est développée dans plusieurs laboratoires de recherche à travers le monde, dont le laboratoire de découverte de pathogènes de l’Institut Pasteur, dirigé par Nolwenn Dheilly, et qui s’appuie sur cette technologie notamment pour détecter, découvrir et caractériser de nouveaux pathogènes.
« La métagénomique clinique est une révolution en soi ! Une révolution déjà en marche puisqu’elle est déjà développée dans plusieurs laboratoires dans le monde. Mais son principe de développement reste le même. Les variations sont dans les détails méthodologiques, notamment de préparation des échantillons et des librairies et de développement d’algorithmes d’analyse bio-informatiques », précise Nolwenn Dheilly. « Notre laboratoire a déjà développé un test métagénomique similaire au test mNGS de l’UCSF. Nous utilisons même cette approche en routine depuis 2019 pour diagnostiquer les maladies infectieuses dans le cadre d’une convention avec l’hôpital Necker-Enfants Malades à Paris. Notre ambition est que d’autres hôpitaux puissent en bénéficier dans un avenir proche. Nos travaux ont d’ailleurs conduit à des conclusions similaires à celles des chercheurs américains. Et les résultats de performance de la métagénomique clinique en France ont déjà été publiés le 1er décembre 2023 dans la revue The Lancet. »
Après les infections cérébrales, le mNGS à la conquête des infections respiratoires
Face à son succès du côté des infections du SNC, les scientifiques de l’université de Californie ont rapidement cherché à adapter, optimiser et automatiser le mNGS, afin de diagnostiquer dans le liquide respiratoire toutes les infections respiratoires, aussi bien connues que nouvelles ou émergentes, sur des temps plus courts, comme ils l’expliquent dans une publication parue dans la revue Nature Communications le 12 novembre 2024. Ainsi, ce même test qui nécessitait 2 à 7 jours pour analyser le LCR, a été optimisé à moins de deux heures d’opérations manuelles et à quelques heures d’opérations automatisées via les algorithmes pour analyser le liquide respiratoire.
Dans des conditions de laboratoire, le test mNGS a permis de détecter dans un délai de 14 à 24 heures de nombreux agents pathogènes connus liés à des infections respiratoires, comme le Covid (provoqué par le virus SARS-CoV-2), la grippe A (amenée par le virus H1N1) ou les diverses infections respiratoires infantiles (déclenchées par le VRS ou Virus Respiratoire Syncytial), avec une sensibilité de 93,6% et une précision de 93,7% par rapport au test RT-PCR. Ce test a aussi permis de détecter des agents pathogènes viraux rares et inhabituels associés à des infections respiratoires sévères telles que le rhinovirus C, associé à une infection pulmonaire et sanguine invasive chez les patients immunodéprimés.
Les chercheurs continuent leurs travaux sur la version pulmonaire du test mNGS afin d’en valider la performance à grande échelle, et espèrent que sa généralisation contribuera à améliorer la capacité à détecter de nouveaux pathogènes et à être mieux parés face aux futures menaces pandémiques.
« L’intérêt de cette approche c’est qu’elle permet de découvrir des pathogènes émergents, et ce en particulier dans le cas d’infections respiratoires. En effet, quand de nouveaux pathogènes sont détectés dans des échantillons respiratoires, le risque de transmission, et donc de pandémie, est plus élevé au vu de leur mode de transmission. De ce fait, c’est important qu’ils soient rapidement détectés et investigués », explique la responsable du laboratoire de découverte de pathogènes à l’Institut Pasteur.
Une révolution qui a un coût
Cette technologie, dans ses deux versions cérébrale et respiratoire, a reçu en 2023 la désignation de « dispositif révolutionnaire » par l’agence américaine du médicament, la FDA (Food and Drug Administration). D’ailleurs, en juin 2023, le groupe de chercheurs à l’origine de son développement ont contribué à créer la compagnie Delve Bio en partenariat avec l’UCSF dans le but de continuer à développer les tests mNGS et d’en élargir l’accès au-delà du périmètre de la recherche universitaire.
Aujourd’hui, les chercheurs se projettent déjà et avancent sur la base des résultats de leur étude, quatre indications cliniques pour le test mNGS: la détection d’organismes non cultivables et difficiles à diagnostiquer, le diagnostic général des infections virales, l’identification d’infections rares et inattendues, ainsi que l’aide aux enquêtes de santé publique sur les épidémies.
Les scientifiques reconnaissent que le coût du test mNGS, estimé à 3 000 dollars par échantillon en 2024, reste aujourd’hui plus élevé que les tests conventionnels, et présente un obstacle de taille limitant son accessibilité. Toutefois, ils précisent que son utilisation reste pertinente pour des patients hospitalisés, présentant notamment des symptômes d’infections du SNC graves et difficiles à diagnostiquer, et subissant en moyenne 20 tests conventionnels. Car elle réduirait le temps de diagnostic, le nombre de tests (y compris invasifs) à pratiquer, le délai avant traitement ciblé, la durée de l’hospitalisation, et ainsi les coûts globaux de prise en charge. Par ailleurs, les chercheurs indiquent que ce coût pourrait être réduit via l’automatisation (gain en temps et en ressources) et l’économie d’échelle (réduction des coûts unitaires via la production de grandes quantités).
« Le coût du test mNGS de 3000 dollars par échantillon estimé dans la première publication est certes élevé mais rien de surprenant à cela. En France nous avons des coûts moindres mais qui restent quand même encore élevés. Toutefois, ces dernières années, nous avons constaté une réduction des coûts relatifs au séquençage de nouvelle génération (NGS) et aux analyses bio-informatiques, rendant la métagénomique clinique de plus en plus accessible », relativise la directrice de recherche. « Nous nous attendons donc à une amélioration notable et rapide du rapport coûts-bénéfices de cette technologie au cours des prochaines années et décennies, ce qui ferait peut-être des tests mNGS une méthode de choix proposée en première intention et dont tous les malades pourront bénéficier. »
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press