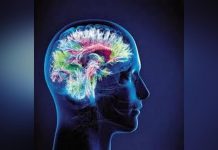Africa-Press – Djibouti. Immersive, documentaire ou audiovisuelle. La direction du musée nationale de la Marine, à Paris, hésite sur le qualificatif à donner à l’exposition qui ouvre ce 22 octobre 2025, « Magellan, un voyage qui changea le monde ». Elle raconte l’expédition du navigateur portugais entre septembre 1519 et octobre 1522, la première de l’histoire à faire le tour du globe, dans un contexte de rivalité entre l’Espagne (au nom de qui Magellan est parti) et le Portugal. Alors que Vasco de Gama, pour le Portugal, avait été le premier à joindre les Indes par l’est en 1498, en contournant le cap de Bonne Espérance, Magellan vise la même destination en mettant le cap à l’ouest par une route encore inconnue.
Un parcours atypique
Le parcours, il est vrai atypique, n’est pas vraiment une exposition. Il s’agit plutôt d’une narration en sons, en images et en scénographies, sans objets ni documents d’archives exposés dans des vitrines. Il prend pour point de départ la série en quatre épisodes L’incroyable périple de Magellan diffusée par Arte et la RTBF en 2022 (et que la chaîne franco-allemande remet à disposition sur son site internet). Son réalisateur François de Riberolles coscénarise l’exposition avec la scénographe Brigitte Poupart de la société de production Camera Lucida.

Le récit est chronologique, découpé en six chapitres, partant du recrutement des équipages des cinq navires à Séville, en Espagne, au retour d’une unique nef avec 18 hommes à bord sur les 237 embarqués à l’origine. « Quand on parle de parcours immersif aujourd’hui, cela convoque toute sorte de langages scénographiques, explique François de Riberolles. L’idée était de raconter une histoire sans se perdre dans un dispositif d’images gratuites et d’emporter le visiteur dans des variations spatiales, pour recréer certains univers propres à cette traversée. »
Projections sur voiles
L’hivernage de l’expédition dans la baie de San Julián, au Brésil, entre mars et octobre 1520, est raconté dans une salle recréant l’ambiance d’une cale de navire. L’interminable et sinueux passage de ce que l’on appellera le détroit de Magellan est matérialisé par d’immenses voiles sur lesquelles sont projetées des images de paysages du bout du monde et entre lesquelles le visiteur slalome lentement.
Les archipels extrême-orientaux (Philippines, Moluques) où un Magellan hors de contrôle, perdu dans une course en avant, finira par trouver la mort en avril 1521 sous les flèches et les lances des indigènes, sont figurés par de petites cellules circulaires de projection. Les films qui y sont diffusés font la part belle aux experts tels, entre autres, les historiens et historiennes Paul Walker (Argentine), Patricia Cerda (Chili), Elide Irene Luco (Argentine), José Manuel Garcia (Portugal), l’auteur spécialiste de Magellan Michel Chandeigne (France), les navigateurs Jean-Yves Bernot (France) et Robin Know Johnston (Royaume-Uni).
Brigitte Poupart est à l’origine de ces partis pris scénographiques. « J’ai eu accès à des images inédites tournées par François de Riberolles et à des dessins grandioses, raconte-t-elle. C’est son idée de parler de l’époque à travers des dessins plutôt qu’une reconstitution historique ou des images d’archives ». Autre parti pris: raconter l’aventure du point de vue d’Antonio Pigafetta, chroniqueur du voyage au jour le jour. Son récit publié à partir de 1524 compte une multitude de précieux détails, allant de la météo aux langages des peuples rencontrés dont il note le vocabulaire. Mais sa parole est aussi commentée par les historiens tant ses remarques reflètent son mépris d’Européen chrétien pour des populations indigènes considérées comme sous-humaines.
Faire main basse sur le monde
Car le leg de cette première navigation de 86 000 kilomètres autour du monde est ambigu. Magellan lui-même, mort à mi-parcours avant d’atteindre les Moluques, ne l’a pas accomplie, tout en restant considéré comme le héros de cette aventure. Alors que son esclave malais, Henrique, serait un meilleur candidat selon les historiens.
Le voyage a fait la preuve qu’une circumnavigation du globe était possible, ouvrant des routes, découvrant des passages (notamment entre l’Atlantique et ce que Magellan lui-même nomma le Pacifique), complétant les cartes et les limites des continents. La Terre s’est révélée couverte en majorité d’eau, des mers toutes connectées entre elles constituant en fait un unique océan.
Mais l’aventure a renforcé cette conviction des puissances européennes qu’elles pouvaient faire main basse sur toute partie du monde, même les plus reculées. Cette circumnavigation, on l’oublie parfois, est intimement liée à des ambitions hégémoniques: Espagne et Portugal s’étant partagés le monde en deux hémisphères au traité de Tordesillas de 1494, Magellan espérait établir que les Moluques et leurs îles aux précieuses épices étaient situées dans la sphère d’influence de la couronne d’Espagne. De ce point de vue, l’expédition a été en réalité un échec.
Objet de lectures multiples et contrastées, l’histoire du tour du monde de Magellan, s’avère, au fond, celle de la manière dont divers pays, l’Espagne, le Portugal, le Chili mais aussi les Philippines et la Malaisie, se la sont appropriée.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Djibouti, suivez Africa-Press