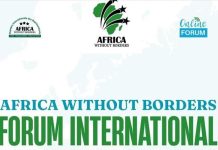Africa-Press – Guinée. Philippe Fossati est spécialiste de la dépression et des perturbations associées (cognitives, émotionnelles ou cérébrales), sur lesquelles il mène des recherches depuis plus de vingt ans à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à l’institut du Cerveau, à Paris. Il est chef du département de psychiatrie adulte à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Une “activation comportementale”
Sciences et Avenir: Depuis avril 2022, la Sécurité sociale rembourse la consultation d’un psychologue, à raison de huit séances par an. Pourquoi cette mesure ?
Philippe Fossati: Parce que les psychothérapies font vraiment partie des traitements de base contre les maladies mentales. La Haute Autorité de santé (HAS) recommande ainsi d’y recourir en première intention pour les dépressions légères, ainsi que pour celles d’intensité modérée (si besoin en complétant par un antidépresseur dans ce dernier cas).
Quand les symptômes sont plus sévères, en revanche, mieux vaut commencer par les médicaments, notamment parce que les patients sont souvent cloués au lit, sans aucune motivation pour rien, avec des problèmes de concentration ou de mémoire. Les antidépresseurs leur donnent alors une première impulsion, mais très vite, on recommande de compléter par une psychothérapie.
Une précision importante toutefois: je parle ici des thérapies qui ont fait la preuve de leur efficacité contre la dépression, pas des thérapies de bien-être. Leur prescription se fait en articulation avec le médecin, qu’il soit généraliste ou psychiatre.
Quelles sont ces thérapies qui ont fait la preuve de leur efficacité ?
Il y en a de multiples sortes, mais les mieux évaluées scientifiquement sont ce qu’on appelle les thérapies cognitivo-comportementales (TCC). De nombreuses méta-analyses montrent qu’elles sont bénéfiques à tous les stades du traitement contre la dépression, de la neutralisation initiale des symptômes à la prévention des rechutes et des récidives dans les mois et années qui suivent.
Comment fonctionnent ces thérapies cognitivo-comportementales ?
Elles comportent plusieurs volets. D’une part, une “activation comportementale”: il s’agit de remettre en mouvement des patients souvent apathiques, en commençant par des actions toutes simples – par exemple laver une ou deux assiettes quand le bac à vaisselle déborde depuis trois jours. Ensuite, on cherche à modifier les schémas de pensée qui entretiennent une vision négative de soi et du monde: c’est le volet cognitif.
Supposez par exemple que vous ayez rendez-vous avec un ami et qu’il ne vienne pas. Si vous allez bien, vous aurez tendance à penser qu’il a eu un empêchement, par exemple qu’il a été retenu par son travail, et qu’il n’a pas pu vous prévenir parce que son téléphone n’avait plus de batterie. Mais un patient dépressif va se dire: “C’est parce qu’il ne me trouve pas très intéressant. ” Puis il cédera souvent à un biais de surgénéralisation: “D’ailleurs personne ne s’intéresse à moi. ” Avec naturellement un impact négatif sur ses émotions, qui instaure un cercle vicieux, puisque plus on se sent mal, plus on cède à ce type de pensée.
La psychothérapie vise alors à retrouver une compréhension plus réaliste de ce qu’on vit et de ce qu’on est. Voilà pour les principes de base des TCC. Mais plusieurs variantes se sont développées au fil du temps. Certaines TCC dites de troisième génération proposent par exemple la méditation de pleine conscience, qui s’est révélée très efficace dans la prévention des rechutes dépressives: cette pratique aide notamment à prendre conscience de ses ruminations négatives, et ainsi à moins se laisser entraîner dans leur cercle infernal.
“Il ne faut pas tomber dans un dualisme selon lequel les psychothérapies agiraient sur l’esprit et les médicaments sur le cerveau”
Ces psychothérapies agissent-elles aussi sur le cerveau ?
Bien sûr ! Il ne faut pas tomber dans une forme de dualisme, selon lequel les psychothérapies agiraient sur l’esprit et les médicaments sur le cerveau. Le chercheur japonais Shinpei Yoshimura et ses collègues se sont par exemple intéressés au cortex préfrontal médian, une zone associée à la réflexion sur soi qui est hyperactive chez les patients dépressifs: ceux-ci réagissent en effet au moindre signal négatif par un torrent de ruminations très égocentrées (“c’est moi le problème”), comme on l’a vu avec l’exemple du rendez-vous manqué. Or le cortex préfrontal médian devient moins réactif après trois mois de TCC, signe que les patients parviennent mieux à brider ces ruminations toxiques.
Plus généralement, les psychothérapies agissent sur les réseaux corticaux (à la surface du cerveau), impliqués dans les croyances dysfonctionnelles et la régulation des états affectifs, et sur les réseaux limbiques (plus en profondeur), sièges des émotions. Dans tous ces réseaux, elles normalisent des modèles d’activité cérébrale qui sont perturbés dans la dépression.
Il y a donc une forme d’activité cérébrale typique de la dépression ?
Oui et non. Il existe certaines tendances, mais cette maladie est très hétérogène – entraînant par exemple tantôt des pertes d’appétit et de sommeil, tantôt non – et se traduit par des perturbations cérébrales variées. Cette variabilité peut d’ailleurs nous renseigner sur le type de traitement qui sera efficace.
Helen Mayberg, de l’Université Emory, aux États-Unis, a montré que lorsqu’une zone appelée insula (appartenant au réseau cérébral des émotions) est moins active que la moyenne, les patients répondent mieux à la psychothérapie qu’aux antidépresseurs – et inversement quand l’insula est hyperactive. Il semble donc que, selon l’état dans lequel il se trouve, le cerveau soit parfois capable d’intégrer les conseils et les informations fournis par le thérapeute pour mieux réguler les émotions négatives, et parfois non (sans doute parce que les dysfonctionnements neurochimiques sont alors trop importants). La mesure de l’activité cérébrale serait donc un outil intéressant pour le choix du traitement, même si nous sommes encore loin d’avoir les moyens matériels pour l’utiliser avec chaque patient…
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinée, suivez Africa-Press