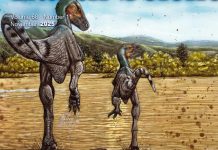Africa-Press – Guinee Equatoriale. L’analyse du “butin” – 30 tonnes de roches de couleur gris vert et noire – n’a pas encore commencé. Il fait l’objet, pour le moment, d’un long et minutieux travail d’inventaire à l’Université A&M du Texas (États-Unis) ainsi qu’au laboratoire Géosciences Montpellier. Lorsque celui-ci sera terminé, en avril 2024, une équipe internationale de chercheurs commencera alors une batterie d’examens visant à percer certains des secrets les mieux gardés de notre planète.
Car ces roches proviennent du manteau de la Terre, couche de 2900 kilomètres d’épaisseur située entre sa croûte superficielle et son noyau en fusion, qui alimente notamment les éruptions volcaniques. Elles ont été recueillies par le navire de forage Joides Resolution au beau milieu de l’Atlantique Nord, entre avril et juin, en creusant un puits de 1267 mètres de profondeur sous 800 mètres d’eau. “Les carottes que nous avons récupérées sont extrêmement précieuses, uniques. C’est la première fois que des échantillons du manteau sont collectés sans discontinuité sur une telle profondeur. Nous attendions cela depuis des décennies “, jubile Marguerite Godard, géochimiste au laboratoire Géosciences Montpellier qui faisait partie de l’expédition.
Les scientifiques ont certes déjà analysé quantité de fragments issus des entrailles de la Terre. Occasionnellement, les volcans arrachent en effet des morceaux de péridotite – la roche majoritaire du manteau supérieur (jusqu’à 670 km de profondeur) composée principalement d’olivine vert-jaune et de pyroxènes vert bouteille -, enclavés dans du magma. Des nodules pouvant mesurer quelques dizaines de centimètres, que les géologues appellent “xénolithes”, émergent ainsi lors de certaines éruptions. On trouve aussi de larges portions du manteau dans les Alpes franco-italiennes, l’Himalaya ou la péninsule Arabique. Dénommées ophiolites, elles résultent de l’affrontement des plaques tectoniques, constituées elles-mêmes de la croûte et de la partie la plus rigide du manteau supérieur.
Cette dernière affleure par conséquent en surface lorsque les plaques se chevauchent dans des massifs montagneux. “Tous ces spécimens ont été cependant altérés au cours de leur histoire, leur voyage depuis l’intérieur de la Terre, subissant diverses modifications chimiques puis l’érosion “, explique Benoît Ildefonse, directeur du laboratoire Géosciences Montpellier. Ils ne sont donc pas pleinement représentatifs des conditions régnant dans le manteau supérieur – en particulier l’abondance d’éléments volatils comme le carbone ou les molécules d’eau séquestrées dans les tréfonds de la Terre.
Découvrir la composition et la structure du manteau
Les géologues rêvent ainsi, depuis des dizaines d’années, de mettre la main sur des échantillons frais du manteau : à la fois de grande qualité et à des niveaux de profondeurs importants, pour savoir ce qu’il recèle exactement et comment il est structuré. “Cette vérité du terrain permettrait de répondre à une foule de questions critiques “, souligne Benoît Ildefonse. S’ils connaissaient les concentrations exactes de carbone dans les roches du manteau, les scientifiques auraient “une vision plus juste de son cycle global à l’échelle de la planète, indique Satish Singh, de l’Institut de physique du globe de Paris. Et ce faisant, une meilleure compréhension du réchauffement climatique actuel dû aux émissions humaines de dioxyde de carbone. ”
Idem pour l’eau mantellique, dont les quantités équivaudraient de deux à dix fois celles des océans. Une estimation plus fine permettrait de mieux modéliser le mouvement des plaques tectoniques pour lequel les roches hydratées servent de lubrifiant, un phénomène qui engendre lui-même des séismes et éruptions volcaniques.
Faute de données, la manière dont le manteau évacue la chaleur interne de la Terre et engendre du magma reste par ailleurs mal comprise. Tout comme la mystérieuse frontière qui sépare la croûte du manteau, dénommée “discontinuité de Mohorovicic” ou plus simplement Moho. Seules des méthodes indirectes comme l’analyse des ondes sismiques ont permis jusqu’à présent de l’appréhender. “Mais on ne connaît ni son rôle ni sa véritable nature : bien délimitée, sur quelques dizaines de mètres seulement, ou beaucoup plus continue sur des kilomètres d’épaisseur “, relève Satish Singh.
Les premières tentatives visant à traverser le Moho et récupérer des échantillons du manteau supérieur remontent au début des années 1960. Elles furent réalisées dans l’océan Pacifique, “les mesures sismiques ayant démontré que la croûte ne faisait que 6 à 7 km d’épaisseur sous les océans contre 35 km en moyenne sur les continents “, détaille Satish Singh. En 1961, un groupe de géologues américains embarqua ainsi à bord du CUSS 1 – l’un des premiers navires de forage développé initialement par l’industrie pétrolière – pour creuser des puits au large de l’île Guadalupe (Mexique) sous 3600 mètres d’eau. Ils expérimentèrent notamment le “positionnement dynamique”, technique permettant de stabiliser très précisément un bateau à la verticale d’un puits grâce à un système de balises et de moteurs auxiliaires.
À la poursuite du Moho
Soixante ans après les premières tentatives, cette quête reste inachevée : percer l’écorce terrestre jusqu’à atteindre le manteau, afin de dévoiler la structure d’une zone frontière dénommée Moho. Les géologues se focalisent depuis une dizaine d’années sur trois sites candidats. Tous dans le Pacifique où une croûte homogène et continue ne s’étend “que” sur 6 km d’épaisseur : au nord d’Hawaii, au large du Costa Rica et dans l’ouest du Mexique. Ils ont été choisis sur plusieurs critères.
“La tranche d’eau ne doit pas être trop profonde, pas plus de 3000 m idéalement, note le sismologue Satish Singh. Et la croûte océanique âgée d’au moins 15 millions d’années, afin que la température au Moho ne dépasse pas 250 °C. ” Elle ne doit pas être trop vieille non plus, pour éviter de trop grandes couches de sédiments. “Des mesures sismiques très pointues devraient permettre d’affiner ce choix “, espère-t-il. Mais il faudra développer aussi de nouvelles technologies pour que les têtes de forage fonctionnent à très haute température. “La gageure principale reste néanmoins la durée des opérations et donc leur coût “, relève le géologue Benoît Ildefonse. Atteindre le Moho pourrait prendre en effet de nombreuses années et coûter près d’un milliard d’euros !
Mais en dépit de “formidables innovations et plusieurs succès opérationnels, les résultats scientifiques sont très loin des espérances de l’époque “, rappelle Benoît Ildefonse. Après cinq ans de travaux et un coût de plus de 50 millions de dollars, le projet MoHole est arrêté, ne dépassant pas 183 mètres de profondeur et recueillant uniquement des sédiments et quelques dizaines de mètres de basaltes. “Le défi technologique apparaissait immense, sans parler du coût financier “, pose le géologue montpelliérain.
À ce jour, le puits le plus profond dans la croûte océanique atteint ainsi 2111 mètres, donc encore très loin du Moho. Il a été foré entre 1979 et 1993 dans le Pacifique oriental par le Joides Resolution, navire surmonté d’un derrick de 60 mètres de haut servant d’abord à la prospection pétrolière avant d’être utilisé pour la recherche océanographique. Pas moins de sept expéditions auront été nécessaires pour rallier cette profondeur sous 3457 mètres d’eau. Lors de la dernière, le train de tige et la tête de forage n’avaient de cesse, l’un de se bloquer, l’autre de se casser.
Cap vers le massif Atlantis, de la taille du mont Blanc
Au printemps dernier, quand le Joides Resolution quitte l’archipel des Açores pour l’expédition 399 du programme IODP (International Ocean Discovery Program), l’objectif ne consiste pas à battre un quelconque record. Il met alors le cap vers le massif Atlantis, montagne sous-marine d’une taille similaire au mont Blanc.
“Ce relief se situe au niveau de la dorsale médio-atlantique, zone où les plaques nord-américaine et eurasiatique s’écartent de quelques centimètres par an en faisant remonter les roches du manteau “, expose Marguerite Godard. Il n’y a ainsi plus besoin d’aller au-delà du Moho pour récupérer les roches du manteau. Par ailleurs, près du sommet, se trouve un réseau de cheminées hydrothermales où des réactions dites de serpentinisation entre les péridotites et l’eau de mer produisent de grandes quantités d’hydrogène. Or, ces dernières constituent une source d’énergie pour une variété de micro-organismes primitifs (bactéries, archées) qui auraient évolué sur Terre il y a plusieurs milliards d’années. “En forant à proximité de ce champ hydrothermal, nous voulions ainsi mieux comprendre les fluides qui y circulent tout comme la biosphère profonde ayant participé peut-être à l’origine du vivant “, rapporte Marguerite Godard.
Mais alors que ce type de forage, au niveau du manteau serpentinisé, n’avait jamais pu dépasser 200 mètres de profondeur, celui-ci progresse de façon inédite et inattendue. Sans rencontrer de difficultés opérationnelles ni d’obstacles majeurs, comme des zones de rupture qui sont l’ennemi du foreur en rendant les puits instables ou en brisant les trépans. “À certains moments, nous récupérions sur le pont jusqu’à 4 mètres de carottes toutes les cinq heures ! Nous n’avions pratiquement plus de tubes pour les stocker à la fin de l’expédition, raconte Marguerite Godard. C’est grâce au savoir-faire inégalé des techniciens du Joides Resolution, mais nous avons sans doute eu aussi énormément de chance. ”
Une sorte de cordon ombilical avec le manteau chaud et profond
Si la couleur noire de certains échantillons indique que les péridotites ont été altérées par l’eau de mer, de longues sections sont en revanche très bien conservées. Elles constituent une sorte de cordon ombilical avec le manteau chaud et profond remonté au niveau de cette dorsale, qui permettra de mieux l’appréhender. Sous l’œil aguerri des experts et avant même des examens plus poussés, ces carottes témoignent par ailleurs d’une panoplie de phénomènes : des zones où le manteau a été déformé, fracturé, a interagi avec le magma ou s’est peu à peu refroidi. “Soit toute la cuisine du manteau supérieur “, s’émerveille Marguerite Godard. Ce n’est pas tout.
Car les indices de teneurs très importantes en hydrogène ont également été observés à des profondeurs inattendues, laissant poindre d’importantes découvertes sur le développement de la vie en milieu extrême. Il s’agit certes d’échantillons du manteau, et non du Moho, dont la structure échappe toujours aux chercheurs. Mais pour la chercheuse, ce trésor marquera “une étape déterminante dans l’amélioration des connaissances en géologie et sur la vie microbienne profonde “, alimentant une foule de travaux pour les deux ou trois prochaines décennies.
Un record de profondeur sans lendemain
12.262 mètres : tel est le record du puits le plus profond au monde, en longueur verticale, foré sur la croûte continentale dans la péninsule de Kola, en Scandinavie. Noté “SG3”, ce forage a été réalisé par l’URSS, qui voulait ajouter cet exploit technologique à son palmarès durant la guerre froide. Commencées en 1970, les opérations ont été suspendues en 1994, faute de financements après la chute du régime soviétique. Les difficultés techniques devenaient en outre insurmontables, à la fois pour remonter les matériaux excavés et en raison des très fortes pressions et températures (180 °C). Les objectifs étaient certes davantage symboliques que scientifiques, la croûte étant très épaisse (une cinquantaine de kilomètres) et géologiquement peu active dans cette région.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinee Equatoriale, suivez Africa-Press