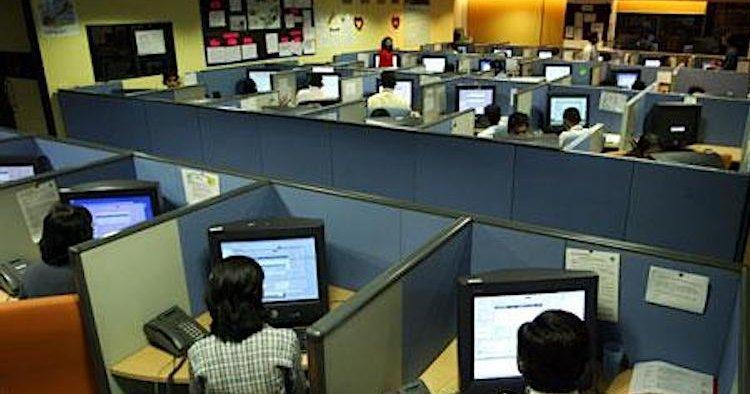Ikala Paingotra
Africa-Press – Madagascar. Hier, à l’occasion de la fête du travail, les syndicats ont réclamé une hausse de 30% du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG). Une occasion de revenir sur la récente polémique sur la pauvreté à Madagascar. Nous tenterons une réflexion objective, afin d’éviter les élucubrations fumeuses qui parlent de caviar, de fromage, de clients de grandes surfaces et d’embouteillages.
Les récentes réponses brouillonnes d’Andry Rajoelina sur TV5 Monde concernant la pauvreté à Madagascar ont légitimement généré de nombreuses critiques. On ne sait pas si c’est son cabinet qui est incapable de lui fournir des talking points rigoureux sur les sujets importants, ou bien si c’est lui qui est incapable de les retenir. Quel que soit le cas de figure, le flou du fond et la maladresse de la forme ont perturbé la transmission de son message qui avait pourtant un point intéressant: appliquer la même unité de mesure de la pauvreté à des contextes différents est une méthodologie qui prête à discussion.
Trop de taux pour un seul sujet.
Rappelons tout d’abord qu’il existe plusieurs manières de mesurer la pauvreté. La première est le seuil national, fixé pour Madagascar à environ MGA 4 000 par personne et par jour (source: Banque mondiale). Ce taux était de 75,2% en 2022. La deuxième est le seuil international, fixé à $2,15 dollars par jour afin de permettre les comparaisons entre pays. Ce taux était de 70% pour 2022. Toujours à Madagascar, le taux de pauvreté rurale était quant à lui de 79,9%, tandis que le taux de pauvreté urbaine était de 55,5% toujours pour la même année. Les quatre chiffres proviennent du même document de la Banque mondiale, publié en février 2025.
Dans un effort pour évaluer la pauvreté en dépassant le seul cadre monétaire, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a développé le Multidimensional Poverty Index qui se base également sur le seuil internationale de moins de US$2.15 par jour. D’après cet autre indicateur, le taux de pauvreté multidimensionnelle à Madagascar était de 68,4% en 2021.
Dans les paragraphes précédents, on constate la profusion des taux de pauvreté, ce qui nécessite à chaque fois d’être précis quand on les manipule. Faute d’attention, on peut très rapidement s’empêtrer dans les chiffres. Mais on peut aussi être tenté de verser dans la propagande. Vers la fin de son mandat, le Président Rajaonarimampianina avait affirmé qu’il avait réussi à faire baisser le taux de pauvreté de 92% à 80%. Or, le premier chiffre était le taux d’après le seuil international à $2 calculé par la Banque mondiale à la fin de la Transition 2009- 2013. Le second chiffre était quant à lui le taux selon le seuil national. On ne sait si c’est l’incompétence ou la malhonnêteté intellectuelle de ses conseillers économiques qui étaient à l’origine de de cette bourde. Quelle que soit la raison, le manque de rigueur dans l’utilisation des taux de pauvreté amène à des comparaisons inappropriées, comme comparer des zébus et des chaises, sous prétexte qu’ils ont quatre pattes.
Considérons le montant de $2.15 qu’utilisent depuis 2022 la Banque mondiale et le PNUD pour les seuils internationaux. À Madagascar, cela représente à peu près MGA 9.700 MGA, soit environ MGA 291.000 par mois. Selon ces normes internationales de mesure de la pauvreté, est donc considéré comme pauvre celui qui vit en-dessous de cette somme. Or, celle-ci dépasse le SMIG à Madagascar, qui est de MGA 262.680 dans le secteur non agricole et de 266.500 dans le secteur agricole. Autrement dit, le SMIG malgache ne protège pas de la pauvreté.
Argument bien fondé, mais (très) mal exprimé
Pour en revenir à l’argument d’Andry Rajoelina quant à la nécessité de prendre en compte le contexte local, il était pertinent dans l’esprit mais maladroit dans le fond. Rien qu’en termes d’alimentation, ce que permet de faire l’équivalent de $2.15 à Madagascar diffère effectivement de ce que cela pourrait être acheté à Paris, New York, Rabat, Johannesburg ou Dakar.
Mais il était également maladroit dans la forme en donnant l’exemple de paysans « heureux avec 100 euros » (environ MGA 513.000). On serait donc très intéressé que le chef de l’État détaille comment peut-on vivre heureux avec cette somme à Madagascar dans les conditions actuelles, même en milieu rural. Quelle quantité de zébu et de riz cela permet-il d’acheter ? La quantité obtenue permet-elle d’avoir les 2100 calories requises par jour pour être en bonne santé ? Cela permet-il d’accéder à des soins de qualité, ou bien les femmes du milieu rural sont heureuses de faire une demie-journée de charrette à zébus pour aller accoucher ? Les femmes de l’Androy sont-elles heureuses de marcher 4 heures pour aller au point d’eau le plus proche ? Rappelons que le taux de pauvreté rurale selon le seuil international de $2,15 était de 80%.
Mais au-delà, cette phrase reflète un certain mépris pour les plus faibles. en effet, il y aurait donc selon Andry Rajoelina des standards de développement qui ne sont pas universels. Par exemple, l’accès à l’électricité n’est pas nécessaire pour être heureux en milieu rural. Andry Rajoelina a donc une fois encore montré qu’il ne maîtrise ni les concepts, ni les indicateurs de développement, ni l’empathie envers les vulnérables, ni même la rhétorique. Certes, son parcours de publicitaire et d’organisateur d’évènement l’a rendu à l’aise dans le superficiel et les discours pour bénéficiaires de koveta et apparentés. Mais dès qu’il s’agit de dérouler des sujets nécessitant un peu de compétence, de réflexion et de structuration argumentative, il montre ses limites. Surtout quand il doit se confronter à des journalistes en-dehors de son fan-club qui pose des questions dont la plupart ont été soufflées, et qui s’abstiennent toujours d’aborder les sujets qui fâchent. C’est pour cela que dès qu’il fait face à la presse internationale, le délestage de la Jirama passe sur son raisonnement.
Source: Madagascar-Tribune.com
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Madagascar, suivez Africa-Press