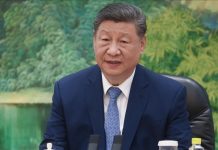Africa-Press – Madagascar. Dans la ville de Tamatave, nouvel épicentre de la pandémie de Covid-19 à Madagascar, les autorités appliquent une stratégie sanitaire très ferme. Reportage.
Ils tentent de tuer le temps sous la surveillance de miradors vides, construits récemment aux coins de la cour. Ces patients malgaches n’attendent qu’une chose : que leur test de dépistage revienne négatif au Covid-19 ; le seul visa pour pouvoir sortir du centre culturel Canada, à Tamatave (ou Toamasina).
Dans cette ville côtière, les autorités malgaches ont réquisitionné trois bâtiments, représentant environ 200 places, pour isoler de force les individus positifs au coronavirus, bien qu’asymptomatiques. Ils sont là pour deux ou trois semaines, sans indemnité, mais nourris et logés sur des lits de camp. Les autorités cherchent ainsi à casser les chaînes de contamination. Et c’est la police qui se charge de retrouver les récalcitrants au confinement. Le 15 juin, ils étaient 183 à être recherchés.
« Les structures répondent aux normes sanitaires et aux droits humains, affirme Thierry Rajaona Lauret, procureur de la République à Tamatave et membre du comité stratégique du Centre régional de commandement opérationnel Covid-19. Certes, c’est une privation de liberté, mais on lutte contre une maladie contagieuse. Nous sommes dans notre bon droit. » Le président Andry Rajoelina lui-même avait insisté sur la « fermeté » et « la rigueur » nécessaires aux mesures de riposte sanitaire lors d’un déplacement à Tamatave, le 26 mai.
Plus grand port industriel du pays, la ville alimente Madagascar notamment en hydrocarbures et en riz. Mais elle concentre aussi 63 % des cas de la Grande île au 15 juin : 811 cas (586 en traitement, dont 31 en prison, et 216 guéris) sur un total de 1 290 dans tout le pays, selon les chiffres officiels. Et sur les 13 morts officiels, Tamatave en déplore 9.
La progression de la pandémie est ressentie par les médecins de quartier, comme Amélie Andrianavony : « Depuis fin avril, j’ai deux fois plus de patients et environ la moitié souffrent d’un état grippal, avec souvent des pertes de goût et d’odorat », observe-t-elle. Dans l’ensemble du pays, l’épidémie s’accélère : les trois quarts des cas dépistés par les autorités l’ont été depuis la mi-mai.
Une trajectoire qui suit celle du reste de l’Afrique, qui a passé la barre symbolique des 200 000 cas au début du mois de juin. « La situation reste maîtrisée à Madagascar », a néanmoins affirmé Andry Rajoelina, le 14 juin, à la télévision.
Le président a de nouveau défendu le Covid-Organics, son remède traditionnel à l’artemisia, « préventif et curatif ». Les hôpitaux l’administrent aujourd’hui en parallèle du protocole à base de chloroquine. Mais il n’est plus distribué massivement dans la rue, comme avant. Les gendarmes dispersent les résidents du quartier d’Androranga, où a éclaté une émeute, le 3 juin 2020, à Tamatave. © Rijasolo/ AFP
Dans les rues de Tamatave, à l’instar des centres d’isolement, c’est la fermeté qui domine. Les autorités appliquent un confinement strict à partir de 15 h (contre 13 h jusqu’au 14 juin). À l’heure dite, les rues se vident. Des militaires, envoyés de la capitale, se postent à tous les carrefours importants, en armes, avec parfois des blindés. Et des policiers quadrillent les rues, matraque en main. Selon plusieurs témoignages recueillis par Jeune Afrique, certains contrevenants auraient d’ailleurs reçu des coups.
Mercredi 3 juin, dans le quartier d’Androranga, une émeute a même éclaté après le passage à tabac d’un jeune par des forces de sécurité. Il s’en est finalement sorti indemne. Et la ville a retrouvé son calme. Pour cette fois.
Affamés et appauvris par la crise économique et sociale, certains bravent en effet les règles et tentent de continuer à travailler. La suspension des activités de la mine locale de cobalt et de nickel d’Ambatovy a par exemple fragilisé 9 000 employés et leurs familles. Et la reprise sur ce site, qui représente un quart des exportations malgaches, ne devrait pas intervenir avant 2021.
Ce confinement forcé et ses conséquences inquiètent Monseigneur Désiré Tsarahazana, cardinal de Madagascar et archevêque de Tamatave. Il est l’une des principales figures religieuses de la Grande Île et recueillent de nombreuses doléances. « Les gens ne peuvent plus travailler. Ils vont peut-être mourir de faim si on ne les aide pas assez… Alors, quel est le moindre mal ? », interroge-t-il. Pour lui, la confiance dans la parole politique, celle des dirigeants comme celle des opposants, s’est érodée. « Les médecins devraient être plus impliqués dans la gestion de crise », estime-t-il.
Manque de matériel « Depuis quand a-t-on vu un virus avec une horloge sur lui ? », ironise, à propos des heures de confinement, le député local, Roland Ratsiraka, seule voix politique à s’opposer frontalement à Rajoelina. « On a été défaillants sur tout, sur la communication, sur les fonds, sur le matériel… », martèle-t-il.
« Au départ, l’approvisionnement était difficile, reconnaît Thierry Rajaona Lauret. Mais à présent, le président nous a donné assez de moyens en carburant, en médicaments, en voitures… »
Des médecins, sous couvert d’anonymat, racontent néanmoins qu’ils manquent toujours de masques et de blouses. D’aucuns s’interrogent d’ailleurs sur le cheminement des plus de 444 millions de dollars de promesses de dons et de prêts issus des institutions étrangères (FMI, Banque mondiale…).
Autre difficulté : le délai d’obtention des résultats de tests PCR, qui peut atteindre une ou deux semaines et ralentit les sorties des patients des centres et des hôpitaux.
Dans la population, l’incrédulité côtoie l’énervement. « Ils font venir des blindés pour combattre un virus alors qu’il n’y a pas assez de matériel dans les hôpitaux », remarque un étudiant. « Rajoelina crie sur tous les toits qu’il a le remède et, en même temps, il envoie l’armée », renchérit un membre de la société civile locale.