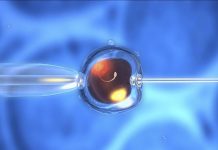Africa-Press – Madagascar. Perrine Ruby est chercheuse Inserm au Centre de recherche en neurosciences de Lyon.
Sciences et Avenir: Les rêves ont toujours intrigué, mais est-ce que la communauté scientifique s’intéresse de près à ce sujet ?
Perrine Ruby: Les rêves intriguent depuis toujours mais il est vrai que la recherche académique est longtemps restée marginale. Des études expérimentales ont été menées au cours du 19e siècle, mais il s’agissait d’initiatives individuelles. Sigmund Freud en a fait un sujet d’études mais la psychanalyse et la recherche expérimentale sont deux mondes qui ne se parlent pas…
La découverte du sommeil paradoxal en 1959 a marqué un tournant. Des Américains ont alors fait une association entre cette phase et les rêves, et ce alors qu’aucune donnée ne le prouve. Le rêve se place en fait dans toutes les phases de sommeil. Pendant près de quatre-vingts ans, la recherche a donc été biaisée. Et nous n’en avons pas beaucoup appris sur les corrélats physiologiques des rêves. À partir des années 1990, la recherche a pris une nouvelle direction avec la démocratisation des outils de neuro-imagerie.
Les neurosciences nous ont-elles permis de savoir ce qui se passe dans le cerveau quand on rêve ?
C’est la question que tout le monde se pose mais c’est, à mon avis, loin d’être la plus pertinente. Prouver qu’on active le cortex visuel quand il y a des images dans le rêve revient à enfoncer des portes ouvertes. En outre, les neurosciences sont mises en échec car si on estime que nous rêvons uniquement pendant le sommeil paradoxal, il est alors possible d’enregistrer ce qui passe dans le cerveau ; il existe en effet des marqueurs physiologiques de cette phase. Mais, ce n’est pas pertinent puisque nous ne rêvons pas seulement pendant cette phase. Nous ne savons donc pas quand déclencher le scanner.
“Entre le rêve lui-même, son souvenir au réveil et le récit que nous en faisons, il y a des trous et des déformations”
Que nous apprennent les récits de rêve ?
Il faut d’abord préciser qu’entre le rêve lui-même, son souvenir au réveil et le récit que nous en faisons, il y a des trous et des déformations. Nous sommes donc extrêmement loin de notre objet de recherche. Malgré tout, à partir de ces récits, on peut déjà essayer de répondre à bon nombre de questions. Et notamment comparer les expériences vécues la journée et celles pendant la nuit.
En la matière, il a été bien démontré que notre vie éveillée a un gros impact sur le contenu de nos rêves. Et ce que l’on a observé, c’est que plus vous vivez des moments intenses émotionnellement dans la journée – positifs ou négatifs -, plus vous avez de chances d’en rêver.
La science nous permet-elle d’identifier la fonction des rêves ?
Si les humains d’aujourd’hui rêvent, c’est que le rêve a une dimension adaptative. Quand on constate que les rêves sont très émotionnels, qu’ils rejouent des événements intenses de la vie éveillée, nous sommes plusieurs à penser que le sommeil et le rêve jouent un rôle de régulation émotionnelle. Une fonction capitale pour la survie.
Dans notre laboratoire, nous avons mené une expérience qui valide cette hypothèse. Nous avons demandé à des personnes de nous raconter leurs rêves pendant une semaine, de lister les événements réels qui y étaient incorporés et de noter l’intensité émotionnelle des versions éveillée et rêvée. Or cette dernière avait toujours une intensité diminuée par rapport à la version vécue.
Votre enquête pendant le confinement a-t-elle confirmé que les rêves ont une fonction de régulation émotionnelle ?
Ce travail a été passionnant. La pertinence des métaphores saute à la figure, avec beaucoup de références à la maladie, la mort, l’enfermement. Mais aussi beaucoup de récits mentionnaient des fêtes, des embrassades, des sorties entre amis. Ces désirs relationnels, les personnes les réalisaient en rêve. Cette enquête nous a également permis de formuler trois hypothèses concernant le mécanisme de régulation émotionnelle.
Premièrement, vivre l’émotion en rêve permet de l’évacuer. C’est un phénomène cathartique. Le deuxième mécanisme, qui serait dominant, se nomme la transformation. Le rêve attrape un souvenir de la vie éveillée et met en scène l’émotion à l’aide d’une métaphore. Le contour symbolique essentiel se détache. Ainsi, nous prenons de la distance par rapport à l’émotion. Enfin, dernier mécanisme: la compensation. Le cerveau créerait du positif dans des situations d’expériences négatives aiguës pour contrebalancer. D’ailleurs, pendant le confinement, 7 % des personnes faisaient plus de rêves positifs que d’habitude.
“Le rêve est un théâtre émotionnel qui constitue un merveilleux outil de connaissance de soi”
Le fait de se souvenir de ses rêves modifie-t-il leur impact ?
Tout d’abord, on a longtemps cru, à tort, que c’était une question de mémoire. En fait, c’est la quantité d’éveils intrasommeil qui est déterminante, parce que pour garder une trace de ses rêves, on doit passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Ce passage s’opère lors des phases d’éveil.
En 2022, nous avons aussi mené une étude qui souligne des différences attentionnelles sur la fréquence des souvenirs. Ceux qui se souviennent souvent de leurs rêves ont tendance à davantage porter leur attention sur des événements inattendus de leur environnement, et donc à se réveiller plus fréquemment à la faveur de stimulations extérieures. Mais, la fonction régulatrice des rêves persiste même si on ne s’en souvient pas. Cependant, il est intéressant de les retravailler, puisqu’ils nous permettent d’identifier nos préoccupations émotionnelles importantes.
Chercher à contrôler ses rêves présente-t-il un intérêt ?
Les rêves ont un rôle fonctionnel, mieux vaut les laisser faire leur travail tranquillement. En outre, cela risque d’altérer le sommeil. Et pour travailler le contenu de ses rêves, l’idéal est de tenir un carnet dans lequel on écrit chaque matin. Progressivement, vous augmentez votre niveau de conscience et vous aurez plus de souvenirs. Ensuite, on peut se questionner sur ce qui paraît étonnant dans le récit. Le rêve est un théâtre émotionnel qui constitue un merveilleux outil de connaissance de soi.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Madagascar, suivez Africa-Press