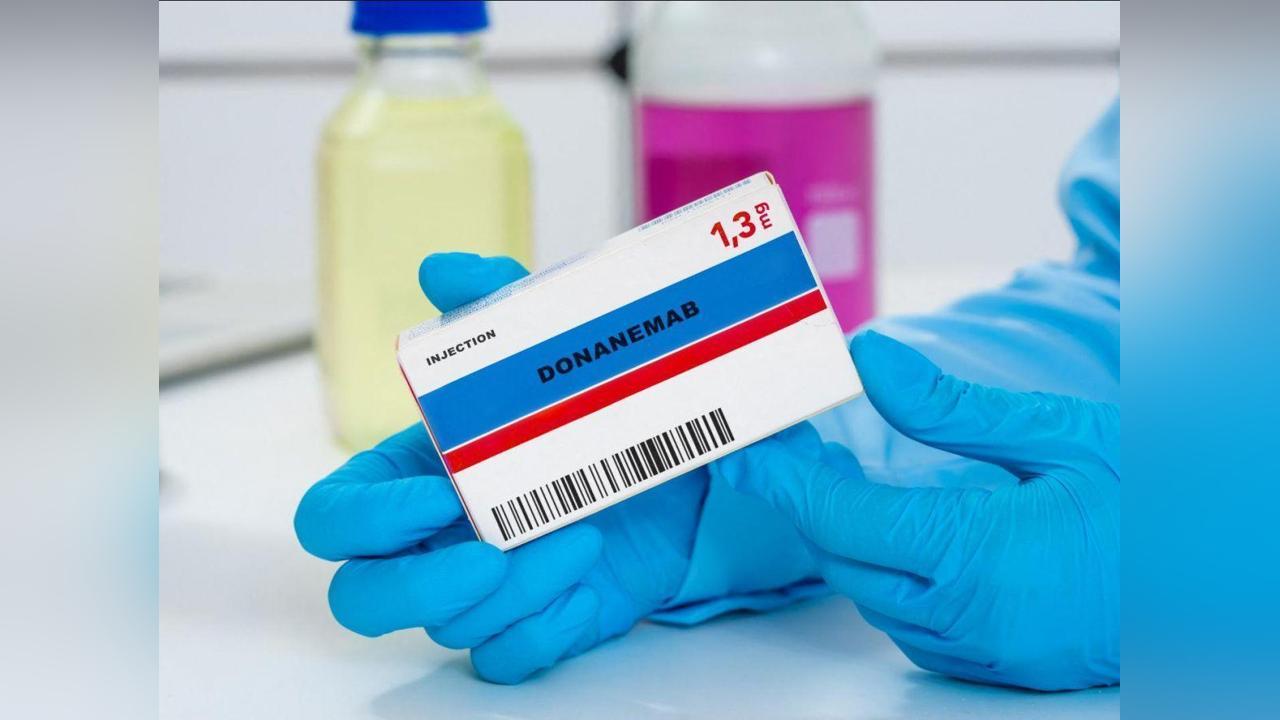Africa-Press – Mali. Reconnaissons-le: en vingt-cinq ans, la maladie d’Alzheimer est la pathologie pour laquelle la recherche médicale a enregistré le plus haut taux d’échec. En 2014, une équipe américaine avait calculé que 99,6 % des quelque 500 essais cliniques menés depuis 2002 s’étaient soldés par un abandon de la molécule testée.
Seule la mémantine (Ebixa) avait émergé en 2003, rejoignant les trois autres molécules faisant office de « traitements symptomatiques »: le donépézil (Aricept), la rivastigmine (Exelon) et la galantamine (Reminyl). En jouant sur les mécanismes de la neurotransmission, ils étaient censés ralentir les symptômes cognitifs de la maladie. Mais aucun ne ciblait les causes de celle-ci. Et depuis, rien. Ou pire, les premiers anticorps – aducanumab, ganténérumab, crénézumab – montrant enfin un effet sur les lésions cérébrales des patients entre 2019 et 2022 – n’offraient pas d’effet significatif contre leur déclin cognitif. Jusqu’à ce qu’apparaisse le lécanémab.
Validé en 2023 aux États-Unis, puis cette année en Europe, il redonne un extraordinaire élan d’espoir. « C’est une grande avancée, se réjouit Remy Genthon, directeur scientifique de la fondation Recherche Alzheimer. Pour la première fois, il existe un traitement qui agit directement sur une cause identifiée de la maladie. C’est ce qu’on appelle un ‘disease modifier’ (modificateur de la maladie, ndlr), il affecte l’évolution de celle-ci. » Dans la foulée, un deuxième anticorps aux résultats similaires, le donanémab du laboratoire Eli Lilly, a été autorisé en 2024 aux États-Unis, puis en juillet dernier par l’Union européenne.
Ces traitements valident enfin l’hypothèse de la cascade amyloïde, selon laquelle la maladie est provoquée par l’accumulation d’une protéine dans le cerveau: la bêta-amyloïde. Celle-ci s’agrège en plaques dans le milieu cérébral, autour des neurones. Ces plaques amyloïdes seraient à l’origine du second biomarqueur clé de la neurodégénérescence dans Alzheimer: le dysfonctionnement d’une autre protéine, tau. Cela se produit cette fois à l’intérieur des axones, dont le cœur se désagrège, perturbant le passage de l’influx nerveux d’un neurone à l’autre.
80 % des plaques amyloïdes nettoyées
Commercialisé sous le nom de Leqembi par le laboratoire japonais Eisai, le lécanémab n’est rien de moins que le premier traitement à ralentir la maladie. Pourtant, il a dû dans un premier temps faire face à un refus de l’Agence européenne du médicament (EMA), en raison, surtout, d’un risque d’effets indésirables potentiellement sérieux: les micro-hémorragies et œdèmes cérébraux, regroupés sous le terme d’Aria. « En nettoyant les plaques amyloïdes proches de vaisseaux sanguins, l’anticorps est susceptible de fragiliser ces derniers, explique Marion Lévy, directrice scientifique de la fondation Vaincre Alzheimer. Mais les cas graves ne surviennent que dans moins de 1% des cas. Le plus souvent, ils sont donc asymptomatiques. »
Pour obtenir un avis favorable de l’EMA, l’indication a – hélas – dû être resserrée en excluant les personnes porteuses du gène APOE-4, plus susceptibles aux Aria. Or ce sont celles qui présentent une prédisposition génétique importante à la maladie (posséder une copie de ce gène multiplie le risque d’Alzheimer par trois, et deux copies par huit à douze…). Autre condition pour l’approbation en Europe: une surveillance étroite des Aria le premier trimestre avec des IRM mensuelles.
Comme le médicament est indiqué à un stade débutant de la maladie, il ne devrait concerner que peu de personnes. Combien? « C’est difficile à évaluer, ce ne sera pas 10 % ni 0,5 %. En discutant avec les académiques et les industriels, cela concernerait 2 à 3 % des patients vus en Centre mémoire de ressources et de recherche « , estime Remy Genthon. Soit moins de 7000 personnes sur les 225.000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France.
Un chiffre qui pourrait néanmoins être amélioré avec un diagnostic plus rapide. « L’espoir apporté par ces anticorps n’est pas tout à fait dissociable d’une accélération du diagnostic, portée notamment par l’autorisation récente aux États-Unis du premier test sanguin de la maladie « , ajoute le neurologue. De fait, plus la maladie est prise à un stade précoce, plus le ralentissement du déclin cognitif serait efficace. « En effet, plus l’Alzheimer évolue dans le temps, plus la physiopathologie se complexifie, avec des facteurs qui s’ajoutent les uns aux autres. Ça devient quelque chose d’un peu inextricable. Alors que si on prend à la racine en ciblant l’amyloïde très tôt, on pourrait en théorie arrêter tout le processus. »
À ce jour, sur la base des essais avec un suivi sur dix-huit mois, le lécanémab peut se targuer de nettoyer jusqu’à 80 % des plaques amyloïdes dans le cerveau. Un effet majeur qui ne se traduit toutefois sur le plan clinique que par un ralentissement modeste du déclin cognitif de 27 %. Concrètement, les patients ont gagné 0,45 point sur les 18 que compte le score CDR, qui évalue l’état cognitif sur plusieurs critères (mémoire, orientation, résolution de problèmes…). « Cela représente quelques mois de gagnés sur l’évolution de la maladie. Pour des patients qui jusqu’ici n’avaient accès à aucun traitement, c’est énorme, insiste Marion Lévy. Et porteur d’espoir, car l’objectif est de pouvoir combiner différentes molécules pour arrêter complètement la maladie. Or, sans cette première autorisation, cela aurait été beaucoup plus compliqué, en Europe en tout cas, de poursuivre des recherches. »
« Bien sûr, on espère toujours mieux, reprend Remy Genthon, mais le suivi des patients au-delà des dix-huit mois laisse à penser qu’à long terme, ce gain sur le déclin cognitif s’accroît. On pourrait vraiment arriver à gagner des années. Quelqu’un qui a 70 ou 75 ans et qui en est au début de la maladie, si on lui donne trois à cinq ans de mieux, cela change beaucoup de choses: il pourra reconnaître ses petits-enfants et communiquer avec eux plus longtemps. » Du fait de la cascade amyloïde, la maladie aurait, en effet, une certaine forme d’inertie, se poursuivant un peu malgré le nettoyage des plaques.
Ainsi, après la grande dépression des années 2020-2023, la recherche retrouve espoir. Et les investissements des laboratoires pharmaceutiques qui menaçaient de se tarir reprennent. La course au traitement est totalement relancée. Ne serait-ce que pour améliorer l’effet et l’administration de ces deux anticorps. Le donanémab ne requiert qu’une seule perfusion par mois, quand deux sont nécessaires pour le lécanémab. Lequel pourrait bientôt être disponible en administration sous-cutanée…
Signe des temps, le laboratoire français Sanofi a racheté en mai pour près de 500 millions de dollars la biotech américaine Virgil Neuroscience. Celle-ci avait attiré l’attention avec des résultats prometteurs en essai de phase I pour sa molécule, VG-3927, qui tente d’exploiter les cellules immunitaires du système nerveux central, la microglie, pour réduire à la fois la présence de la bêta-amyloïde et de la protéine tau anormale.
La Chine mise sur la microchirurgie
Une méthode surprenante contre la maladie d’Alzheimer a été présentée par une équipe du centre de la santé mentale de Shanghai, en Chine: l’anastomose lymphoveineuse. Une procédure mini-invasive normalement utilisée pour traiter un lymphœdème, afin de décompresser les voies de drainage lymphatique obstruées. Les chercheurs expliquent que l’opération est récemment apparue comme un traitement potentiel de la maladie d’Alzheimer. Plus de 1000 interventions auraient eu lieu, par une sorte d’effet de mode autour de cas spectaculaires médiatisés. Mais sans réel suivi ni preuve du bénéfice annoncé.
Cette technique qui consiste à passer par quatre mini-incisions dans le cou a été proposée pour améliorer le drainage des vaisseaux lymphatiques cervicaux bilatéraux. Le système lymphatique est en effet une voie essentielle au nettoyage du milieu cérébral, et son mauvais fonctionnement a déjà pu être associé à Alzheimer. « C’est loin d’être une mauvaise idée « , reconnaît Remy Genthon, directeur de la fondation Recherche Alzheimer. Encore faudrait-il qu’une étude soit menée correctement pour en évaluer la portée clinique.
Franchir plus facilement la barrière hémato-encéphalique
De son côté, le laboratoire Roche a annoncé l’entrée en phase III de son trontinémab, qui a montré une action plus rapide sur les plaques amyloïdes. Cet anticorps a la particularité d’être conçu avec une technologie de « navette cérébrale », permettant de mieux franchir la barrière hémato-encéphalique qui filtre les molécules pénétrant le cerveau. L’obstacle de cette barrière sanguine est forcé par le lécanémab et le donanémab avec des doses plus fortes – l’idée étant qu’en donnant beaucoup, suffisamment d’anticorps franchiront la barrière et atteindront leur cible. Le trontinémab devrait, lui, permettre de mieux protéger les vaisseaux sanguins et occasionner moins d’effets indésirables Aria.
Avec la relance des investissements, d’autres pistes de recherche se dessinent. À commencer par celle de la protéine tau. Car les deux anticorps (lécanémab et donanémab) n’ont aucun effet direct sur elle. Or, l’hypothèse de la cascade amyloïde postule qu’une fois enclenchée, la dégénérescence neuronale amorcée par l’action des plaques amyloïdes sur les protéines tau se propage et ce, indépendamment de la présence des plaques. Il est possible que la neurodégénérescence provoquée par cette protéine dysfonctionnelle se propage, même après le retrait des plaques amyloïdes ; comme une pathologie devenue autonome, la taupathie.
Des analyses de biomarqueurs ont d’ailleurs montré que la localisation et l’importance de la protéine tau sont plus étroitement corrélées à la sévérité des symptômes que celles des plaques bêta-amyloïdes. Tau devrait donc constituer une cible à part. Mais elle est plus difficile à atteindre car nichée au cœur des neurones. Jusqu’ici, les essais d’anticorps contre cette protéine ont tous échoué.
D’autres chercheurs imaginent agir également à l’autre bout de la cascade. Car les plaques amyloïdes se formeraient elles-mêmes en réponse à un événement plus précoce pouvant être ciblé: le dysfonctionnement des lysosomes, des organites dans les cellules chargés de la digestion des déchets intracellulaires. C’est là que la machine cérébrale se gripperait, permettant le relâchement de déchets, dont la bêta-amyloïde en excès. Pionnier de cette théorie, Ralph Nixon, neurobiologiste à l’université de New York, aux États-Unis, l’assurait dans la revue Nature il y a quelques mois: « De plus en plus de personnes s’accordent à dire que la maladie débute à l’intérieur de la cellule, plutôt qu’à l’extérieur. » Son équipe cherche ainsi à améliorer des médicaments déjà existants pour cibler les lysosomes afin de leur permettre d’atteindre leur cible dans le cerveau.
L’idéal restera quoi qu’il en soit de prendre la maladie au plus tôt. La protéine bêta-amyloïde commence à s’accumuler dans le cerveau quinze ans avant que n’apparaissent les premiers symptômes. Les essais Ahead et Trailblazer- Alz 3 testent les lécanémab et donanémab pour savoir s’ils peuvent prévenir l’apparition des symptômes chez les personnes ne présentant pas d’effets cognitifs, mais pour lesquelles la bêta-amyloïde a commencé à s’accumuler.
Pour l’heure, en France, médecins et patients attendent avec impatience que la Haute Autorité de santé se prononce sur le lécanémab et le donanémab. La révolution Alzheimer pourra ensuite commencer.
Les ondes gamma pour restaurer la mémoire
Dans notre cerveau, les neurones communiquent entre eux grâce à un signal électrique. S’ils s’activent de façon synchrone, ces oscillations électriques prennent la forme d’ondes traversant le cerveau. Or, les personnes souffrant d’Alzheimer montrent une réduction des ondes gamma, essentielles à la consolidation de la mémoire.
Au Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis, l’équipe de la neuroscientifique Li-Huei Tsai a montré qu’en exposant les malades à des flashs lumineux de 40 hertz, leur cerveau répond en imitant cette activité électrique et en produisant lui-même cette fréquence correspondant aux ondes gamma. Au point de réussir à éliminer une partie des protéines bêta-amyloïdes et tau dans le cerveau. Un nouvel essai clinique est en cours chez des individus plus jeunes et sans symptômes, afin de voir si le traitement peut retarder l’apparition de la maladie.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press