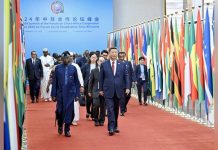Africa-Press – Mali. Ce 4 août, veille de l’ouverture des négociations sur le « traité plastique », la revue médicale The Lancet a initié un rendez-vous annuel pour rendre compte des efforts futurs pour réduire la pollution par les plastiques. À l’initiative du monde académique international, une « coalition des scientifiques pour un traité sur les plastiques efficace » a également été créé en décembre 2022.
Ce réseau international de chercheurs indépendants est désormais présent dans 65 pays. Il est chapeauté par un comité de pilotage qui approuve les rapports et les avis produits par ses membres. Spécialiste des sols, directrice de recherche Inrae à l’Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris, Marie-France Dignac est l’une des membres de ce comité de pilotage. Elle détaille les derniers résultats scientifiques sur le sujet.
Sciences et Avenir: Qu’est ce qui a motivé la création d’une coalition des scientifiques en novembre 2022?
Marie-France Dignac: Dès l’adoption de la résolution onusienne décidant de la négociation d’un traité sur la pollution plastique, de très nombreux scientifiques ont pensé qu’il fallait créer une instance pour apporter les connaissances acquises aux gouvernements et aux négociateurs, car le comité de négociation ne comportait pas d’interface science politique comme le Giec pour le climat ou l’Ipbes pour la biodiversité. Le comité dont je suis membre est chargé de suivre les travaux académiques sur les plastiques dans le monde, d’orienter la stratégie sur les synthèses scientifiques produites par les membres et de les valider avant publication. Nous sommes très vigilants sur les conflits d’intérêts avec l’industrie. Nous avons aujourd’hui 450 membres.
Sciences et Avenir: Quels sont les domaines scientifiques impliqués dans la meilleure compréhension des impacts des plastiques sur l’ensemble de la biosphère?
Les plastiques et leurs résidus à l’échelle macro et microscopique ainsi que les substances chimiques des plastiques sont présents partout dans tous les compartiments de la biosphère. Les domaines scientifiques concernés sont extrêmement nombreux. Les chimistes, biochimistes, toxicologues, écotoxicologues sont évidemment en première ligne.
Mais tous les secteurs de l’écologie, des sciences de l’atmosphère à celles des océans, ont à faire avec cette pollution qui impacte à la fois les paramètres physico-chimiques de ces milieux et la faune et la flore qui les habitent. Les secteurs de la santé humaine sont eux aussi concernés. L’étude des effets des microplastiques sur la santé humaine est assez récente. Enfin, il faut y associer les sciences humaines tant les plastiques imprègnent les modes de vie, l’économie, les habitudes de consommation.
Sciences et Avenir: Le principal point de discussion de la négociation qui s’ouvre à Genève porte sur la réduction de la production de plastique dans le monde. Quels sont les arguments scientifiques qui plaident pour une telle mesure?
D’ici à 2040, on estime que 20.000 millions de tonnes de plastique en cumulé auront été produites. Les estimations, prenant en compte en amont les volumes de production et en aval les systèmes de traitement des déchets, montrent que l’optimisation de la gestion des déchets, les technologies d’élimination et l’amélioration de la circularité ne suffiront pas à réduire la pollution par les plastiques à court, moyen ou long terme. Des chercheurs de l’université de Californie à Berkeley (États-Unis) ont montré que rien que pour tenir compte de l’impact des plastiques sur le climat (ils sont fabriqués à 99% à partir de pétrole) et respecter les accords de Paris de limitation des gaz à effet de serre, il faudrait réduire la production de plastique de 11,8 à 17,3 % par an.
Les modèles scientifiques montrent que pour réduire la pollution, il faut définir des calendriers nationaux contraignants de réduction progressive et des objectifs globaux afin de réduire la production de polymères plastiques primaires (PPP). Pour cela, il faudra obtenir de l’industrie les vrais chiffres de production. Il y a un réel manque de transparence des données industrielles. La coalition des scientifiques a identifié des pistes pour réduire la production. Il s’agit d’agir d’abord sur les plastiques non essentiels et sur les produits non sûrs et non durables, et d’accroître la transparence et la responsabilité des différents acteurs. Le plastique ne devrait plus être réservé qu’à des usages où ils sont vraiment utiles et peu remplaçables.
Sciences et Avenir: L’interdiction des produits chimiques dangereux pourrait également être décidée à Genève. Quels sont ces molécules? Sont-elles très présentes dans les plastiques? Que sait-on de leurs impacts sur l’environnement et la santé humaine?
Dans un article paru dans Nature le 9 juillet 2025, des chercheurs de l’université des sciences et technologies de Trondheim (Norvège) ont identifié plus de 16.000 substances chimiques présentes dans les produits plastiques de consommation courante. Sur ces 16.000 molécules, plus de 4000 ont une toxicité avérée sur l’environnement et les organismes vivants, humains compris. Et plus de 10.000 n’ont même pas été évaluées, on en connaît donc pas les potentiels impacts.
Certaines substances dangereuses sont désormais bien connues du public. Ce sont les phtalates, le bisphénol A, les retardateurs de flamme bromés, les PFAS, etc. Ces produits ne sont pas « accrochés » aux polymères, si bien qu’ils sont facilement relargués dans l’environnement. Nous butons là de nouveau sur un problème de transparence. Le consommateur ne connaît pas la composition réelle du produit qu’il achète. Et les interdictions ne sont pas toujours efficaces.
Quand une substance est bannie, il est facile d’aller chercher des molécules voisines pour garder les mêmes propriétés. À notre sens, il faudrait interdire des familles de molécules plutôt que des substances isolées. Les plastiques ont des compositions souvent exclusives et leurs substances chimiques n’entrent pas dans le champ d’application de la plupart des Accords multilatéraux sur l’environnement (AME) et ne sont donc pas réglementés par ces derniers.
Sciences et Avenir: Vous êtes une spécialiste de la vie biologique des sols. Que sait-on des effets des plastiques sur ce milieu?
Les sols sont contaminés par des microplastiques de moins de 5 millimètres à des teneurs qui pourraient être supérieures à celles constatées dans les océans. Ils sont émis par l’usure des plastiques utilisés en agriculture, par les dégradations des emballages, des pneus, des textiles. Ainsi, des études ont montré que des particules retrouvées dans les sols, dans des milieux aquatiques et sur des plages provenaient du lavage de vêtements en synthétique dans les machines des particuliers.
Une étude de l’Ademe portant sur l’analyse de 33 placettes sur tout type de sol, des forêts aux champs agricoles en passant par les prairies, a montré que 75% des sols contenaient des microplastiques. Certains champs ont par ailleurs été contaminés par l’épandage de boues de stations d’épuration ou de composts issus de centres de traitement mécano-biologique qui laissent passer cette pollution.
Sciences et Avenir: Vous êtes aussi co-autrice d’un article sur les liens avec la santé humaine. Quels sont les risques encourus par les humains en général? Voit-on déjà des pathologies se développer?
La coalition a publié un rapport intitulé « La santé humaine dans le traité mondial sur les plastiques ». Nous y affirmons, preuves scientifiques à l’appui, que l’étendue de l’exposition humaine et les dangers sanitaires associés constituent un problème majeur pour la santé au niveau mondial. Et ce danger est en constante évolution au gré de l’apparition de nouvelles molécules, de nouveaux usages et de l’augmentation des déchets dans l’environnement. Nous y écrivons notamment que « les procédés de production, dès l’extraction des matières premières, émettent des polluants atmosphériques, des substances chimiques toxiques et des gaz à effet de serre, entraînant des risques accrus de maladies chroniques et des problèmes de santé critiques pour les populations environnantes et les travailleurs du secteur industriel ».
Les formulations chimiques complexes et dangereuses pour la santé augmentent le danger sanitaire lors de l’utilisation des plastiques et leur élimination. Ainsi, l’incinération des déchets plastiques à ciel ouvert, qui constitue toujours la majorité des traitements d’élimination dans le monde, augmente le risque de pathologies pulmonaires et de cancers. Ce dernier exemple montre que tous les humains ne sont pas exposés de la même manière selon le niveau de revenu, le lieu d’habitation, les disparités physiologiques. Un accord efficace devra ainsi non seulement réduire la pollution, mais aussi diffuser partout dans le monde les meilleures techniques de traitement qui réduisent fortement les pollutions atmosphériques. Une meilleure conception des produits en plastique est aussi une solution. Mais un accord « efficace » doit en priorité programmer la réduction de la production.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press