Africa-Press – Mali. Le Mali est entrain de passer d’une catastrophe à une autre, cette fois-ci il s’agit de sa dignité de « bon payeur ».
Nous avons appris que l’organisme chargé de gérer les opérations financières de l’Union économique et monétaire ouest-africaine a annoncé que, jusqu’à vendredi dernier, le Mali était considéré en défaut de paiement de ses dettes souveraines, d’un montant de « 53 milliards de francs CFA, soit l’équivalent de 81 millions d’euros ».
Cet organisme n’est autre que l’agence de coordination régionale des émissions de dettes dans les pays ouest-africains de la zone CFA, plus connue sous son acronyme « UMOA Titres », qui est chargée de la gestion des titres publics au sein de l’UEMOA, qui regroupe 8 pays d’Afrique de l’Ouest utilisant une monnaie commune, le franc CFA, à savoir « la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Togo et le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Bissau, le Niger et le Bénin ».
Dans le communiqué publié à ce sujet, l’autorité financière a ajouté que le défaut « intervient dans un contexte où l’Etat du Mali est soumis à des sanctions imposées à son encontre par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO », précisant que depuis le 31 janvier 2022, elle a publié 5 mémorandums aux investisseurs pour les informer que le Mali « n’est plus en mesure de faire face à ses obligations financières sur le marché obligataire public ».
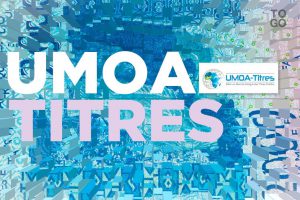
Quant au ministère malien des Finances et de l’Economie, il avait annoncé un peu plus tôt, que le pays avait manifesté sa volonté et sa capacité à faire face à ses engagements financiers, tout en soulignant qu’il avait « toujours respecté ses obligations sur le marché financier ».
C’est pour quoi faut-il comprendre, dans ce contexte, que les sanctions économiques infligées par la CEDEAO contre Bamako ont suspendu « avec effet immédiat toutes ses transactions commerciales et financières avec les Etats membres de l’organisation, à l’exception des produits de consommation et de première nécessité ».
En plus, ces sanctions ont gelé les avoirs du pays dans les banques centrales de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et dans les banques commerciales des États membres, et ont suspendu également le droit du Mali à bénéficier de toute aide des institutions financières relevant de la CEDEAO.
Il s’agit là d’une situation devenue très critique pour la junte militaire malienne, conduite en haut lieu par le colonel Assimi Goïta, depuis que ce dernier avait annoncé vouloir « étendre la période de transition de 6 mois à 5 ans ».
Pour rappel, suite au coup d’État perpétré en République du Mali, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest s’est empressée de prendre des décisions douloureuses contre le gouvernement de transition dans le pays, mais l’imposition des dernières sanctions, plus sévères, issues de la réunion extraordinaire tenue à Accra, la capitale du Ghana, le 9 janvier dernier, a créé des sentiments de mépris d’un grand nombre de Maliens et d’Africains envers la CEDEAO, pour les raisons suivantes :
• la non-prise en compte par la CEDEAO des conséquences humanitaires des sanctions, sachant que la fermeture des frontières et le gel des comptes sensibles de l’État ont des conséquences directes sur la population, même si elles ne sont pas intentionnelles en elles-mêmes.
• la suggestion et l’affirmation de certains politiciens africains locaux que ce que l’on entend par les décisions de la CEDEAO et ses sanctions strictes contre le Mali est « une dictée de la France » à ses alliés politiques et partenaires dans la région, en particulier de Côte d’Ivoire et du Burkina Faso, dont le président a été récemment renversé après que Roch Marc Kaboré ait soutenu les décisions de la CEDEAO contre le Mali.

On peut donc dire, dans le cadre du droit international régional représenté dans les accords de la CEDEAO, que l’imposition de sanctions aux gouvernements militaires de transition, en particulier ceux qui sont arrivés au pouvoir en renversant le constitutionnalisme et la légitimité, était conforme au système et aux obligations de la République du Mali dans les chartes de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest sur la bonne gouvernance.
A titre d’exemple, le Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance de la CEDEAO 2001, Section I, Clause (1), établit les principes de convergence constitutionnelle du Protocole, qui stipule ce qui suit :
• (b) tout accès au pouvoir doit se faire par des élections transparentes,
• (c) tolérance zéro absolue du pouvoir obtenu ou maintenu par des moyens anticonstitutionnels.
Sur la base de ces clauses et d’autres, un malentendu s’est produit dès le début de la crise politique au Mali, et l’affaire s’est aggravée entre le groupe et les militaires, sur le fait que le président déchu Ibrahim Boubacar Keita avait été élu au suffrage universel par tout le peuple, pour un mandat qui était en vigueur, et que l’arrivée des militaires au pouvoir n’était pas légitime, selon les obligations régionales de la République du Mali.
Cependant, la sévérité des sanctions entraîne des conséquences humanitaires en raison de la nature et de la topographie de l’État du Mali, en fermant ses frontières avec les pays voisins, dont dépendent beaucoup les importations, surtout que ces frontières sont démunies de ports maritimes, nuisant ainsi aux personnes qui n’ont aucune responsabilité dans la crise.
Des solutions urgentes s’imposent pour que la situation, qui pourrait s’aggraver encore plus, soit le plus vite allégée !
Anouar CHENNOUFI
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press






