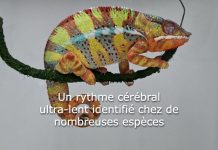Africa-Press – São Tomé e Príncipe. Est-ce le début d’une nouvelle ère dans le traitement de la maladie d’Alzheimer ? Alors que certains médecins pensaient que les pistes de recherche actuelles menaient à une impasse, coup sur coup, trois médicaments ont été commercialisés ou sont en passe de l’être aux États-Unis. Des traitements avec lesquels, pour la première fois, on peut associer un ralentissement du déclin cognitif aux effets visibles dans le cerveau. Ces effets sont une réduction dans l’accumulation d’agrégats protéiques que les chercheurs pensent nocifs. Cette piste de recherche, dite de la cascade amyloïde, remonte aux débuts des années 1990.
La protéine bêta-amyloïde, naturellement présente dans le cerveau, s’accumule au fil des années et finit par former des dépôts. Ces derniers déstabilisent une autre protéine, tau, dont la désorganisation fait dégénérer les neurones, allant jusqu’à la mort des cellules. Un processus très lent, qui s’installe bien avant les premiers symptômes de la maladie. Bien que le processus ne soit pas réversible, il est ralenti par cette nouvelle génération de molécules : l’aducanumab (Adulhem) du laboratoire Biogen autorisé en 2021 ; le lecanemab au début de cette année ; et, enfin, le donanemab d’Eli Lilly qui a déposé sa demande d’autorisation en juillet.
Trois anticorps monoclonaux administrés par intraveineuse chez le patient toutes les deux semaines. Tous ont la même action : ils sont formulés pour détecter et détruire les protéines bêta-amyloïde et tau. L’aducanumab a été le premier à montrer une réduction des dépôts amyloïdes, sans lien toutefois avec une amélioration sur le plan clinique pour le patient. Un tour de force que le lecanemab a, lui, réussi : les études cliniques annoncent que ce dernier a permis de réduire de 27 % le déclin cognitif des patients traités sur une période de dix-huit mois, par rapport au groupe de patients ayant reçu un placebo. Enfin, Eli Lilly annonce dans un communiqué que le donanemab permettrait de ralentir le déclin clinique de 35 % par rapport au placebo et de 40 % pour la capacité à effectuer les activités de la vie quotidienne.
Une réaction inflammatoire sous l’effet des anticorps
Derrière les chiffres, que peut-on espérer concrètement de cette nouvelle classe de traitements ? “Si votre père ou votre mère se trouve déjà dans un Ehpad, alors ces molécules ne sont pas pour lui ou pour elle, préfère prévenir d’emblée Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer. En clair, le but est de retarder au maximum l’entrée dans une institution et de favoriser l’autonomie le plus longtemps possible. On peut vivre à peu près normalement, tant qu’on a des fonctions exécutives – comme savoir composer un numéro de téléphone -, que la mémoire n’est pas trop affectée et qu’il n’y a pas de troubles du comportement, par exemple quelqu’un qui devient subitement agressif. ”
Mais en parallèle de ces effets positifs, les résultats des essais avec le lecanemab ont montré que le médicament n’est pas sans risques. Environ 30 % des malades ont présenté des effets secondaires, du plus léger au plus grave. Ils ont été sévères pour 10 % d’entre eux, et 5 % ont même dû arrêter le traitement. Ces effets, tous de même nature, sont nommés des Aria, des anomalies d’imagerie liée à l’amyloïde : des œdèmes ou des hémorragies du cerveau observables à l’IRM. Il s’agit d’une réaction inflammatoire sous l’effet des anticorps, qui entraîne dans les deux cas une compression de la boîte crânienne. Trois personnes de la cohorte sont décédées à cause de ces effets indésirables.
“Après vingt-trois ans à attendre qu’un effet clinique soit associé à la suppression des lésions amyloïdes, nous sommes passés de l’enthousiasme à la gueule de bois. On voit bien que l’effet modeste n’est pas dénué d’effets secondaires et a été fatal à trois personnes qui avaient encore des années devant eux “, regrette Bruno Dubois, professeur de neurologie à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, et directeur de l’Institut de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer (IM2A) à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.
Pour l’heure, ces nouveaux médicaments ne sont disponibles qu’aux États-Unis, mais un dossier concernant le lecanemab a été remis à l’Agence européenne du médicament (EMA) pour évaluation. Parmi les facteurs que cette dernière devra étudier, il y a l’effet biologique démontré mais également le coût du traitement, fixé à 26.500 dollars (environ 24.300 euros) par an et par patient. “Ce n’est pas certain que la réponse de l’EMA soit positive. Si l’Europe dit oui, le lecanemab pourra bénéficier d’une procédure spéciale, qu’on appelle le ‘fast track’. Mais même avec ces formalités plus rapides, ce ne sera pas avant 2025 “, prévient Bruno Dubois. L’adulhem, du laboratoire Biogen, a déjà été rejeté par l’Union européenne, le Japon et la Grande-Bretagne. “Pour le lecanemab, l’agence va devoir mettre de côté le bénéfice individuel et trancher sur le bénéfice de santé publique : collectivement, ce léger ralentissement de la maladie accompagné d’un risque d’effets secondaire vaut-il la peine ? “, pose Philippe Amouyel.
Administrer la thérapie avant les premiers symptômes
Et subsiste une grande inconnue : que se passe-t-il au-delà des dix-huit mois durant lesquels le traitement a été testé ? En l’absence d’études complémentaires, impossible de savoir si l’effet se stabilise ou se maintient. L’hypothèse la plus positive est que la poursuite du traitement, s’il est bien toléré, pourrait en prolonger les effets. Les progrès pourraient alors aller croissant et faire gagner petit à petit des mois supplémentaires d’autonomie. Surtout que les perspectives ne sont pas les mêmes selon le degré d’avancement de la maladie. Dans les études présentées par les laboratoires Esai et Biogen, les patients inclus sont soit à des stades très précoces, soit à des stades “prodromaux”, c’est-à-dire avec des symptômes avant-coureurs bénins.
“À ces niveaux, la personne va normalement tomber dans une dépendance qui nécessite un placement au bout de cinq ou six ans, explique Philippe Amouyel. Si vraiment la baisse d’environ 30 % du ralentissement de la maladie se prolongeait sur les cinq ans qui suivent, ces patients pourraient espérer gagner environ un an d’autonomie supplémentaire. D’un point de vue individuel, la réponse affective des familles est positive. ”
Cette estimation peut paraître modeste, d’autant qu’à l’imagerie, le lecanemab montre une très nette réduction de la plaque bêta-amyloïde. Pour que l’effet sur la vie de tous les jours soit plus net, il faudrait commencer à administrer la thérapie plus tôt encore, avant même que les symptômes n’apparaissent. On sait désormais que les plaques commencent à s’accumuler dans le cerveau vingt à trente ans avant les signes de démence, donc dès 45 ans. “Mais tous les patients qui ont de la plaque ne développent pas forcément un Alzheimer, le lien n’est pas formel “, avertit Bruno Dubois.
Pour identifier les patients qui développeront vraiment la maladie d’Alzheimer, le directeur de l’IM2A mise sur l’intelligence artificielle. “À terme, un algorithme à plusieurs inconnues pourrait être la solution. Parmi les facteurs à prendre en compte, l’âge bien sûr, la présence de plaque amyloïde, mais aussi celle du gène APOE, dont on sait qu’il est lié avec l’apparition de la maladie, ou encore d’autres facteurs de la vie. ” Un algorithme, qui, il l’espère, verra le jour au Cermad, le Centre d’excellence pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer, qui doit prochainement voir le jour à la Pitié-Salpêtrière.
Des molécules qui s’attaquent à la source de la pathologie
Aussi modestes soient-ils, les effets de ces nouvelles molécules permettent néanmoins pour la première fois de s’attaquer à la source de la maladie. “Dans la seconde moitié des années 1990, des médicaments agissant sur les symptômes avaient été mis sur le marché. C’était l’acétylcholine, un neurotransmetteur du système nerveux central, dont manquent les personnes atteintes d’Alzheimer, explique Philippe Amouyel. Environ 20 % des patients répondaient à ce traitement. Cela pouvait être spectaculaire, tels des patients qui reconnaissaient à nouveau leurs petits-enfants. ” Mais il était impossible de savoir en amont si la densité de neurones du patient permettait d’obtenir cet effet positif. C’est pourquoi la France avait alors décidé de dérembourser ces médicaments. S’en est suivie une longue traversée du désert dans le domaine.
Après avoir délaissé cette pathologie, les industriels sont désormais de retour dans la course. “L’industrie pharmaceutique a été capable de fabriquer un médicament sur la base d’une découverte fondamentale. C’est le côté positif : le marché est gigantesque, donc les laboratoires sont nombreux à réinvestir cette maladie “, se félicite Philippe Amouyel. Reste à savoir si les premiers effets annoncés transforment vraiment l’essai sur le long terme. Et si, à l’instar de la Food and Drug Administration aux États-Unis, l’Agence européenne du médicament donnera son feu vert.
Un vaccin nasal en cours d’essai
Plutôt que d’attaquer directement les agrégats de protéines bêta-amyloïdes dans le cerveau avec des anticorps cultivés en laboratoire, nombre d’équipes dans le monde cherchent à recruter le système immunitaire des patients pour lui apprendre à “nettoyer” le cerveau avant que celui-ci ne soit endommagé. “Depuis vingt ans, il est de plus en plus évident que le système immunitaire joue un rôle clé dans la régulation de la protéine bêta-amyloïde et donc dans l’apparition et l’évolution de la maladie “, pose la Pr Tanuja Chitnis, neurologue au Massachusetts General Hospital à Boston (États-Unis).
Avec le Pr Howard Weiner, elle pilote en ce moment un essai clinique de phase 2 pour un vaccin nasal facile à administrer, visant à activer les globules blancs de patients diagnostiqués à un stade précoce de la maladie. L’objectif est d’alerter au plus tôt l’immunité propre au système nerveux central, la microglie, pour qu’elle empêche l’accumulation pathologique de la protéine bêta-amyloïde. En effet, une fois que les plaques amyloïdes commencent à se former, la microglie tend à s’emballer et provoque une inflammation qui alimente le cercle vicieux de la neurodégénérescence. À l’inverse, si la microglie est maintenue en alerte, elle peut empêcher l’entrée dans le processus pathologique. “Si cela fonctionne vraiment, il serait possible d’administrer le vaccin à des personnes dans la cinquantaine ou la soixantaine qui n’ont pas encore la maladie d’Alzheimer, mais présentent un profil à risque. Ce serait comme traiter l’hypertension artérielle pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques “, résume Howard Weiner. De fait, le développement de tests sanguins plus précis permettrait à terme d’identifier de façon très précoce un Alzheimer présymptomatique.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la São Tomé e Príncipe, suivez Africa-Press