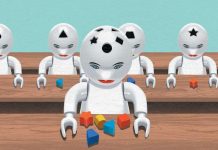Africa-Press – São Tomé e Príncipe. En 1941, l’auteur de science-fiction Isaac Asimov imagine pour décor de sa nouvelle “Reason” une station solaire orbitale gérée par un robot récalcitrant. Cette idée d’installer des panneaux solaires dans l’espace a ensuite été explorée par les ingénieurs de la Nasa dès les années 1960. C’est précisément en découvrant ces travaux dans un article du magazine Popular Science que le riche entrepreneur américain Donald Bren comprend le potentiel de production d’énergie de cette solution. Persuadé que cela pourrait répondre aux défis à venir, il approche en 2011 le directeur du California Institute of Technology (Caltech) et fait un premier don à l’université américaine pour financer des recherches dans ce sens. Aujourd’hui son rêve n’est plus de la science-fiction.
En janvier, le Caltech a en effet mis en orbite, à 530 km d’altitude, un démonstrateur de mini-centrale solaire (le Space Solar Power Demonstrator ou SSPD-1) en vue de tester des technologies clés en environnement spatial. Financé par la Darpa, l’agence militaire américaine, ce petit satellite de 50 kg a réalisé le 3 mars la première transmission orbitale sans fil d’un faisceau d’énergie vers des récepteurs, situés à une trentaine de centimètres au sein du satellite. Ceux-ci l’ont ensuite converti en courant continu qui a permis d’allumer deux diodes LED. Le 22 mai, l’expérience a accompli une nouvelle première lorsqu’un faisceau focalisé de micro-ondes a été dirigé vers le toit d’un laboratoire du Caltech, à Pasadena. “Le signal reçu est apparu à l’heure et à la fréquence prévues”, a indiqué Ali Hajimiri, chercheur en génie électrique, en charge de ce programme.
Le démonstrateur est composé de panneaux solaires qui alimentent un réseau d’émetteurs de micro-ondes. Grâce à des calculateurs électroniques miniatures, ces ondes sont concentrées par interférences constructives (elles s’additionnent) et destructives (elles se soustraient l’une de l’autre), et synchronisées afin que l’énergie soit focalisée sur la cible terrestre. Les systèmes testés étaient légers et souples, de manière à pouvoir être pliés pour réduire leur encombrement et leur masse au lancement. Le projet du Caltech prévoit en effet de lancer une constellation de panneaux souples comme des voiles solaires pliés en paquets de 1 m3, qui, en orbite, se déploieront en carrés plats d’environ 50 mètres de côté. Ils seront constitués côté Soleil de cellules photovoltaïques et côté Terre d’émetteurs d’énergie sans fil. Une structure composite ultralégère de près de 2 mètres de côté devrait également être déployée en orbite dans les prochains mois, démontrant la faisabilité de cette architecture. Enfin, 32 cellules photovoltaïques de types différents sont en test afin d’évaluer leur performance et leur résistance dans l’environnement spatial.
Le Soleil, un immense réacteur à 150 millions de kilomètres
L’immense réacteur qu’est le Soleil transforme à chaque seconde 619 millions de tonnes d’hydrogène en hélium. Située à 150 millions de kilomètres de distance, notre planète intercepte en permanence une puissance totale de 174.000 térawatts (1012 watts) hors atmosphère et 122.000 TW au niveau du sol. Par comparaison, la consommation mondiale d’énergie était de 168.500 TW par heure en 2019 ! “Un carré de 110 km de côté placé dans l’espace immédiat de notre planète suffirait à fournir l’énergie nécessaire aux activités humaines “, expliquait Daniel Lincot, spécialiste de l’énergie solaire et directeur de recherche émérite au CNRS, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, en janvier 2022. D’autant qu’une ferme solaire postée à une distance suffisante, typiquement sur l’orbite géostationnaire à 36.000 km, échapperait à l’ombre nocturne de la Terre et bénéficierait d’un ensoleillement permanent, quand les panneaux photovoltaïques au sol pâtissent dans certaines régions, notamment aux hautes latitudes, d’une luminosité parcimonieuse.
Les premiers projets de centrales solaires orbitales ont été rapidement remisés car jugés trop coûteux, et donc non rentables. Mais l’avènement des lanceurs réutilisables – qui ont entraîné une diminution des coûts de mise en orbite – et les avancées de la robotique ont fait bouger les lignes dans plusieurs pays. Dont la Chine. En juin 2022, l’empire du Milieu a annoncé qu’une équipe de recherche de l’Université de Xidian avait testé avec succès un récepteur terrestre de faisceau énergétique installé sur une structure en acier de 75 mètres de haut, un dispositif permettant de convertir l’énergie transmise en courant continu. D’autres projets sont à l’étude au Royaume-Uni, au Japon et en Corée du Sud.
L’agence spatiale européenne sur les rangs avec Solaris
Lors du conseil interministériel qui s’est tenu à Paris en novembre 2022, l’agence spatiale européenne (ESA) a pris la décision de financer une première phase d’étude pour évaluer la faisabilité et la rentabilité d’un tel projet. Il y a tout juste quelques semaines, le 24 juillet, elle a confié cette étape à Thales Alenia Space, qui doit maintenant constituer un consortium industriel afin d’explorer les diverses solutions technologiques à mettre en œuvre. Dénommé Solaris, ce projet doit être réexaminé en 2025. “Si à cette date la décision de lancer le programme est prise, notre feuille de route prévoit le vol d’un premier démonstrateur d’ici à 2030 “, indique Sanjay Vijendran, chef du projet Solaris à l’ESA.
Plusieurs solutions technologiques sont explorées aujourd’hui, concernant par exemple le mode de transmission d’énergie : laser optique ou ondes radio ? “Cette dernière méthode est la plus sûre et la plus efficace, car elle délivre l’énergie à une faible intensité et elle peut traverser l’atmosphère sans presque aucune absorption, quel que soit le temps “, explique Sanjay Vijendran. Faut-il construire la station en orbite basse ou en orbite géostationnaire, à 36.000 km ? Cette dernière option est préférable pour le spécialiste européen, car elle permettrait une stabilité de positionnement par rapport à la zone de réception et d’éviter que les nombreux débris qui encombrent les orbites basses ne viennent endommager les panneaux solaires.
Ensuite, comment construire une structure gigantesque à des milliers de kilomètres de la Terre ? “Il serait très difficile et coûteux d’envoyer des astronautes en orbite géostationnaire, note Sanjay Vijendran. Mais la robotique a beaucoup progressé au cours des cinquante dernières années : nous pouvons imaginer des flottes de robots autonomes opérant dans l’espace pour assembler une centrale solaire et l’entretenir, éventuellement avec une supervision ou une assistance limitée de la part d’astronautes. ” Peut-être faut-il aussi envisager de placer des stations relais en orbite. Bref, le champ des investigations est vaste. Mais, si elles ne sont pas encore suffisamment abouties pour être utilisées à grande échelle, toutes les briques technologiques nécessaires sont déjà en germe et devraient arriver à maturation dans la prochaine décennie.
Il faudra aussi régler le problème du recyclage d’une telle mégastructure. Les impératifs de durabilité ne seront pas atteints si tous les matériaux qui la constituent sont ensuite relégués sur une orbite cimetière ou brûlés dans l’atmosphère. Surtout, les puissants faisceaux d’énergie qui traverseraient l’atmosphère seraient-ils compatibles avec les autres applications spatiales et aériennes ? Quels dangers encourront les usagers de l’aviation et les oiseaux ? Ces sujets sont encore émergents. Reste que les efforts de recherche aujourd’hui déployés pourraient permettre demain de fournir de l’énergie à des bases lunaires ou martiennes.
L’avenir est dans les panneaux solaires souples
Pour réduire les coûts de mise en orbite de futures centrales solaires spatiales, il faudra drastiquement alléger le poids des cellules photovoltaïques. Les fermes solaires terrestres utilisent aujourd’hui des panneaux rigides et lourds. Ils sont finalement peu adaptés à une utilisation spatiale et pour couvrir la diversité des supports terrestres. Mais un nouveau procédé, le film solaire souple, pourrait à la fois s’imposer dans nos villes et à plus long terme dans l’espace. Loin de la prédominance de la Chine sur le marché des panneaux solaires classiques, des entreprises européennes aiguisent leur expertise dans ce nouveau domaine.
Citons notamment les français Armor Group (Nantes) et Solar Cloth (Nice), l’allemand Heliatek ou le polonais Saule Technologies. Ces nouveaux acteurs ont développé des tissus de moins de 1 mm d’épaisseur, très légers et souvent transparents, voire autocollants, qui intègrent dans leur trame des cellules photovoltaïques. Ces nouveaux procédés ont été d’abord imaginés pour les voiliers autonomes, en vue de remédier aux accalmies. Mais ils peuvent aussi équiper des surfaces vitrées ou recouvrir des architectures complexes.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la São Tomé e Príncipe, suivez Africa-Press