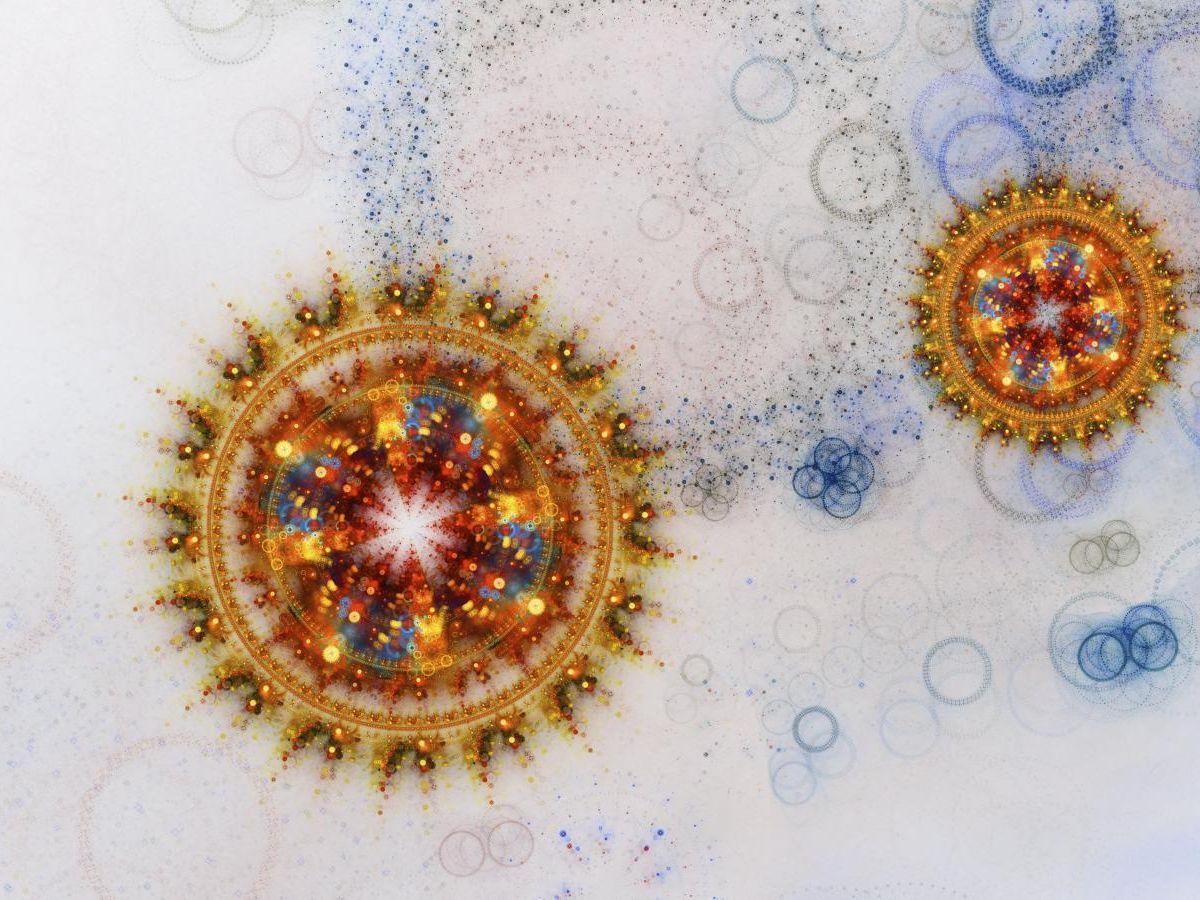Africa-Press – São Tomé e Príncipe. Le 10 janvier 2020, les autorités de santé chinoises publiaient la séquence du virus du Covid-19. A cette époque, nous sommes déjà un mois après que les premiers cas identifiés de cette nouvelle maladie ont été hospitalisés à Wuhan (Chine), et deux semaines avant les premiers cas admis dans les hôpitaux français. Très vite, les experts en génétique virale du monde entier pointent plusieurs caractéristiques étranges du SARS-CoV-2, le virus du Covid-19. Une question les taraude: le virus a-t-il pu émerger suite à une infection provoquée par une espèce animale (zoonose), ou bien est-il issu d’une manipulation à l’Institut de Virologie de Wuhan (WIV), où travaillent des experts mondiaux des coronavirus? Mais comme dans toute enquête, même scientifique, les indices peuvent être trompeurs.
Un fragment identique à celui d’un coronavirus de pangolin
A l’extrémité de la protéine Spike du virus du Covid-19, le fragment responsable de la reconnaissance de la cellule hôte interpelle les chercheurs. Appelée RBM pour Receptor Binding Motif, cette séquence est celle qui reconnaît la protéine ACE2 des cellules humaines pour permettre l’infection. Or, le RBM du SARS-CoV-2 ne ressemble à celui d’aucun autre virus SARS connu et paraît particulièrement adapté à l’infection des cellules humaines. « La seule séquence publiée antérieurement au SARS-CoV-2 qui soit de la même lignée virale, c’est une séquence de coronavirus de pangolin, publiée en octobre 2019 par des chercheurs chinois de Guangdong et Guangxi (provinces chinoises éloignées de Wuhan, ndlr) », explique à Sciences et Avenir le phylogénéticien spécialiste des mammifères à la Sorbonne Université Alexandre Hassanin. Surprise, remarque le chercheur, le RBM de ce virus est quasi identique à celui du SARS-CoV-2, avec 68 acides aminés (les « briques » composant les protéines) identiques sur 69. « Ainsi, le RBD qui paraissait de prime abord bizarre et donc suspicieux existait en fait naturellement », raisonne dans The Conversation la chercheuse au CNRS Florence Débarre, qui défend la thèse de l’émergence zoonotique. S’il a émergé une fois naturellement, pourquoi pas deux fois, postulent ces scientifiques. Mais un second élément voisin met à mal cette conclusion.
Le site de clivage par la furine, quatre « lettres » qui sèment le doute
« Je décide de regarder la séquence virale de plus près, et je vois des choses qui m’inquiètent, notamment le site de clivage par la furine », raconte l’expert en émergence virale au Scripps Institute (Etats-Unis) Kristian Andersen lors d’une audition au Congrès des Etats-Unis. A sa surface, le SARS-CoV-2 porte une protéine nommée Spike, qui reconnaît la protéine ACE2, porte d’entrée de nos cellules. Mais pour passer efficacement cette porte, la protéine Spike doit être coupée (« clivée ») par une protéase – enzyme qui coupe les protéines – comme la furine. Or, la Spike du virus du Covid-19 possède justement un site de clivage par la furine, une enzyme humaine dont la coupure fait passer Spike du rang d’épingle à nourrice à celui de clé. Par rapport au SARS-CoV-1 (épidémie de 2003) qui n’en possède pas et à tous les sarbécovirus séquencés (du nom du groupe des coronavirus auquel appartient le virus du Covid-19), le SARS-CoV-2 montre une insertion de 12 nucléotides (les « lettres » qui composent les séquences génétiques), codant les quatre acides aminés de ce site furine: RRAR.
D’autres virus avec un site furine existent, c’est notamment le cas du VIH, d’Ebola, de la grippe aviaire H5N1 et du MERS, ce coronavirus ayant causé une épidémie en 2012 au départ du Moyen-Orient. Mais ces exemples sont très éloignés génétiquement du virus du Covid-19. Aucun des centaines de génomes connus du groupe des sarbécovirus, ne possède ce site furine. « C’est au moment où cette insertion a eu lieu que le virus a acquis son potentiel pandémique », souligne auprès de Sciences et Avenir le virologue Etienne Decroly, directeur de recherche au CNRS et auteur de « Expériences en virologie – Bénéfices et risques » (Editions Quæ). Bien que régulièrement exposées à des sarbécovirus, dépourvus donc de site furine, les populations du Yunnan, région sud de la Chine, et qui vivent proches des grottes de chauve-souris ne sont que 4% à posséder des anticorps contre eux, confirmant la faible capacité de transmission de ces virus de chauve-souris entre humains.
Une apparition spontanée du site furine possible mais peu probable
Initialement, les chercheurs imaginent que ce site furine aurait pu apparaître spontanément, sachant que le SARS-CoV-2 mute très rapidement. « Notre hypothèse était qu’il aurait circulé au sein de populations humaines ou de mammifères terrestres, et qu’à un moment donné ce site se serait créé par mutation, serait sélectionné, et émergerait. C’est d’ailleurs exactement ce qui se passe pour les virus influenza (la grippe aviaire, ndlr) », explique à Sciences et Avenir Marc Eloit, virologue et ancien directeur du laboratoire de découverte des pathogènes à l’Institut Pasteur. Mais lorsqu’avec ses équipes il essaie de mimer expérimentalement cette évolution naturelle en laboratoire avec six « passages » (transmissions) entre souris transgéniques ou cultures de cellules humaines ou même singes, aucun site de clivage par la furine n’émerge. Etant donné la faible transmissibilité du virus sans ce site, son apparition spontanée aurait dû être plus précoce que cela pour rendre son émergence naturelle probable.
Il existe une autre option qui expliquerait l’émergence naturelle du site furine chez le SARS-CoV-2. « Si ce n’est pas par mutation, c’est par recombinaison », raisonne Marc Eloit. Là où les mutations sont des erreurs ponctuelles qui s’accumulent au fil des générations de virus, les recombinaisons impliquent l’intégration accidentelle d’une séquence entière de matériel génétique externe. Mais pour que cela soit plausible, il faut que les séquences qui encadrent celle qui a été intégrée par erreur soient assez similaires pour que l’enzyme chargée de synthétiser le génome viral s’y trompe. Le suspect est un site furine que l’on retrouve dans une protéine humaine de nos muqueuses respiratoires supérieures, nommée aENaC. Mais les chercheurs ne trouvent aucune homologie de séquence, invalidant cette possibilité. « Moi, je ne crois plus à cette hypothèse », conclut Marc Eloit. Autre option: l’organisme donneur serait un coronavirus porteur de ce site furine, actuellement inconnu, qui aurait co-infecté en même temps une espèce animale intermédiaire, elle aussi non identifiée.
Entre événement biologique improbable et création humaine
La difficulté dans l’affaire est qu’en biologie, même les choses improbables peuvent exceptionnellement se produire. Ainsi, et même si c’est extrêmement rare, des séquences peuvent s’intégrer sans nécessairement d’homologies de part et d’autre et expliquer une émergence naturelle du site furine. Il aurait alors fallu une co-infection de la même chauve-souris par le virus progéniteur (parent) du SARS-CoV-2 et un autre virus porteur du site furine, et qu’une recombinaison (échange) ait lieu pendant la reproduction virale. Improbable, surtout compte tenu de l’absence totale de trace d’hôtes mammifères terrestres infectés par un progéniteur du SARS-CoV-2, mais pas formellement impossible. Autre hypothèse, parfois, ce sont des erreurs de répétitions effectuées pendant la multiplication des virus et de leur matériel génétique qui conduisent à l’apparition de nouvelles séquences. Mais il n’y a pas trace de cela chez le SARS-CoV-2. « J’ai beaucoup travaillé sur les insertions et les délétions au cours de l’évolution, et là on a 12 nucléotides qui viennent de nulle part et qui créent un site totalement identique à la protéine humaine aENaC sur huit acides aminés, ce qui est très improbable », appuie Alexandre Hassanin.
Certes, « toute émergence d’une épidémie est statistiquement peu probable », précise Marc Eloit. Mais tout comme l’épidémiologiste de terrain Renaud Piarroux, qui dirige le service de parasitologie et mycologie à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière (Paris), il met en balance la probabilité que cette émergence survienne précisément en 2019 à Wuhan. « On n’a pas eu de pandémie de coronavirus depuis 1889 (la « grippe russe », qui aurait fait un million de morts, ndlr), donc la probabilité n’est pas qu’elle ait lieu à Wuhan, mais à Wuhan en 2019, où se trouve justement un des deux seuls laboratoires au monde experts dans le franchissement de la barrière d’espèces par des virus de type SARS », analyse Renaud Piarroux. « Avoir en 2019 à Wuhan une émergence naturelle d’une pandémie à coronavirus qui avait le portrait-robot de ce qui était proposé par le projet DEFUSE est un événement extrêmement improbable. » Le projet DEFUSE avait été soumis en 2018 pour financement par l’ONG EcoHealth Alliance et aurait dû être réalisé, notamment, au WIV ; il proposait des manipulations génétiques de virus rappelant fortement le SARS-CoV-2, insertion du site de clivage par la furine compris, un an avant son apparition. « Si la rage émergeait dans le 15e arrondissement de Paris, on commencerait probablement par regarder vers l’Institut Pasteur avant d’imaginer que des renards enragés se promènent avenue de Suffren », ironise Marc Eloit.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la São Tomé e Príncipe, suivez Africa-Press