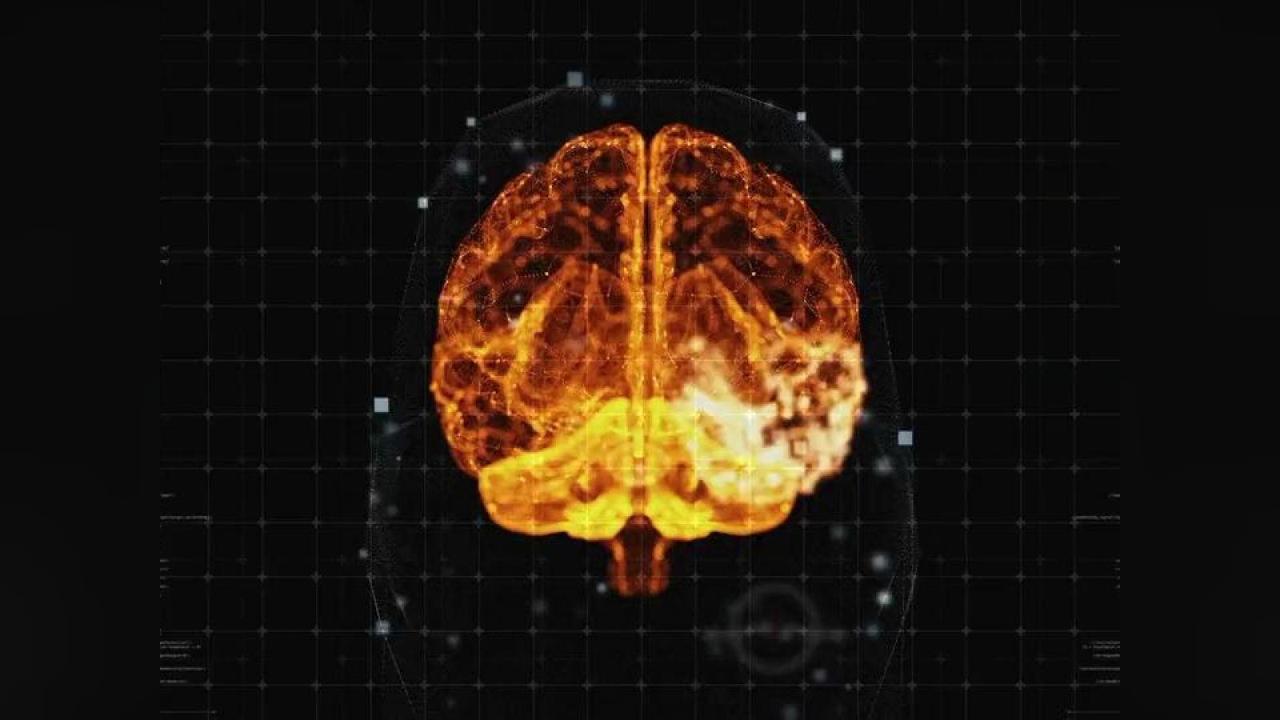Africa-Press – São Tomé e Príncipe. Fin juin 2025, une étude du MIT, pas encore évaluée par les pairs, montre que notre cerveau est moins performant en utilisant ChatGPT. Nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser régulièrement ce genre d’outils, mais l’impact de ceux-ci sont difficiles à mesurer et il ne faut pas négliger le côté sociétal.
Cette crainte n’a rien de nouveau. A chaque grande innovation technologique, une inquiétude revient: celle de perdre en intelligence ou en mémoire. Si on remonte au 4e siècle avant notre ère, Platon s’inquiétait déjà… de l’écriture ! Dans Phèdre, il rapporte les propos de Socrate, qui redoutait que l’écriture ne fasse « oublier l’âme de ceux qui l’auront apprise, parce qu’ils cesseront d’exercer leur mémoire ».
Même chose lors de l’invention de l’imprimerie. Le médecin et naturaliste suisse Conrad Gessner dénonçait au 16e siècle la surcharge d’information comme un danger. Ce que redoutait certains à l’époque n’était pas tant la technologie en elle-même, que la manière dont elle transformait notre rapport au savoir.
Externaliser, une stratégie du cerveau pour gagner du temps et de l’énergie
Ces outils reposent sur un processus essentiel dans le cerveau: l’externalisation. C’est-à-dire déléguer certaines tâches mentales: on va noter nos contacts sur le téléphone, chercher une adresse et suivre le GPS, utiliser une calculatrice. « Si une technologie permet de faire moins d’effort pour obtenir le même bénéfice, le cerveau va naturellement l’adopter. Et cela ne signifie pas qu’il est fainéant, explique à Sciences et Avenir Nawal Abboub, docteure en sciences cognitives et auteure du livre La puissance des bébés, publié en 2023 aux Editions Poche. Il est câblé pour minimiser les coûts cognitifs face à un gain équivalent. »
Mais cela pourrait-il nuire à notre mémoire? Une étude publiée en 2011 dans la revue Science a observé que le cerveau oublie plus facilement une information lorsqu’il sait qu’elle est stockée quelque part. Un réflexe devenu courant: face à une question comme « quelle est la date de la bataille d’Azincourt? », notre premier geste est de chercher sur Google. Mais d’autres chercheurs, en 2018 et 2020, ont tenté de reproduire cette étude sans parvenir aux mêmes résultats. Ce qui rappelle une règle fondamentale en science: une étude isolée ne suffit pas. Il faut que les résultats soient vérifiés, reproduits, et consolidés par d’autres travaux.
Et ChatGPT, dans tout ça?
Pour ChatGPT, le recul est encore limité. L’outil a été lancé fin 2022, soit moins de trois ans à l’échelle de la recherche scientifique. Pourtant, certaines études publiées en 2025 suggèrent déjà des effets potentiellement négatifs: baisse de la créativité, perte de motivation, diminution de l’esprit critique… Autant de signaux à prendre au sérieux, mais avec précaution.
L’étude qui a récemment enflammé le débat est encore sous forme de préprint, elle n’a pas encore été relue ni validée par d’autres scientifiques. Elle montre que les participants qui utilisent ChatGPT pour rédiger un texte retiennent moins bien ce qu’ils ont écrit, et activent moins certaines zones cérébrales. Les chercheurs évoquent même, à terme, une « dette cognitive ». Mais quand elle est bien utilisée, après une réflexion autonome, l’IA fait augmenter l’activité cérébrale.
Autrement dit, tout dépend de l’usage qu’on en fait. « Non, l’IA ne nous rend pas plus bêtes, rappelle Nawal Abboub. C’est comme penser qu’une calculatrice empêche d’apprendre les mathématiques. Comme tout nouvel outil apporté par le progrès, il y a des bons et des mauvais usages, c’est pour cela qu’il faut absolument les enseigner. »
Un sujet de recherche… et de société
À ce jour, il est impossible de dire quels seront les effets à long terme de l’IA générative sur notre cerveau. Il faudra du temps, des études rigoureuses, et surtout des recherches répliquées pour mieux comprendre comment ces outils influencent notre mémoire, notre apprentissage ou notre raisonnement.
Mais une chose est sûre: la recherche ne fait que débuter. « C’est un vrai sujet de société, tout le monde veut des réponses, mais ne cédons pas à la peur d’être remplacés, apprenons surtout à les utiliser de manière intelligente », conclut Nawal Abboub. Et pour obtenir ces réponses, il ne suffira pas d’interroger ChatGPT.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la São Tomé e Príncipe, suivez Africa-Press