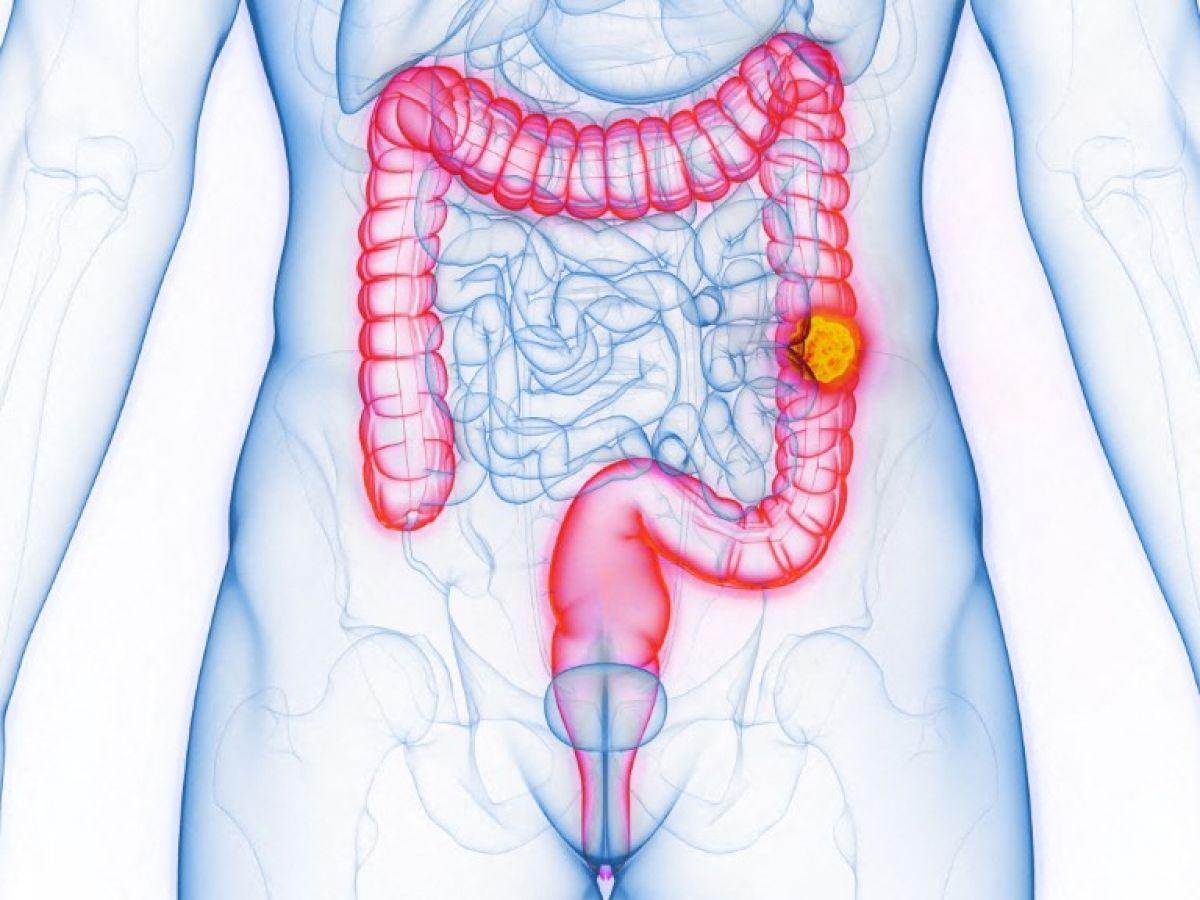Africa-Press – Togo. Le cancer colorectal a longtemps été considéré comme un cancer survenant tard dans la vie et concernant les adultes « plus âgés. » Mais depuis plusieurs années, son incidence a largement augmenté dans les populations plus jeunes. Très particulièrement au cours des deux dernières décennies. Aux Etats-Unis, environ 20% des patients atteints de cancer colorectal étaient âgés de moins de 55 ans en 2019, soit deux fois plus qu’en 1995 selon l’American Cancer Society. Chaque année, ce taux progresse de 3% chez les personnes de moins de 50 ans. Si cette tendance se poursuit, ce cancer pourrait devenir l’une des principales causes de décès liés au cancer chez les jeunes adultes dès 2030. Au-delà des Etats-Unis, le cancer colorectal est en hausse chez les jeunes dans plus de 27 pays selon une récente étude, parmi lesquels la France, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Chili, la Norvège, l’Australie, le Canada, la Turquie, Israël, l’Ouganda et bien d’autres.
En France, le cancer colorectal fait partie des cancers les plus fréquents, avec plus de 47.000 nouveaux cas chaque année ; il représente la deuxième cause de décès par cancer tous sexes confondus. Le pays suit la même tendance constatée de façon internationale: entre 2000 et 2020, l’incidence des carcinomes colorectaux a augmenté de 1,43 % par an chez les 15-39 ans selon la première étude portant spécifiquement sur les adolescents et les jeunes adultes, explique Santé publique France. Jusqu’à maintenant, aucune explication n’a pu être avancée pour expliquer cette hausse globale du cancer colorectal chez les populations jeunes. Les patients n’ont souvent pas d’historique familial de la maladie et peu de facteurs de risque connus, tels que l’obésité ou l’hypertension.
Une toxine présente dans 50% des cas
Pour la première fois, une piste solide a été identifiée, celle d’une toxine appelée colibactine. Produite par certaines souches d’Escherichia coli, une bactérie présente dans le côlon et le rectum, la colibactine est une toxine capable d’altérer l’ADN. Son lien avec le cancer colorectal était déjà connu. Les mutations qu’elle induit sont retrouvées chez environ 10 à 15% des patients atteints de ce cancer. « Mais cette étude montre pour la première fois la prévalence de cette signature dans les cancers des jeunes adultes, environ 50% des cas chez les malades de moins de 40 ans », raconte à Sciences et Avenir Ludmil Alexandrov, professeur au département de bioingénierie Shu Chien-Gene Lay et au département de médecine cellulaire et moléculaire de l’Université de Californie à San Diego (UC San Diego).
Dans ces travaux publiés dans le journal Nature, 981 cas de cancers colorectaux issus de 11 pays différents ont été passés en revue, certains cas survenant tôt dans la vie et d’autres plus tard. Les résultats obtenus montrent que la colibactine entraîne des changements spécifiques dans l’ADN. Ils étaient 3,3 fois plus fréquents chez les cas survenus tôt dans la vie (plus particulièrement avant 40 ans), que chez ceux après 70 ans. Ces profils de mutations étaient particulièrement prévalentes dans les pays où l’incidence du cancer colorectal des jeunes est élevée.
Des mutations silencieuses dès l’âge de 10 ans
D’après les chercheurs, les effets de la colibactine commenceraient tôt dans l’organisme. Les mutations surviendraient au cours des dix premières années de vie, ce qui concorde avec d’autres études déjà parues sur le sujet. La bactérie coloniserait alors silencieusement le côlon chez les enfants, induisant des changements moléculaires dans leur ADN et préparant le terrain pour le développement d’un cancer colorectal bien avant que les premiers symptômes ne se fassent sentir. « Si quelqu’un acquiert une de ces mutations avant l’âge de 10 ans, cette personne pourrait développer un cancer colorectal plusieurs décennies plus tôt que prévu, à 40 ans au lieu de 60 », explique le Pr Alexandrov, qui précise que malgré la solidité de ces résultats, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour établir définitivement un lien de causalité directe.
Où trouve-t-on cette toxine?
Impossible, donc de ne pas « croiser la route » de ces bactéries, puisqu’elles vivent dans notre intestin. « Nous pensons que la bactérie PK+, la souche qui produit la colibactine mutagène, est présente à bas niveau dans le microbiote intestinal chez de nombreux individus. Chez la plupart d’entre eux, elle reste probablement à des niveaux faibles et ne cause aucun mal. Toutefois, nous supposons que dans les premières années de vie, certains événements pourraient permettre à ces bactéries de se multiplier chez certains individus. Dans ces cas-là, ils pourraient entrer en contact avec la barrière intestinale et causer des dommages ADN, y compris des mutations dans le tissu colorectal des enfants », détaille le chercheur.
Cette découverte soulève de nombreuses questions. « Comment les enfants sont-ils exposés aux bactéries produisant de la colibactine, et que peut-on faire pour prévenir ou atténuer cette exposition? Certains environnements, régimes alimentaires ou comportements de vie favorisent-ils davantage la production de colibactine? Comment les personnes peuvent-elles savoir si elles présentent déjà ces mutations? », s’interroge le Pr Alexandrov. Pour tenter d’y répondre, l’équipe explore maintenant diverses hypothèses. L’idée est avant tout de comprendre pourquoi la bactérie productrice de colibactine semble plus prévalente ou plus active chez les enfants d’aujourd’hui comparé à ceux des décennies précédentes.
Parmi les pistes étudiées figurent les changements environnementaux des dernières 40 années, ayant pu altérer le microbiote et favoriser la colonisation des bactéries PKS+. D’autres facteurs sont aussi examinés, pour voir si l’exposition aux antibiotiques, à différents régimes alimentaires, au lait maternisé, ou les différents modes d’accouchement pourraient également jouer un rôle. « Nous voudrions aussi voir comment l’exposition à la colibactine interagit avec le système immunitaire ou la génétique de l’hôte durant la petite enfance », explique le Pr Alexandrov, qui espère développer un biomarqueur non invasif, comme un test ADN basé sur un échantillon de selles, permettant de rapidement identifier les individus à risque. L’équipe voudrait pouvoir rapidement passer de la biologie de cette bactérie à la mise au point de mesures préventives. Dans l’espoir d’empêcher, tôt dans la vie déjà, ces expositions mutagènes menant au développement de tumeurs.
Pour plus d’informations et d’analyses sur la Togo, suivez Africa-Press